dimanche, 17 janvier 2010
Capitalisme libéral et socialisme, les deux faces de Janus
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
CAPITALISME LIBERAL ET SOCIALISME,
LES DEUX FACES DE JANUS
par Pierre Maugué
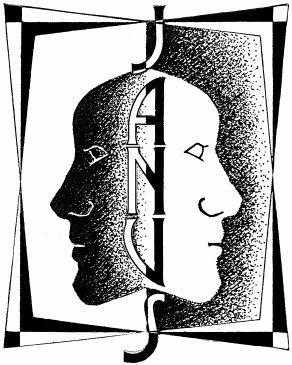 L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
En 1952, dans son "Introduction à la métaphysique" , Heidegger écrivait : "L'Europe se trouve dans un étau entre la Russie et l'Amérique, qui reviennent métaphysiquement au même quant à leur appartenance au monde et à leur rapport à l'esprit". Si, pour lui, notre époque se caractérisait par un "obscurcissement du monde" marqué par "la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l'homme, la prépondérance du médiocre", et si cet obscurcissement du monde provenait de l'Europe elle-même et avait commencé par "l'effondrement de l'idéalisme allemand", ce n'en est pas moins en Amérique et en Russie qu'il avait atteint son paroxysme.
L'affirmation de Heidegger, qui pose comme équivalentes, au plan de leur rapport à l'être, deux nations porteuses d'idéologies généralement pensées comme antinomiques peut paraître provocatrice. Elle ne fait pourtant que reconnaître, au plan métaphysique, la parenté certaine qui existe, au plan historique, entre capitalisme et socialisme (dont le marxisme n'est que la forme la plus élaborée et la plus absolue).
Capitalisme et socialisme sont aussi intimement liés que les deux faces de Janus. Tous deux sont issus de la philosophie du XVIIIe siècle, marguée par la trilogie : raison, égalité, progrès, et de la Révolution industrielle du XIXe siècle, caractérisée par le culte de la technique, du productivisme et du profit, et s'ils s'opposent, c'est beaucoup plus sur les méthodes que sur les objectifs.
L'émergence du socialisme moderne tient au fait gue non seulement la proclamation de l'égalité des droits par la Révolution de 1789 laissa subsister les inégalités sociales, mais que furent supprimées toutes les institutions communautaires (gérées par l'Eglise, les corporations, les communes) gui créaient un réseau de solidarité entre les différents ordres de la société, Quant à la Révolution industrielle, si elle marqua un prodigieux essor économique, elle provoqua également une détérioration considérable des conditions de vie des classes populaires, de sorte que ce qui avait été théoriquement gagné sur le plan politique fut perdu sur le plan social, La protestation socialiste tendit alors à démontrer qu'une centralisation et une planification de la production des richesses était tout-à-fait capable de remplacer la libre initiative des entrepreneurs et de parvenir, au plan économique, à l'égalité qui avait été conquise au plan juridique.
Bien que divergeant sur les méthodes (économie de libre entreprise ou économie dirigée), libéraux et socialistes n'en continuaient pas moins à s'accorder sur la primauté des valeurs économiques, et partageaient la même foi dans le progrès technique, le développement industriel illimité, et l'avènement d'un homme nouveau, libéré du poids des traditions. En fait, tant les libéraux que les socialistes pouvaient se reconnaître dans les idées des Saints-Simoniens, qui ne voyaient dans la politique que la science de la production, et pour lesquels la société nouvelle n'aurait pas besoin d'être gouvernée, mais seulement d'être administrée.
La même négation de l'autonomie du politique se retrouve ainsi chez les libéraux et les socialites de toute obédience. A l'anti-étatisme des libéraux, qui ne concèdent à l'Etat qu'un pouvoir de police propre à protéger leurs intérêts économiques, et la mission de créer les infrastructures nécessaires au développement de la libre entreprise, répond, chez les sociaux-démocrates, le rêve d'un Etat qui aurait abandonné toute prérogative régalienne et dont le rôle essentiel serait celui de dispensateur d'avantages sociaux. On trouve même chez les socialistes proudhoniens un attrait non dissimulé pour un certaine forme d'anarchie. Quant aux marxistes, bien qu'ils préconisent un renforcement du pouvoir étatique dans la phase de dictature du prolétariat, leur objectif final demeure, du moins en théorie, le dépérissement de l'Etat. Le totalitarisme vers lequel ont en fait évolué les régimes mar~istes constitue d'ailleurs aussi, à sa manière, une négation de l'autonomie du politique.
La pensée de Marx, nourrie de la doctrine des théoriciens de l'économie classique, Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill et Jean-Baptiste Say, est toujours restée tributaire de l'idéologie qui domine depuis les débuts de l'ère industrielle . Le matérialisme bourgeois, l'économisme w lgaire se retrouvent ainsi dans le socialisme marxiste. Marx rêve en effet d'une société assurant l'abondance de biens matériels et, négligeant les autres facteurs socio-historiques, il voit dans l'économie le seul destin véritable de l'homme et l'unique possibilité de réalisation sociale.
Mais ce qui crée les liens les plus forts est l'existence d'ennemis communs. Or, depuis l'origine, libéraux et marxistes partagent la même hostilité à l'égard des civilisations traditionnelles fondées sur des valeurs spirituelles, aristocratiques et communautaires.
Le Manifeste communiste de 1868 est à cet égard révélateur. Loin de stigmatiser l'oeuvre de la bourgeoisie (c'est-à-dire, au sens marxiste du terme, le grand capital), il fait en quelque sorte l'éloge du rôle éminemment révolutionnaire qu'elle a joué. "Partout où elle (la bourgeoisie) est parvenue à dominer", écrit Marx, "elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les liens multicolores qui attachaient l'homme à son supérieur naturel, pour ne laisser subsister entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le froid 'paiement comptant'... Elle a dissous la dignité de la personne dans la valeur d'échange, et aux innombrables franchises garanties et bien acquises, elle a substitué une liberté unique et sans vergogne : le libre-échange".
Prenant acte de cette destruction des valeurs traditionnelles opérée par la bourgeoisie capitaliste, Marx se félicite que celle-ci ait "dépouillé de leur sainte auréole toutes les activités jusque là vénérables et considérées avec un pieux respect" et qu'elle ait "changé en salariés à ses gages le médecin, le juriste, le prêtre, le poête, l'homme de science".
La haine du monde rural et l'apologie des mégapoles s'expriment également sans détours chez Marx, qui juge positifs les effets démographiques du développement capitaliste. "La bourgeoisie", écrit-il, "a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a fait surgir d'immenses cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens des campagnes, arrachant ainsi une importante partie de la population à l'abrutissement de l'existence campagnarde". Il n'hésite pas non plus à faire l'éloge du colonialisme, se félicitant que "la bourgeoisie, de même qu'elle a subordonné la campagne à la ville ... a assujetti les pays barbares et demi-barbares aux pays civilisés, les nations paysannes aux nations bourgeoises, l'Orient à l'Occident". Cette domination sans partage de la fonction économique est magnifiée par Marx, de même que l'instabilité qui en résulte. C'est en effet avec satisfaction qu'il constate que "ce qui distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes, c'est le bouleversement incessant de la production, l'ébranlement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l'instabilité et du mouvement... Tout ce qui était établi se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané".
Mais la bourgeoisie capitaliste n'en a pas moins souvent cherché à faire croire qu'elle défendait les valeurs traditionnelles contre les marxistes et autres socialistes, ce qui amène Marx à rappeler, non sans une certaine ironie, que les marsistes ne peuvent être accusés de détruire des valeurs que le capitalisme a déjà détruit ou est en voie de détruire. Vous nous reprochez, dit Mars, de détruire la propriété, la liberté, la culture, le droit, l'individualité, la famille, la patrie, la morale, la religion, comme si les développements du capitalisme ne l'avait pas déjà accompli.
«Détruire la propriété?" "Mais" dit Mars, "s'il s'agit de la propriété du petit-bourgeois, du petit paysan, nous n'avons pas à l'abolir, le développement de l'industrie l'a abolie et l'abolit tous les jours". "Détruire la liberté, l'individualité?" "Mais l'individu qui travaille dans la société bourgeoise n'a ni indépendance, ni personnalité". "Détruire la famille?" "Mais par suite de la grande industrie, tous les liens de famille sont déchirés de plus en plus".
Tous ces arguments de Marx ne relèvent pas seulement de la polémique. En effet, les sociétés capitalistes présentent bien des traits conformes aux idéaux marxistes. Ainsi, à l'athéisme doctrinal professé par les marxistes répond le matérialisme de fait des sociétés capitalistes, où toute religion structurée a tendance à disparaître pour faire place à un athéisme pratique ou à une vague religiosité qui, sous l'influence du protestantisme, tend à se réduire à un simple moralisme aux contours indécis, dont tout aspect métaphysique, tout symbolisme, tout rite, toute autorité traditionnelle est banni.
De même, au collectivisme tant reproché à l'idéologie marxiste (collectivisme qui ne se réduit pas à l'appropriation par l'Etat des moyens de production, mais consiste également en une forme de vie sociale où la personne est soumise à la masse) répond le grégarisme des sociétés capitalistes. Comme le note André Siegfried, c'est aux Etats-Unis qu'est né le grégarisme qui tend aujourd'hui à gagner l'Europe. "L'être humain, devenu moyen plutôt que but accepte ce rôle de rouage dans l'immense machine, sans penser un instant qu'il puisse en être diminué", "d'où un collectivisme de fait, voulu des élites et allègrement accepté de la masse, qui, subrepticement, mine la liberté de l'homme et canalise si étroitement son action que, sans en souffrir et sans même le savoir, il confirme lui-même son abdication". Curieusement, marxisme et libéralisme produisent ainsi des phénomèmes sociaux de même nature, qui sont incompatibles avec toute conception organique et communautaire de la société.
L'idéologie mondialiste est également commune au marxisme et au capitalisme libéral. Pour Lénine, qui soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la libération complète de toutes les nations opprimées n'est en effet qu'un instrument au service de la Révolution et ne peut constituer qu'une "phase de transition", la finalité étant "la fusion de toutes les nations". Or, cette fusion de toutes les nations est également l'objectif du capitalisme libéral qui, tout en ayant utilisé les nationalismes des peuples de l'Est pour détruire l'Union soviétique, vise en fait à établir un marché mondial dans lequel toutes les nations sont appelées finalement à se dissoudre. Toutes les identités nationales sont ainsi destinées à disparaître pour être remplacées par un modèle uniforme, américanomorphe, au service duquel une intense propagande est organisée, modèle dont les traits caractéristiques sont le métissage, la culture rock, les jeans, le coca-cola, les chaînes de restaurant fast-food et le "basic English", le tout étant couronné par l'idéologie des droits de l'homme dont les articles de foi sont dogmatiquement décrétés par les grands-prêtres d'une intelligentsia qui n'a d'autre légitimité que celle qu'elle s'est elle-même octroyée.
En fait, tant le marxisme que le capitalisme libéral approuvent sans réserves toutes les conséquences économiques et sociales de la Révolution industrielle, qui se traduisent par la destruction de tous les liens communautaires, familiaux ou nationaux, le déracinement et la grégarisation. Une telle évolution est en effet nécessaire aussi bien à l'établissement d'un véritable marché mondial, rêve ultime du capitalisme libéral, qu'à l'avènement de l'homme nouveau, libéré de toute aliénation, qui constitue l'objectif du marxisme. Pour ce dernier, le prolétariat était d'ailleurs appelé à jouer un rôle messianique et à porter plus loin le flambeau de la Révolution, afin de mener à son terme la destruction de toutes les valeurs traditionnelles.
Pour le philosophe chrétien et traditionnaliste Berdiaev, capitalisme libéral et marxisme ne sont pas seulement liés au plan des sources idéologiques, mais ils sont également les agents d'une véritable subversion. "Tant la bourgeoisie que le prolétariat", écrit Berdiaev, "représentent une trahison et un rejet des fondements spirituels de la vie. La bourgeoisie a été la première à trahir et à abdiquer le sacré, le prolétariat lui a emboîté le pas." Soulignant les affinités qui existent entre la mentalité du bourgeois et celle du prolétaire, il déclare : "Le socialisme est bourgeois jusque dans sa profondeur et il ne s'élève jamais au-dessus du sentiment des idéaux bourgeois de l'existence. Il veut seulement que l'esprit bourgeois soit étendu à tous, qu'il devienne universel, et fixé dans les siècles des siècles, définitivement rationalisé, stabilisé, guéri des maladies qui la minent."
Si, pour Berdiaev, l'avènement de la bourgeoisie en tant gue classe dominante a correspondu à un rejet des fondements spirituels de la vie, Max Weber voit, pour sa part, une relation étroite entre l'éthique protestante et le développement du capitalisme moderne. Ces deux points de vue ne sont pas aussi contradictoires qu'ils peuvent paraître de prime abord. En effet, outre que la spiritualité ne se réduit pas à l'éthique, l'éthique protestante a tendu à devenir une simple morale utilitariste qui s'apparente en fait à la morale laïgue, et qui n'est plus sous-tendue par une vision spirituelle du monde. Max Weber relève d'ailleurs que "l'élimination radicale du problème de la théodicée et de toute espèce de questions sur le sens de l'univers et de l'existence, sur quoi tant d'hommes avaient peiné, cette élimination allait de soi pour les puritains ..." °
L'utilitarisme de l'éthique protestante apparaît d'ailleurs clairement dans sa conception de l'amour du prochain. En effet, selon celle-ci, comme le rappelle Max Weber, "Dieu veut l'efficacite sociale du chrétien" et "l'amour du prochain ... s'exprime en premier lieu dans l'accomplissement des tâches professionnelles données par la "lex naturae" revêtant ainsi "l'aspect proprement objectif et impersonnel d'un service effectué dans l'organisation rationnelle de l'univers social qui nous entoure." C'est d'ailleurs par la promotion de cette conception éthique dans le monde chrétien que le protestantisme a pu créer un contexte favorable au développement du capitalisme moderne.
Mais l'état d'esprit qui en est résulté, et qui s'est développé sans entraves aux Etats-Unis d'Amérique, paraît bien éloigné de toute sorte d'éthique. Comme l'a relevé Karl Marx à propos des "habitants religieux et politiquement libres de la Nouvelle Angleterre", "Mammon est leur idole qu'ils adorent non seulement des lèvres, mais de toutes les forces de leur corps et de leur esprit. La terre n'est à leurs yeux qu'une Bourse, et ils sont persuadés qu'il n'est ici-bas d'autre destinée que de devenir plus riches que leurs vo;sins".
Etudiant les liens qui existent entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante, Max Weber avait souligné la "bibliocratie" du calvinisme, qui tenait les principes moraux de l'Ancien Testament dans la même estime que ceux du Nouveau, l'utilitarisme de l'éthique protestante rejoignant l'utilitarisme du judaïsme. Avant lui, Marx avait d'ailleurs déjà relevé les affinités qui existent entre l'esprit du capitalisme et le judaïsme même si cette analyse était peu conforme aux principes du matérialisme historique. Considérant que "le fond profane du judaïsme" c'est "le besoin pratique, l'utilité personnelle", Marx estimait ainsi que, grâce aux Juifs et par les Juifs, "l'argent est devenu une puissance mondiale et l'esprit pratique des Juifs, l'esprit pratique des peuples chrétiens", concluant que "les Juifs se sont émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus Juifs".
Ignorant délibérément la complexité des origines de l'idéologie socialiste, Berdiaev privilégiait quant à lui les affinités entre socialisme et judaïsme. Selon Berdiaev, le socialisme constitue en effet une "manifestation du judaïsme en terreau chrétien", et "la confusion et l'identification du christianisme avec le socialisme, avec le royaume et le confort terrestre sont dues à une flambée d'apocalyptique hébraïque", au "chiliasme hébreu, qui espère le Royaume de Dieu ici-bas" et "il n'était pas fortuit que Marx fût juif" . Cioran rejoint sur ce point Berdiaev lorsqu'il écrit : "Quand le Christ assurait que le "royaume de Dieu" n'était ni "ici ni "là", mais au-dedans de nous, il condamnait d'avance les constructions utopiques pour lesquelles tout "royaume" est nécessairement extérieur, sans rapport aucun avec notre moi profond ou notre salut individuel. 5
De différents points de vue, capitalisme libéral et socialisme moderne paraissent ainsi liés, non seulement au plan historique, mais également par leurs racines idéologiques, et ce n'est probablement pas un hasard si leur émergence a coïncidé avec l'effondrement du système de valeurs qui, pendant des siècles, avait prévalu en Europe, et qui affirmait, du moins dans son principe originel, la primauté de l'autorité spirituelle sur le pouvoir temporel, et la subordination de la fonction économique au pouvoir temporel.
L'écroulement des régimes marxistes, incapables d'atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, n'aura donc pas changé fondamentalement le cours de l'Histoire, puisque la "Weltanschauung" commune au marxisme et au capitalisme continue toujours à constituer le point de référence de nos sociétés. Se trouvent en effet toujours mis au premier plan : le matérialisme philosophique et pratique, le règne sans partage de l'économie, l'égalitarisme idéologique (qui se conjugue curieusement avec l'extension des inégalités sociales), la destruction des valeurs familiales et communautaires, la collectivisation des modes de vie et le mondialisme. C'est peut-être d'ailleurs ce qui permet d'expliquer pourquoi les socialistes occidentaux et la majeure partie des marxistes de l'Est se sont aussi facilement convertis au capitalisme libéral, qui paraît aujourd'hui le mieux à même de réaliser leur idéal.
Mais la chute des régimes marxistes a l'Est nombre de valeurs qui, bien qu'ayant été niées pendant des décennies, n'avaient pu être détruites. On voit ainsi, dans des sociétés en pleine décomposition qui redécouvrent les réalités d'un capitalisme sauvage, s'affirmer à nouveau religions, nations et traditions.
Toutes ces valeurs qui refont surface, et dont l'affirmation avait été jugée utile par les Etats occidentaux, dans la mesure où elle pouvait contribuer au renversement des régimes marxistes, sont toutefois loin d'être vues avec la même complaisance dès lors que cet objectif a été atteint.
L'idéologie matérialiste des sociétés occidentales s'accommode en effet assez mal de tout système de valeurs qui met en question sa prétention à l'universalité et qui n'est pas inconditionnellement soumis aux impératifs du marché mondial. Tout véritable réveil religieux, toute affirmation nationale ou communautaire, ou toute revendication écologiste ne peuvent ainsi être perc,us que comme autant d'obstacles à la domination sans partage des valeurs marchandes, obstacles qu'il s'agit d'abattre ou de contourner.
Ainsi, l'établissement d'un véritable marché mondial qui puisse permettre aux stratégies des multinationales de se développer sans entraves étant devenu l'objectif prioritaire, des pressions sont exercées au sein du GATT - par le lobby américain - pour que les pays d'Europe acceptent le démantèlement de leur agriculture, quelles que puissent en être les conséquences sur l'équilibre démographique et social de ces pays, sur l'enracinement de leur identité nationale et sur leur équilibre écologique.
De même, les cultures et les langues nationales doivent de plus en plus se plier aux lois du marché mondial et céder le pas à des "produits culturels" standardisés de niveau médiocre, utilisant le "basic English" comme langue véhiculaire, et aptes ainsi à satisfaire le plus grand nombre de consommateurs du plus grand nombre de pays. Quant aux religions, elles ne sont tolérées gue dans la mesure où elles délivrent un message compatible avec l'idéologie du capitalisme libéral, et si elles s'accommodent avec les orientations fondamentales de la société permissive, qui ne sont en fait que l'application, au domaine des moeurs, des principes du libre-échange.
L'écologie, enfin, n'est prise en compte que si elle ne s'affirme pas comme une idéologie ayant la prétention d'imposer des limites à la libre entreprise. Les valeurs néo-païennes qu'elle véhicule (que le veuillent ou non ses adeptes) sont par ailleurs vivement dénoncées. Ainsi, Alfred Grosser se plaît à relever que "ce n'est pas un hasard si l'écologie a démarré si fort en Allemagne où la nature ("die Natur") tient une place tout autre qu'en France. La forêt ("der Wald") y est fortement chargée de symbole. La tradition allemande ... c'est l'homme mêlé, confondu à la nature". Ne reculant pas devant les amalgames les plus grossiers, il n'hésite pas à écrire : "La liaison entre les hommes et la nature, le sol et le sang, cette solide tradition conservatrice allemande a été reprise récemment par Valéry Giscard d'Estaing à propos des immigrés. C'était la théorie d'Hitler;". Et Grosser de conclure avec autant de naïveté que de grandiloquence : "La grandeur de la civilisation judéo-chrétienne est d'avoir forgé un homme non soumis à la nature".
L'idéologie capitaliste libérale, actuellement dominante, entre ainsi en conflit avec d'autres ordres de valeur, et ces nouveau~ conflits, dont nous ne voyons que les prémisses, pourraient bien reléguer au rang des utopies la croyance en une "fin de l'histoire". En effet, ces conflits n'opposent plus, comme c'était le cas depuis deux siècles, deux idéologies jumelles qui, tout en se combattant, partaqeaient pour l'essentiel les mêmes idéaux fondamentaux et ne s'opposaient que sur les moyens de les réaliser. Les sociétés fondées sur le capitalisme libéral vont en effet avoir désormais à affronter des adversaires dont l'idéologie est irréductible à une vision purement économiste du monde. L'antithèse fondamentale ne se situe pas en effet entre capitalisme et marxisme, mais entre un système où l'économie est souveraine, quelle que soit sa forme, et un système où elle se trouve subordonnée à des facteurs extra-économiques.
On voit ainsi reparaître l'idée d'une hiérarchie des valeurs qui n'est pas sans analogies avec l'idéologie des peuples indo-européens et celle de l'Europe médiévale, où la fonction économique, et notamment les valeurs marchandes, occupait un rang subordonné aux valeurs spirituelles et au pouvoir politique (au sens originel de pouvoir régulateur de la vie sociale et des fonctions économiques). Bien que, dans cet ordre ancien, la dignité de la fonction de production des biens matériels fût généralement reconnue , il était toutefois exclu que les détenteurs de cette fonction puissent usurper des compétences pour l'exercice desquelles ils n'avaient aucune qualification. L'économie se trouvait ainsi incorporée dans un système qui ne considérait pas l'homme uniquement comme producteur ou consommateur, et l'organisation corporative des professions mettait beaucoup plus l'accent sur l'aspect qualitatif du travail que sur l'aspect quantitatif de la production, donnant une dimension spirituelle à l'accomplissement de toutes les tâches, même des plus humbles. Quant à la spéculation, au profit détaché de tout travail productif, ils n'étaient non seulement pas valorisés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils étaient profondément méprisés, tant par la noblesse que par le peuple, et ceux qui s'y adonnaient étaient généralement considérés comme des parias.
Ce n'est en fait que depuis deux siècles que les valeurs marchandes ont pris une place prépondérante dans la société occidentale, et que s'est instituée cette véritable subversion que Roger Garaudy qualifie de "monothéisme du marché, c'est-à-dire de l'argent, inhérent à toute société dont le seul régulateur est la concurrence, une guerre de tous contre tous". Un champion de l'ultra-libéralisme, comme Hayek, reconnaît d'ailleurs lui-même que "le concept de justice sociale est totalement vide de sens dans une économie de marché".
Cette subversion des valeurs est particulièrement sensible dans le capitalisme de type anglo-saxon que Michel Albert oppose au capitalisme de type rhénan ou nippon : le premier pariant sur le profit à court terme, négligeant outrancièrement les secteurs non-marchands de la société, l'éducation et la formation des hommes, et préférant les spéculations en bourse à la patience du capitaine d'industrie ou de l'ingénieur qui construisent et consolident jour après jour une structure industrielle; le second planifiant à long terme, respectant davantage les secteurs non-marchands, accordant de l'importance à l'éducation et à la formation et se fondant sur le développement des structures industrielles plutôt que sur les spéculations boursières.
Il est d'ailleurs intéressant de relever gue c'est le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui conserve un certain nombre de valeurs des sociétés pré-industrielles et s'enracine dans une communauté ethno-culturelle, qui se révèle être plus performant que le capitalisme de type anglo-saxon, qui ne reconnaît pas d'autres valeurs que les valeurs marchandes, même s'il aime souvent se draper dans les plis de la morale et de la religion.
Mais le meileur équilibre auquel sont parvenues les sociétés où règne un capitalisme de type rhénan ou nippon n'en demeure pas moins fragile, et ces sociétés sont loin d'être exemptes des tares inhérentes à toutes les formes de capitalisme libéral. On peut d'ailleurs se demander si le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui s'appuie sur les restes de structures traditionnelles, n'est pas condamné à disparaître par la logique même du capitalisme libéral qui finira par en détruire les fondements dans le cadre d'un marché mondial.
Par delà ces oppositions de nature éphémère qui existent au sein du capitalisme libéral, la question est finalement de savoir si celui-ci parviendra à établir de manière durable son pouvoir absolu et universel, marquant ainsi en quelque sorte la fin de l'histoire, ou s'il subira, à plus ou moins longue échéance, un sort analogue à celui de marxisme. En d'autres termes, une société ne se rattachant plus à aucun principe d'ordre supérieur et dénuée de tout lien communautaire est-elle viable, ou cette tentative de réduire l'homme aux simples fonctions de producteur et de consommateur, sans dimension spirituelle et sans racines, est-elle condamnée à l'échec, disqualifiant par là-même l'idéologie (ou plutôt l'anti-idéologie) sur laquelle elle était fondée?
Pierre Maugué
Novembre 1992
NOTES
1) Cf. Martin Heideqger, "Introduction à la métaphysique", page 56, Gallimard, Paris 1967.
2) Cf. Werner Sombart, "Le Socialisme allemand", Editions Pardès, 45390 Puiseaux.
3) Cf. Karl Marx, "Le manifeste communiste" in "oeuvres complètes", La Pléïade, Gallimard, Paris 1963.
4) René Guénon fait la même constatation gue Rarl Marx, mais, loin d'y voir l'annonce d'un monde nouveau, supérieur à l'ancien, il y voit au contraire une déchéance, la fin d'un cycle. Il relève ainsi que "partout dans le monde occidental, la bourgeoisie est parvenue à s'emparer du pouvoir", que le résultat en est "le triomphe de l'économique, sa suprématie proclamée ouvertement" et qu'"à mesure qu'on s'enfonce dans la matérialité, l'instabilité s'accroît, les changements se produisent de plus en plus rapidement". Cf. René Guénon, "Autorité spirituelle et pouvoir temporel", page 91, Les Editions Vega, Paris, 1964.
5) Cf. André Siegfried, "Les Etats-Unis d'aujourd'hui", pages 346, 349
et 350, Paris 1927.
6) Cf. Lénine, "Oeuvres", tome 22, page 159, Editions sociales, Paris 1960.
7) Comme le relève Régis Debray, "Nous avions eu Dieu, la Raison, la Nation, le Progrès, le Prolétariat. Il fallait aux sauveteurs un radeau de sauvetage. Voilà donc pour les aventuriers de l'Arche Perdue, les Droits de l'Homme come progressisme de substitution. Cf. Régis Debray, "Que vive la République", Editions Odile Jacob, Paris 1989.
8) Cf. Nicolas Berdiaev, "De l'inégalité", pages 150 et 152, Editions l'Age
d'Homme, Genève 1976.
9) Cf. Nicolas Berdiaev, op. cité, page 150. Dans le style qui lui est propre, Louis-Ferdinand Céline avait relevé la même analogie entre esprit bourgeois et esprit prolétaire. "Vous ne rêvez que d'être lui, à sa place, rien d'autre, être lui, le Bourgeois! encore plus que lui, toujours plus bourgeois! C'est tout. L'idéal ouvrier c'est deux fois plus de jouissances bourgeoises pur lui tout seul. Une super bourgeoisie encore plus tripailleuse, plus motorisée, beaucoup plus avantageuse, plus dédaigneuse, plus conservatrice, plus idiote, plus hypocrite, plus stérile que l'espèce actuelle". Cf. Louis-Ferdinand-Céline, "L'école des cadavres", Editions Denoël, Paris.
10) Cf. Max Weber, "L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme", page 129, Librairie Plon, Paris 1964.
11) Cf. Max Weber, op cité, pages 128 et 129.
12) Cf. Rarl Marx, "La question juive", pages 50 et 55, collection 10/18, Union générale d'éditions, Paris 1968.
13) Cf. Karl Marx, op cité, pages 49 et 50.
14) Cf. Nicolas Berdiaev, op cité, page 154
15) Cf. Cioran, "Histoire et Utopie", Gallimard, Paris 1960.
16) C'est ainsi que le modèle de la société libérale avancée, qui s'est imposé en Occident, correspond parfaitement à certains objectifs qu'Engels avait fixés au 21e point de son avant-projet pour le Manifeste du Parti communiste. Il écrivait ainsi : "(L'avènement du communisme) transformera les rapports entre les sexes en rapport purement privés, ne concernant que les personnes qui y participent et où la société n'aura pas à intervenir. Cette transformation sera possible du moment que ... les enfants seront élevés en commun, et que seront détruites les deux bases principales du mariage actuel, à savoir la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme, et celle des enfants vis-à-vis des parents".
17) Cf. Alfred Grosser, interview paru dans "Le Nouveau Quotidien" (Lausanne) du vendredi 24 janvier 1992 sous le titre : "Après le dieu Lénine des communistes, voici la déesse Gaia des écologistes".
18) Dans l'Inde traditionnelle, les "vaishya", représentants de la troisième fonction, ont la qualité d'"arya". Toutefois, dans le monde méditerranéen, chez les Romains et les Grecs de l'époque classique, on constate une dépréciation du travail manuel, qui n'existe pas en revanche dans les sociétés celtiques et germaniques, où l'esclavage tenait une place beaucoup moins importante.
19) Cf. Roger Garaudy "Algérie, un nouvel avertissement pour l'Europe", in "Nationalisme et République", No 7.
20) Cf. Michel Albert, "Capitalisme contre capitalisme", Editions du Seuil, collection "L'histoire immédiate", Paris 1991.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philosophie, socialisme, libéralisme, capitalisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 janvier 2010
Entretien avec Günter Maschke
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
 Entretien avec Günter Maschke
Entretien avec Günter Maschke
propos recueillis par Dieter STEIN et Jürgen LANTER
Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?
Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?
GM: Oui. Car cette loi fondamentale (Grundgesetz) est pour une moitié un octroi, pour une autre moitié la production juridique de ceux qui collaborent avec les vainqueurs. On pourrait dire que cette constitution est un octroi que nous nous sommes donné à nous-mêmes. Les meilleurs liens qui entravent l'Allemagne sont ceux que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes.
Q.: Mais dans le débat qui a lieu aujourd'hui à propos de cette constitution, vous la défendez...
GM: Oui, nous devons défendre la loi fondamentale, la constitution existante car s'il fallait en créer une nouvelle, elle serait pire, du fait que notre peuple est complètement «rééduqué» et de ce fait, choisirait le pire. Toute nouvelle constitution, surtout si le peuple en débat, comme le souhaitent aussi bon nombre d'hommes de droite, connaîtrait une inflation de droits sociaux, un gonflement purement quantitatif des droits fondamentaux, et conduirait à la destruction des prérogatives minimales qui reviennent normalement à l'Etat national.
Q.: Donc, quelque chose de fondamental a changé depuis 1986, où vous écriviez dans votre article «Die Verschwörung des Flakhelfer» (= La conjuration des auxiliaires de la DCA; ndlr: mobilisés à partir de 1944, les jeunes hommes de 14 à 17 ans devaient servir les batteries de DCA dans les villes allemandes; c'est au sein de cette classe d'âge que se sont développées, pour la première fois en Allemagne, certaines modes américaines de nature individualiste, telles que l'engouement pour le jazz, pour les mouvements swing et zazou; c'est évidemment cette classe d'âge-là qui tient les rênes du pouvoir dans la RFA actuelle; en parlant de conjuration des auxiliaires de la DCA, G. Maschke entendait stigmatiser la propension à aduler tout ce qui est américain de même que la rupture avec toutes les traditions politiques et culturelles européennes). Dans cet article aux accents pamphlétaires, vous écriviez que la Constitution était une prison de laquelle il fallait s'échapper...
GM: Vu la dégénérescence du peuple allemand, nous devons partir du principe que toute nouvelle constitution serait pire que celle qui existe actuellement. Les rapports de force sont clairs et le resteraient: nous devrions donc nous débarrasser d'abord de cette nouvelle constitution, si elle en venait à exister. En disant cela, je me doute bien que j'étonne les «nationaux»...
Q.: Depuis le 9 novembre 1989, jour où le Mur est tombé, et depuis le 3 octobre 1990, jour officiel de la réunification, dans quelle mesure la situation a-t-elle changé?
GM: D'abord, je dirais que la servilité des Allemands à l'égard des puissances étrangères s'est encore accrue. Ma thèse a toujours été la suivante: rien, dans cette réunification, ne pouvait effrayer la France ou l'Angleterre. Comme nous sommes devenus terriblement grands, nous sommes bien décidés, désormais, à prouver, par tous les moyens et dans des circonstances plus critiques, notre bonne nature bien inoffensive. L'argumentaire développé par le camp national ou par les établis qui ont encore un petit sens de la Nation s'est estompé; il ne s'est nullement renforcé. Nous tranquilisons le monde entier, en lui disant qu'il s'agit du processus d'unification européenne qui est en cours et que l'unité allemande n'en est qu'une facette, une étape. Si d'aventure on rendait aux Allemands les territoires de l'Est (englobés dans la Pologne ou l'URSS), l'Autriche ou le Tyrol du Sud, ces braves Teutons n'oseraient même plus respirer; ainsi, à la joie du monde entier, la question allemande serait enfin réglée. Mais trêve de plaisanterie... L'enjeu, la Guerre du Golfe nous l'a montré. Le gouvernement fédéral a payé vite, sans sourciller, pour la guerre des Alliés qui, soit dit en passant, a eu pour résultat de maintenir leur domination sur l'Allemagne. Ce gouvernement n'a pas osé exiger une augmentation des impôts pour améliorer le sort de nos propres compatriotes de l'ex-RDA, mais lorsqu'a éclaté la guerre du Golfe, il a immédiatement imposé une augmentation et a soutenu une action militaire qui a fait passer un peu plus de 100.000 Irakiens de vie à trépas. Admettons que la guerre du Golfe a servi de prétexte pour faire passer une nécessaire augmentation des impôts. Il n'empêche que le procédé, que ce type de justification, dévoile la déchéance morale de nos milieux officiels. Pas d'augmentation des impôts pour l'Allemagne centrale, mais une augmentation pour permettre aux Américains de massacrer les Irakiens qui ne nous menaçaient nullement. Je ne trouve pas de mots assez durs pour dénoncer cette aberration, même si je stigmatise très souvent les hypocrisies à connotations humanistes qui conduisent à l'inhumanité. Je préfère les discours non humanistes qui ne conduisent pas à l'inhumanité.
Q.: Comment le gouvernement fédéral aurait-il dû agir?
GM: Il avait deux possibilités, qui peuvent sembler contradictoires à première vue. J'aime toujours paraphraser Charles Maurras et dire «La nation d'abord!». Première possibilité: nous aurions dû participer à la guerre avec un fort contingent, si possible un contingent quantitativement supérieur à celui des Britanniques, mais exclusivement avec des troupes terrestres, car, nous Allemands, savons trop bien ce qu'est la guerre aérienne. Nous aurions alors dû lier cet engagement à plusieurs conditions: avoir un siège dans le Conseil de Sécurité, faire supprimer les clauses des Nations Unies qui font toujours de nous «une nation ennemie», faire en sorte que le traité nous interdisant de posséder des armes nucléaires soit rendu caduc. Il y a au moins certains indices qui nous font croire que les Etats-Unis auraient accepté ces conditions. Deuxième possibilité: nous aurions dû refuser catégoriquement de nous impliquer dans cette guerre, de quelque façon que ce soit; nous aurions dû agir au sein de l'ONU, surtout au moment où elle était encore réticente, et faire avancer les choses de façon telle, que nous aurions déclenché un conflit de grande envergure avec les Etats-Unis. Ces deux scénarios n'apparaissent fantasques que parce que notre dégénérescence nationale et politique est désormais sans limites.
Q.: Mais la bombe atomique ne jette-t-elle pas un discrédit définitif sur le phénomène de la guerre?
GM: Non. Le vrai problème est celui de sa localisation. Nous n'allons pas revenir, bien sûr, à une conception merveilleuse de la guerre limitée, de la guerre sur mesure. Il n'empêche que le phénomène de la guerre doit être accepté en tant que régulateur de tout statu quo devenu inacceptable. Sinon, devant toute crise semblable à celle du Koweit, nous devrons nous poser la question: devons-nous répéter ou non l'action que nous avons entreprise dans le Golfe? Alors, si nous la répétons effectivement, nous créons de facto une situation où plus aucun droit des gens n'est en vigueur, c'est-à-dire où seule une grande puissance exécute ses plans de guerre sans égard pour personne et impose au reste du monde ses intérêts particuliers. Or comme toute action contre une grande puissance s'avère impossible, nous aurions en effet un nouvel ordre mondial, centré sur la grande puissance dominante. Et si nous ne répétons pas l'action ou si nous introduisons dans la pratique politique un «double critère» (nous intervenons contre l'Irak mais non contre Israël), alors le nouveau droit des gens, expression du nouvel ordre envisagé, échouera comme a échoué le droit des gens imposé par Genève jadis. S'il n'y a plus assez de possibilités pour faire accepter une mutation pacifique, pour amorcer une révision générale des traités, alors nous devons accepter la guerre, par nécessité. J'ajouterais en passant que toute la Guerre du Golfe a été une provocation, car, depuis 1988, le Koweit menait une guerre froide et une guerre économique contre l'Irak, avec l'encouragement des Américains.
Q.: L'Allemagne est-elle incapable, aujourd'hui, de mener une politique extérieure cohérente?
GM: A chaque occasion qui se présentera sur la scène de la grande politique, on verra que non seulement nous sommes incapables de mener une opération, quelle qu'elle soit, mais, pire, que nous ne le voulons pas.
Q.: Pourquoi?
GM: Parce qu'il y a le problème de la culpabilité, et celui du refoulement: nous avons refoulé nos instincts politiques profonds et naturels. Tant que ce refoulement et cette culpabilité seront là, tant que leurs retombées concrètes ne seront pas définitivement éliminées, il ne pourra pas y avoir de politique allemande.
Q.: Donc l'Allemagne ne cesse de capituler sur tous les fronts...
GM: Oui. Et cela appelle une autre question: sur les monuments aux morts de l'avenir, inscrira-t-on «ils sont tombés pour que soit imposée la résolution 1786 de l'ONU»? Au printemps de cette année 1991, on pouvait repérer deux formes de lâcheté en Allemagne. Il y avait la lâcheté de ceux qui, en toutes circonstances, hissent toujours le drapeau blanc. Et il y avait aussi la servilité de la CSU qui disait: «nous devons combattre aux côtés de nos amis!». C'était une servilité machiste qui, inconditionnellement, voulait que nous exécutions les caprices de nos pseudo-amis.
Q.: Sur le plan de la politique intérieure, qui sont les vainqueurs et qui sont les perdants du débat sur la Guerre du Golfe?
GM: Le vainqueur est inconstestablement la gauche, style UNESCO. Celle qui n'a que les droits de l'homme à la bouche, etc. et estime que ce discours exprime les plus hautes valeurs de l'humanité. Mais il est une question que ces braves gens ne se posent pas: QUI décide de l'interprétation de ces droits et de ces valeurs? QUI va les imposer au monde? La réponse est simple: dans le doute, ce sera toujours la puissance la plus puissante. Alors, bonjour le droit du plus fort! Les droits de l'homme, récemment, ont servi de levier pour faire basculer le socialisme. A ce moment-là, la gauche protestait encore. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme servent à fractionner, à diviser les grands espaces qui recherchent leur unité, où à détruire des Etats qui refusent l'alignement, où, plus simplement, pour empêcher certains Etats de fonctionner normalement.
Q.: Que pensez-vous du pluralisme?
GM: Chez nous, on entend, par «pluralisme», un mode de fonctionnement politique qui subsiste encore ci et là à grand peine. On prétend que le pluralisme, ce sont des camps politiques, opposés sur le plan de leurs Weltanschauungen, qui règlent leurs différends en négociant des compromis. Or la RFA, si l'on fait abstraction des nouveaux Länder d'Allemagne centrale, est un pays idéologiquement arasé. Les oppositions d'ordre confessionnel ne constituent plus un facteur; les partis ne sont plus des «armées» et n'exigent plus de leurs membres qu'ils s'engagent totalement, comme du temps de la République de Weimar. A cette époque, comme nous l'enseigne Carl Schmitt, les «totalités parcellisées» se juxtaposaient. On naissait quasiment communiste, catholique du Zentrum, social-démocrate, etc. On passait sa jeunesse dans le mouvement de jeunesse du parti, on s'affiliait à son association sportive et, au bout du rouleau, on était enterré grâce à la caisse d'allocation-décès que les coreligionnaires avaient fondée... Ce pluralisme, qui méritait bien son nom, n'existe plus. Chez nous, aujourd'hui, ce qui domine, c'est une mise-au-pas intérieure complète, où, pour faire bonne mesure, on laisse subsister de petites différences mineures. Les bonnes consciences se réjouissent de cette situation: elles estiment que la RFA a résolu l'énigme de l'histoire. C'est là notre nouveau wilhelminisme: «on y est arrivé, hourra!»; nous avons tiré les leçons des erreurs de nos grands-pères. Voilà le consensus et nous, qui étions, paraît-il, un peuple de héros (Helden), sommes devenus de véritables marchands (Händler), pacifiques, amoureux de l'argent et roublards. Qui plus est, la fourchette de ce qui peut être dit et pensé sans encourir de sanctions s'est réduite continuellement depuis les années 50. Je vous rappellerais qu'en 1955 paraissait, dans une grande maison d'édition, la Deutsche Verlags-Anstalt, un livre de Wilfried Martini, Das Ende aller Sicherheit, l'une des critiques les plus pertinentes de la démocratie parlementaire. Ce livre, aujourd'hui, ne pourrait plus paraître que chez un éditeur ultra-snob ou dans une maison minuscule d'obédience extrême-droitiste. Cela prouve bien que l'espace de liberté intellectuelle qui nous reste se rétrécit comme une peau de chagrin. Les critiques du système, de la trempe d'un Martini, ont été sans cesse refoulés, houspillés dans les feuilles les plus obscures ou les cénacles les plus sombres: une fatalité pour l'intelligence! L'Allemagne centrale, l'ex-RDA, ne nous apportera aucun renouveau spirituel. Les intellectuels de ces provinces-là sont en grande majorité des adeptes extatiques de l'idéologie libérale de gauche, du pacifisme et de la panacée «droit-de-l'hommarde». Ils n'ont conservé de l'idéologie officielle de la SED (le parti au pouvoir) que le miel humaniste: ils ne veulent plus entendre parler d'inimitié (au sens schmittien), de conflit, d'agonalité, et fourrent leur nez dans les bouquins indigestes et abscons de Sternberger et de Habermas. Mesurez le désastre: les 40 ans d'oppression SED n'ont même pas eu l'effet d'accroître l'intelligence des oppressés!
Q.: Mais les Allemands des Länder centraux vont-ils comprendre le langage de la rééducation que nous maîtrisons si bien?
GM: Ils sont déjà en train de l'apprendre! Mais ce qui est important, c'est de savoir repérer ce qui se passe derrière les affects qu'ils veulent bien montrer. Savoir si quelque chose changera grâce au nouveau mélange inter-allemand. Bien peu de choses se dessinent à l'horizon. Mais c'est également une question qui relève de l'achèvement du processus de réunification, de l'harmonisation économique, de savoir quand et comment elle réussira. A ce moment-là, l'Allemagne pourra vraiment se demander si elle pourra jouer un rôle politique et non plus se borner à suivre les Alliés comme un toutou. Quant à la classe politique de Bonn, elle espère pouvoir échapper au destin grâce à l'unification européenne. L'absorption de l'Allemagne dans le tout européen: voilà ce qui devrait nous libérer de la grande politique. Mais cette Europe ne fonctionnera pas car tout ce qui était «faisable» au niveau européen a déjà été fait depuis longtemps. La construction du marché intérieur est un bricolage qui n'a ni queue ni tête. Prenons un exemple: qui décidera demain s'il faut ou non proclamer l'état d'urgence en Grèce? Une majorité rendue possible par les voix de quelques députés écossais ou belges? Vouloir mener une politique supra-nationale en conservant des Etats nationaux consolidés est une impossibilité qui divisera les Européens plutôt que de les unir.
Q.: Comment jugez-vous le monde du conservatisme, de la droite, en Allemagne? Sont-ils les moteurs des processus dominants ou ne sont-ils que des romantiques qui claudiquent derrière les événements?
GM: Depuis 1789, le monde évolue vers la gauche, c'est la force des choses. Le national-socialisme et le fascisme étaient, eux aussi, des mouvements de gauche (j'émets là une idée qui n'est pas originale du tout). Le conservateur, le droitier —je joue ici au terrible simplificateur— est l'homme du moindre mal. Il suit Bismarck, Hitler, puis Adenauer, puis Kohl. Et ainsi de suite, usque ad finem. Je ne suis pas un conservateur, un homme de droite. Car le problème est ailleurs: il importe bien plutôt de savoir comment, à quel moment et qui l'on «maintient». Ce qui m'intéresse, c'est le «mainteneur», l'Aufhalter, le Cat-echon dont parlait si souvent Carl Schmitt. Hegel et Savigny étaient des Aufhalter de ce type; en politique, nous avons eu Napoléon III et Bismarck. L'idée de maintenir, de contenir le flot révolutionnaire/dissolutif, m'apparait bien plus intéressante que toutes les belles idées de nos braves conservateurs droitiers, si soucieux de leur Bildung. L'Aufhalter est un pessimiste qui passe à l'action. Lui, au moins, veut agir. Le conservateur droitier ouest-allemand, veut-il agir? Moi, je dis que non!
Q.: Quelles sont les principales erreurs des hommes de droite allemands?
GM: Leur grande erreur, c'est leur rousseauisme, qui, finalement, n'est pas tellement éloigné du rousseauisme de la gauche. C'est la croyance que le peuple est naturellement bon et que le magistrat est corruptible. C'est le discours qui veut que le peuple soit manipulé par les politiciens qui l'oppressent. En vérité, nous avons la démocratie totale: voilà notre misère! Nous avons aujourd'hui, en Allemagne, un système où, en haut, règne la même morale ou a-morale qu'en bas. Seule différence: la place de la virgule sur le compte en banque; un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Pour tout ordre politique qui mérite d'être qualifié d'«ordre», il est normal qu'en haut, on puisse faire certaines choses qu'il n'est pas permis de faire en bas. Et inversément: ceux qui sont en haut ne peuvent pas faire certaines choses que peuvent faire ceux qui sont en bas. On s'insurge contre le financement des partis, les mensonges des politiciens, leur corruption, etc. Mais le mensonge et la corruption, c'est désormais un sport que pratique tout le peuple. Pas à pas, la RFA devient un pays orientalisé, parce que les structures de l'Etat fonctionnent de moins en moins correctement, parce qu'il n'y a plus d'éthique politique, de Staatsethos, y compris dans les hautes sphères de la bureaucratie. La démocratie accomplie, c'est l'universalisation de l'esprit du p'tit cochon roublard, le règne universel des petits malins. C'est précisément ce que nous subissons aujourd'hui. C'est pourquoi le mécontentement à l'égard de la classe politicienne s'estompe toujours aussi rapidement: les gens devinent qu'ils agiraient exactement de la même façon. Pourquoi, dès lors, les politiciens seraient-ils meilleurs qu'eux-mêmes? Il faudrait un jour examiner dans quelle mesure le mépris à l'égard du politicien n'est pas l'envers d'un mépris que l'on cultive trop souvent à l'égard de soi-même et qui s'accommode parfaitement de toutes nos petites prétentions, de notre volonté générale à vouloir rouler autrui dans la farine, etc.
Q.: Et le libéralisme?
GM: Dans les années qui arrivent, des crises toujours plus importantes secoueront la planète, le pays et le concert international. Le libéralisme y rencontrera ses limites. La prochaine grande crise sera celle du libéralisme. Aujourd'hui, il triomphe, se croit invincible, mais demain, soyez en sûr, il tombera dans la boue pour ne plus se relever.
Q.: Pourquoi?
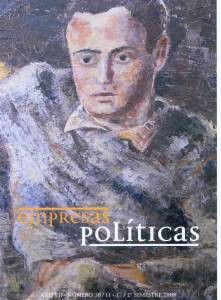 GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.
GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.
Q.: Vous croyez donc que les choses ne changent qu'à coup de catastrophes?
GM: C'est exact. Seules les catastrophes font que le monde change. Ceci dit, les catastrophes ne garantissent pas pour autant que les peuples modifient de fond en comble leurs modes de penser déficitaires. Depuis des années, nous savions, ou du moins nous étions en mesure de savoir, ce qui allait se passer si l'Europe continuait à être envahie en masse par des individus étrangers à notre espace, provenant de cultures radicalement autres par rapport aux nôtres. Le problème devient particulièrement aigu en Allemagne et en France. Quand nous aurons le «marché intérieur», il deviendra plus aigu encore. Or à toute politique rationnelle, on met des bâtons dans les roues en invoquant les droits de l'homme, etc. Ceci n'est qu'un exemple pour montrer que le fossé se creusera toujours davantage entre la capacité des uns à prévoir et la promptitude des autres à agir en conséquence.
Q.: Ne vous faites-vous pas d'illusions sur la durée que peuvent prendre de tels processus? Au début des années 70, on a pronostiqué la fin de l'ère industrielle; or, des catastrophes comme celles de Tchernobyl n'ont eu pour conséquence qu'un accroissement générale de l'efficience industrielle. Même les Verts pratiquent aujourd'hui une politique industrielle. Ne croyez-vous pas que le libéralisme s'est montré plus résistant et innovateur qu'on ne l'avait cru?
GM: «Libéralisme» est un mot qui recouvre beaucoup de choses et dont la signification ne s'étend pas à la seule politique industrielle. Mais, même en restant à ce niveau de politique industrielle, je resterai critique à l'égard du libéralisme. Partout, on cherche le salut dans la «dé-régulation». Quelles en sont les conséquences? Elles sont patentes dans le tiers-monde. Pour passer à un autre plan, je m'étonne toujours que la droite reproche au libéralisme d'être inoffensif et inefficace, alors qu'elle est toujours vaincue par lui. On oublie trop souvent que le libéralisme est aussi ou peut être un système de domination qui fonctionne très bien, à la condition, bien sûr, que l'on ne prenne pas ses impératifs au sérieux. C'est très clair dans les pays anglo-saxons, où l'on parle sans cesse de democracy ou de freedom, tout en pensant God's own country ou Britannia rules the waves. En Allemagne, le libéralisme a d'emblée des effets destructeurs et dissolutifs parce que nous prenons les idéologies au sérieux, nous en faisons les impératifs catégoriques de notre agir. C'est la raison pour laquelle les Alliés nous ont octroyé ce système après 1945: pour nous neutraliser.
Q.: Etes-vous un anti-démocrate,
Monsieur Maschke?
GM: Si l'on entend par «démocratie» la partitocratie existente, alors, oui, je suis anti-démocrate. Il n'y a aucun doute: ce système promeut l'ascension sociale de types humains de basse qualité, des types humains médiocres. A la rigueur, nous pourrions vivre sous ce système si, à l'instar des Anglo-Saxons ou, partiellement, des Français, nous l'appliquions ou l'instrumentalisions avec les réserves nécessaires, s'il y avait en Allemagne un «bloc d'idées incontestables», imperméable aux effets délétères du libéralisme idéologique et pratique, un «bloc» selon la définition du juriste français Maurice Hauriou. Evidemment, si l'on veut, les Allemands ont aujourd'hui un «bloc d'idées incontestables»: ce sont celles de la culpabilité, de la rééducation, du refoulement des acquis du passé. Mais contrairement au «bloc» défini par Hauriou, notre «bloc» est un «bloc» de faiblesses, d'éléments affaiblissants, incapacitants. La «raison d'Etat» réside chez nous dans ces faiblesses que nous cultivons jalousement, que nous conservons comme s'il s'agissait d'un Graal. Mais cette omniprésence de Hitler, cette fois comme croquemitaine, signifie que Hitler règne toujours sur l'Allemagne, parce que c'est lui, en tant que contre-exemple, qui détermine les règles de la politique. Je suis, moi, pour la suppression définitive du pouvoir hitlérien.
Q.: Vous êtes donc le seul véritable
anti-fasciste?
GM: Oui. Chez nous, la police ne peut pas être une police, l'armée ne peut pas être une armée, le supérieur hiérarchique ne peut pas être un supérieur hiérarchique, un Etat ne peut pas être un Etat, un ordre ne peut pas être un ordre, etc. Car tous les chemins mènent à Hitler. Cette obsession prend les formes les plus folles qui soient. Les spéculations des «rééducateurs» ont pris l'ampleur qu'elles ont parce qu'ils ont affirmé avec succès que Hitler résumait en sa personne tout ce qui relevait de l'Etat, de la Nation et de l'Autorité. Les conséquences, Arnold Gehlen les a résumées en une seule phrase: «A tout ce qui est encore debout, on extirpe la moëlle des os». Or, en réalité, le système mis sur pied par Hitler n'était pas un Etat mais une «anarchie autoritaire», une alliance de groupes ou de bandes qui n'ont jamais cessé de se combattre les uns les autres pendant les douze ans qu'a duré le national-socialisme. Hitler n'était pas un nationaliste, mais un impérialiste racialiste. Pour lui, la nation allemande était un instrument, un réservoir de chair à canon, comme le prouve son comportement du printemps 1945. Mais cette vision-là, bien réelle, de l'hitlérisme n'a pas la cote; c'est l'interprétation sélectivement colorée qui s'est imposée dans nos esprits; résultat: les notions d'Etat et de Nation peuvent être dénoncées de manière ininterrompue, détruites au nom de l'émancipation.
Q.: Voyez-vous un avenir pour la droite en Allemagne?
GM: Pas pour le moment.
Q.: A quoi cela est-il dû?
GM: Notamment parce que le niveau intellectuel de la droite allemande est misérable. Je n'ai jamais cessé de le constater. Avant, je prononçais souvent des conférences pour ce public; je voyais arriver 30 bonshommes, parmi lesquels un seul était lucide et les 29 autres, idiots. La plupart étaient tenaillés par des fantasmes ou des ressentiments. Ce public des cénacles de droite vous coupe tous vos effets. Ce ne sont pas des assemblées, soudées par une volonté commune, mais des poulaillers où s'agitent des individus qui se prétendent favorables à l'autorité mais qui, en réalité, sont des produits de l'éducation anti-autoritaire.
Q.: L'Amérique est-elle la cible principale
de l'anti-libéralisme?
GM: Deux fois en ce siècle, l'Amérique s'est dressée contre nous, a voulu détruire nos œuvres politiques, deux fois, elle nous a déclaré la guerre, nous a occupés et nous a rééduqués.
Q.: Mais l'anti-américanisme ne se déploie-t-il pas essentiellement au niveau «impolitique» des sentiments?
GM: L'Amérique est une puissance étrangère à notre espace, qui occupe l'Europe. Je suis insensible à ses séductions. Sa culture de masse a des effets désorientants. Certes, d'aucuns minimisent les effets de cette culture de masse, en croyant que tout style de vie n'est que convention, n'est qu'extériorité. Beaucoup le croient, ce qui prouve que le problème de la forme, problème essentiel, n'est plus compris. Et pas seulement en Allemagne.
Q.: Comment expliquez-vous la montée du néo-paganisme, au sein des droites, spécialement en Allemagne et en France?
GM: Cette montée s'explique par la crise du christianisme. En Allemagne, après 1918, le protestantisme s'est dissous; plus tard, à la suite de Vatican II dans les années 60, ça a été au tour du catholicisme. On interprète le problème du christianisme au départ du concept d'«humanité». Or le christianisme ne repose pas sur l'humanité mais sur l'amour de Dieu, l'amour porté à Dieu. Aujourd'hui, les théologiens progressistes attribuent au christianisme tout ce qu'il a jadis combattu: les droits de l'homme, la démocratie, l'amour du lointain (de l'exotique), l'affaiblissement de la nation. Pourtant, du christianisme véritable, on ne peut même pas déduire un refus de la politique de puissance. Il suffit de penser à l'époque baroque. De nos jours, nous trouvons des chrétiens qui jugent qu'il est très chrétien de rejetter la distinction entre l'ami et l'ennemi, alors qu'elle est induite par le péché originel, que les théologiens actuels cherchent à minimiser dans leurs interprétations. Mais seul Dieu peut lever cette distinction. Hernán Cortés et Francisco Pizarro savaient encore que c'était impossible, contrairement à nos évêques d'aujourd'hui, Lehmann et Kruse. Cortés et Pizarro étaient de meilleurs chrétiens que ces deux évêques. Le néo-paganisme a le vent en poupe à notre époque où la sécularisation s'accélére et où les églises elles-mêmes favorisent la dé-spiritualisation. Mais être païen, cela signifie aussi prier. Demandez donc à l'un ou l'autre de ces néo-païens s'il prie ou s'il croit à l'un ou l'autre dieu païen. Au fond, le néo-paganisme n'est qu'un travestissement actualisé de l'athéisme et de l'anticléricalisme. Pour moi, le néo-paganisme qui prétend revenir à nos racines est absurde. Nos racines se situent dans le christianisme et nous ne pouvons pas revenir 2000 ans en arrière.
Q.: Alors, le néo-paganisme,
de quoi est-il l'indice?
GM: Il est l'indice que nous vivons en décadence. Pour stigmatiser la décadence, notre époque a besoin d'un coupable et elle l'a trouvé dans le christianisme. Et cela dans un monde où les chrétiens sont devenus rarissimes! Le christianisme est coupable de la décadence, pensait Nietzsche, ce «fanfaron de l'intemporel» comme aimait à l'appeler Carl Schmitt. Nietzsche est bel et bien l'ancêtre spirituel de ces gens-là. Mais qu'entendait Nietzsche par christianisme? Le protestantisme culturel libéral, prusso-allemand. C'est-à-dire une idéologie qui n'existait pas en Italie et en France; aussi je ne saisis pas pourquoi tant de Français et d'Italiens se réclament de Nietzsche quand ils s'attaquent au christianisme.
Q.: Monsieur Maschke, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
(une version abrégée de cet entretien est parue dans Junge Freiheit n°6/91; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, entretien, réflexions personnelles, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 janvier 2010
Ende der Geschichtlichkeit
 Ende der Geschichtlichkeit
Ende der Geschichtlichkeit
Ernst Nolte, Brief an François Furet vom 11. Dezember 1996, in: "Feindliche Nähe". Kommunismus und Faschismus im 20. Jahrhundert. Ein Briefwechsel, München 1998.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, histoire, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 janvier 2010
Discrimineren: het mag!
Discrimineren: het mag!
 Naar aanleiding van de discussie tussen vakbonden en patroons over de verschillende ontslagregelingen die nu bestaan tussen arbeiders en bedienden, blijkt weer duidelijk dat non-discriminatie geen algemeen moreel begrip is dat binnen de elite wordt aangehouden, maar deel uitmaakt van een zeer selectief begrippen-arsenaal. Daar waar het gaat om discriminerende voorstellen die gastarbeiders en hun families zouden viseren is het andere koek. Dan zou de gerechtelijke en burgerlijke elite zeer principieel zijn in haar veroordeling. Dergelijke discriminaties, zelfs als ze vermeend zijn, moeten dan vlug verdwijnen. Het discrimineren van andere groepen (van het eigen volk) is echter courante praktijk binnen het kapitalisme. Zo kan een bediende tot 21 maanden vooropzeg krijgen, waar een arbeider slechts van een ontslagperiode die maximaal 52 dagen bedraagt kan genieten, ongeacht de periode die hij of zij heeft gewerkt.
Naar aanleiding van de discussie tussen vakbonden en patroons over de verschillende ontslagregelingen die nu bestaan tussen arbeiders en bedienden, blijkt weer duidelijk dat non-discriminatie geen algemeen moreel begrip is dat binnen de elite wordt aangehouden, maar deel uitmaakt van een zeer selectief begrippen-arsenaal. Daar waar het gaat om discriminerende voorstellen die gastarbeiders en hun families zouden viseren is het andere koek. Dan zou de gerechtelijke en burgerlijke elite zeer principieel zijn in haar veroordeling. Dergelijke discriminaties, zelfs als ze vermeend zijn, moeten dan vlug verdwijnen. Het discrimineren van andere groepen (van het eigen volk) is echter courante praktijk binnen het kapitalisme. Zo kan een bediende tot 21 maanden vooropzeg krijgen, waar een arbeider slechts van een ontslagperiode die maximaal 52 dagen bedraagt kan genieten, ongeacht de periode die hij of zij heeft gewerkt.
Omdat het hier gaat om kapitaalgerelateerde discriminatie (het kapitaal wil de goedkope ontslagregelingen voor arbeiders behouden) wordt niet te veel gegoocheld met het morele begrip "discriminatie". Men spreekt liever over "historisch-gegroeide onevenwichten" en zelf van een "arbeiderstraditie". En klassenverschillen kan men toch niet als discriminatie zien? Dat is niet moreel van aard, maar komt voort uit economische noodzaak. Als het op uitleggen aankomt, heeft de elite altijd wel een verhaaltje klaar om uit de mouw te schudden. De politieke en moreel-correcte bende van de liberaal-democratie zingt het liedje mee. En alsof het systeem van de verschillende afdankingsregelingen nog niet genoeg aan apartheidspraktijken doet denken, heeft de regering het bij gebrek aan consensus tussen vakbonden en patronaat nog een portie discriminatie toegevoegd. Deze keer wordt de discriminatie rechtstreeks door de politieke elite gepleegd.
Elke arbeider die zijn werk verliest, krijgt vanaf nu tot juni volgend jaar een bijkomende afdankingspremie van 1.666 euro bovenop de wettelijke ontslagvergoeding. Mooi, zou men denken. Het verzacht het ontslagtrauma en breekt het verzet. Als je de goede mensen die je werk afpakken, gaat beschuldigen wanneer ze je net 1.666 euro extra ontslagvergoeding gegeven hebben, dan moet je toch al een ondankbare kwast zijn. Dat is de redenering van het patronaat en de politieke elite. Maar als u denkt dat iedereen zoveel geluk heeft, dan bent u mis. Want in dit land betekent elke arbeider niet noodzakelijk alle arbeiders. Arbeiders die in bedrijven werken van minder dan tien werknemers zijn uitgesloten van het systeem. Ook in bedrijven die al een of andere vorm van anti-crisismaatregelen hebben gehad, krijgt de ontslagen arbeider geen stuiver extra. Pure discriminatie! Het wordt nog grotesker als je weet dat 2/3 van die 1.666 euro (= 1.110 euro) wordt betaald uit de staatskas. Slechts 555 euro moet door het patronaat zelf worden opgehoest. Het argument dat kleine bedrijven van minder dan 10 werknemers die onslagvergoeding niet aankunnen en ze daarom ervan uitgesloten worden, is dus pure nonsens. 555 euro geven aan je werkvolk, zou dat nu zo onoverkomelijk zijn als je iemand op straat zet? Neen, het is zuivere discriminatie die de staat hier hanteert. Het is besparen via discriminatie.
Nu we zien dat anti-discriminatie geen moreel concept is dat ten alle tijden door de elite wordt gevolgd, durft het N-SA daarop anticiperen. Wordt het geen tijd dat we gastarbeid en arbeidsimmigratie durven benaderen vanuit het gegeven dat het niet moreel verwerpelijk is om over remigratie te spreken? Maar dat het juist moreel correct is vanuit onze nationaal-democratische visie wanneer we het over een nieuwe arbeidsherverdeling hebben. Er zullen tegen nu en eind volgend jaar 120.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Tienduizenden jongeren zullen in die periode op de arbeidsmarkt komen en geen werk vinden. Het patronaat geeft nu al toe dat een groot deel van de arbeidsplaatsen nooit meer zal terugkeren. Ze zijn voor altijd verloren. Wordt het daarom geen tijd dat het afgezaagde liedje van inpassen, aanpassen, inburgeren, plaats voor vreemdelingen op de arbeidsmarkt scheppen... wordt gestopt?
We hebben een nieuw lied nodig. Een lied van en voor de 21ste eeuw. Om ecologische en economische redenen moeten wij minder volk op ons grondgebied hebben. Remigratie is daarvoor de enige oplossing. En als dat discriminatie inhoudt, wat dan nog? Deze maatschappij draait op kapitaalgerelateerde discriminatie. Laat ons daarom eens positief discrimineren. Ten voordele van het volk en in samenspraak met de vreemde mensen. Is dit moreel verwerpelijk? Neen, het is een dialoog op gang brengen die ons overleven veilig moet stellen. Het overleven van ons allemaal.
E. Hermy
Hoofdcoördinator N-SA
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reflexions personnelles, belgique, flandre, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 décembre 2009
R. Steuckers: deux questions à la fin de la première décennie du 21ème siècle
 Entretien-éclair avec Robert Steuckers
Entretien-éclair avec Robert Steuckers
Deux questions à la fin de la première décennie du 21ème siècle
Propos recueillis par Philippe Devos-Clairfontaine
Photo: AnaR - Senlis, Ile-de-France, novembre 2006
Question : Monsieur Steuckers, le site de “Synergies européennes” (http://euro-synergies.hautetfort.com) publie énormément de textes sur la “révolution conservatrice” allemande, en même temps qu’un grand nombre d’articles ou d’interventions sur l’actualité en politique internationale et en géopolitique: ne pensez-vous pas que la juxtaposition de ces deux types de thématiques peut paraître bizarre pour le lecteur non averti? Voire relever de l’anachronisme?
RS: D'abord quelques remarques: le présent est toujours tributaire du passé. A la base, nos méthodes d’analyse sont inspirées de l’historiographie née au XIX° siècle, avec Dilthey et Nietzsche, et des travaux de Michel Foucault, développés depuis le début des années 60: ces méthodes se veulent “généalogiques” ou “archéologiques”. Nous cherchons, dans nos groupes, qui fonctionnent, je le rappelle, de manière collégiale et pluridisciplinaire, à expliciter le présent par rapport aux faits antécédents, aux racines des événements. Pourquoi? Parce que toute méthode qui n’est pas archéologique bascule immanquablement dans le schématique, plus exactement dans ces schématismes binaires qui font les fausses “vérités” de propagande. “La vérité, c’est l’erreur”, disait la propagande de Big brother dans le “1984” d’Orwell. Aujourd’hui, les “vérités” de propagande dominent les esprits, les oblitèrent et annulent toute pensée véritable, la tuent dans l’oeuf.
En juxtaposant, comme vous dites, des textes issus de la “Konservaitve Revolution” et des textes sur les événements qui se déroulent actuellement dans les zones de turbulence géopolitique, nous entendons rappeler que, dans l’orbite de la “révolution conservatrice”, des esprits innovateurs, des volontés révolutionnaires, ont voulu déjà briser les statu quo étouffants, ont oeuvré sans discontinuité, notamment dans les cercles étiquettés “nationaux-révolutionnaires”. Vers 1929/1930, divers colloques se sont déroulés à Cologne et à Bruxelles entre les lésés de Versailles et les représentants des forces montantes anti-impérialistes hors d’Europe. Aujourd’hui, une attitude similaire serait de mise: les Européens d’aujourd’hui sont les principales victimes de Téhéran, de Yalta et de Potsdam. La chute du Mur de Berlin et la disparition du Rideau de Fer n’a finalement pas changé grand chose à la donne: désormais les pays d’Europe centrale et orientale sont passés d’une hégémonie soviétique, qui n’était pas totalement étrangère à leur espace, à une hégémonie américaine qui, elle, y est totalement étrangère. Plus la base territoriale de la puissance qui impose son joug est éloignée, non contigüe, plus le joug s’avère contre-nature et ne peut fonctionner que grâce à la complicité de pseudo-élites véreuses, corrompues, qui rompent délibérément avec le passé de leurs peuples. Qui rompt de la sorte avec le passé de son peuple introduit d’abord un ferment de dissolution politique (car toute politie relève d’un héritage) et livre, par conséquent, la population de souche à l’arbitraire de l’hegemon étranger. Une population livrée de la sorte à l’arbitraire et aux intérêts d’une “raumfremde Macht” (selon la terminologie forgée par Carl Schmitt et Karl Haushofer) finit par basculer d’abord dans la misère spirituelle, dans la débilité intellectuelle, anti-chambre de la misère matérielle pure et simple. La perte d’indépendance politique conduit inexorablement à la perte d’indépendance alimentaire et énergétique, pour ne rien dire de l’indépendance financière, quand on sait que les réserves d’or des grands pays européens se trouvent aux Etats-Unis, justement pour leur imposer l’obéissance. L’Etat qui n’obtempère pas risque de voir ses réserves d’or confisquées. Tout simplement.
Du temps de la République de Weimar, les critiques allemands des plans financiers américains, les fameux plans Young et Dawes, se rendaient parfaitement compte de la spirale de dépendance dans laquelle ils jetaient l’Allemagne vaincue en 1918. Si, jadis, entre 1928 et 1932, la résistance venait d’Inde, avec Gandhi, de Chine, avec les régimes postérieurs à celui de Sun-Ya-Tsen, de l’Iran de Reza Shah Pahlevi et, dans une moindre mesure, de certains pays arabes, elle provient essentiellement, pour l’heure, du Groupe de Shanghai et de l’indépendantisme continentaliste (bolivarien) d’Amérique ibérique. Les modèles à suivre pour les Européens, ahuris et décérébrés par les discours méditiques, énoncés par les “chiens de garde du système”, se trouvent donc aujourd’hui, en théorie comme en pratique, en Amérique latine.
Q.: Vous ne placez plus d’espoir, comme jadis ou comme d’autres “nationaux-révolutionnaires”, dans le monde arabo-musulman?
RS: Toutes les tentatives antérieures de créer un axe ou une concertation entre les dissidents constructifs de l’Europe asservie et les parties du monde arabe posées comme “Etats-voyous” se sont soldées par des échecs. Les colloques libyens de la “Troisième Théorie Universelle” ont cessé d’exister dès le rapprochement entre Khadaffi et les Etats-Unis et dès que le leader libyen a amorcé des politiques anti-européennes, notamment en participant récemment au “mobbing” contre la Suisse, un “mobbing” bien à l’oeuvre depuis une bonne décennie et qui trouvera prétexte à se poursuivre après la fameuse votation sur les minarets.
Le leader nationaliste Nasser a disparu pour être remplacé par Sadat puis par Moubarak qui sont des alliés très précieux des Etats-Unis. La Syrie a participé à la curée contre l’Irak, dernière puissance nationale arabe, éliminée en 2003, en dépit de l’éphémère et fragile Axe Paris Berlin Moscou. Les crispations fondamentalistes déclarent la guerre à l’Occident sans faire la distinction entre l’Europe asservie et l’hegemon américain, avec son appendice israélien. Les fondamentalismes s’opposent à nos modes de vie traditionnels et cela est proprement inacceptable, comme sont inacceptables tous les prosélytismes de même genre: la notion de “jalliliyah” est pour tous dangereuse, subversive et inacceptable; c’est elle que véhiculent ces fondamentalismes, d’abord en l’instrumentalisant contre les Etats nationaux arabes, contre les résidus de syncrétisme ottoman ou perse puis contre toutes les formes de polities non fondamentalistes, notamment contre les institutions des Etats-hôtes et contre les moeurs traditionnelles des peuples-hôtes au sein des diasporas musulmanes d’Europe occidentale. Une alliance avec ces fondamentalismes nous obligerait à nous renier nous-mêmes, exactement comme l’hegemon américain, à l’instar du Big Brother d’Oceana dans le roman “1984” de George Orwell, veut que nous rompions avec les ressorts intimes de notre histoire. Le Prix Nobel de littérature Naipaul a parfaitement décrit et dénoncé cette déviance dans son oeuvre, en évoquant principalement les situations qui sévissent en Inde et en Indonésie. Dans cet archipel, l’exemple le plus patent, à ses yeux, est la volonté des intégristes de s’habiller selon la mode saoudienne et d’imiter des coutumes de la péninsule arabique, alors que ces effets vestimentaires et ces coutumes étaient diamétralement différentes de celles de l’archipel, où avaient longtemps régné une synthèse faite de religiosités autochtones et d’hindouisme, comme l’attestent, par exemple, les danses de Bali.
L’idéologie de départ de l’hegemon américain est aussi un puritanisme iconoclaste qui rejette les synthèses et syncrétismes de la “merry old England”, de l’humanisme d’Erasme, de la Renaissance européenne et des polities traditionnelles d’Europe. En ce sens, il partage bon nombre de dénominateurs communs avec les fondamentalismes islamiques actuels. Les Etats-Unis, avec l’appui financier des wahabites saoudiens, ont d’ailleurs manipulé ces fondamentalismes contre Nasser en Egypte, contre le Shah d’Iran (coupable de vouloir développer l’énergie nucléaire), contre le pouvoir laïque en Afghanistan ou contre Saddam Hussein, tout en ayant probablement tiré quelques ficelles lors de l’assassinat du roi Fayçal, coupable de vouloir augmenter le prix du pétrole et de s’être allié, dans cette optique, au Shah d’Iran, comme l’a brillamment démontré le géopolitologue suédois, William Engdahl, spécialiste de la géopolitique du pétrole. Ajoutons au passage que l’actualité la plus récente confirme cette hypothèse: l’attentat contre la garde républicaine islamique iranienne, les troubles survenus dans les provinces iraniennes en vue de déstabiliser le pays, sont le fait d’intégrismes sunnites, manipulés par les Etats-Unis et l’Arabie saoudite contre l’Iran d’Ahmadinedjad, coupable de reprendre la politique nucléaire du Shah! L’Iran a riposté en soutenant les rebelles zaïdites/chiites du Yémen, reprenant par là une vieille stratégie perse, antérieure à l’émergence de l’islam!
Les petits guignols qui se piquent d’être d’authentiques nationaux-révolutionnaires en France ou en Italie et qui se complaisent dans toutes sortes de simagrées pro-fondamentalistes sont en fait des bouffons alignés par Washington pour deux motifs stratégiques évidents: 1) créer la confusion au sein des mouvements européistes et les faire adhérer aux schémas binaires que répandent les grandes agences médiatiques américaines qui orchestrent partout dans le monde le formidable “soft power” de Washington; 2) prouver urbi et orbi que l’alliance euro-islamique (euro-fondamentaliste) est l’option préconisée par de “dangereux marginaux”, par des “terroristes potentiels”, par les “ennemis de la liberté”, par des “populistes fascisants ou crypto-communistes”. Dans ce contexte, nous avons aussi les réseaux soi-disant “anti-fascistes” s’agitant contre des phénomènes assimilés à tort ou à raison à une idéologie politique disparue corps et biens depuis 65 ans. Dans le théâtre médiatique, mis en place par le “soft power” de l’hegemon, nous avons , d’une part, les zozos nationaux-révolutionnaires ou néo-fascistes européens zombifiés, plus ou moins convertis à l’un ou l’autre resucé du wahabisme, et, d’autre part, les anti-fascistes caricaturaux, que l’on finance abondamment à fin de médiatiser les premiers, notamment via un député britannique du Parlement européen. Tous y ont leur rôle à jouer: le metteur en scène est le même. Il anime le vaudeville de main de maître. Tout cela donne un spectacle déréalisant, relayé par la grande presse, tout aussi écervelée. Dommage qu’il n’y ait plus un Debord sur la place de Paris pour le dénoncer!
Pour échapper au piège mortel du “musulmanisme” pré-fabriqué, tout anti-impérialisme européiste conséquent a intérêt à se référer aux modèles ibéro-américains. In fine, il me paraît moins facile de démoniser le pouvoir argentin ou brésilien, et même Chavez ou Morales, comme on démonise avec tant d’aisance le fondamentalisme musulman et ses golems fabriqués, que sont Al-Qaeda ou Ben Laden.
Alexandre del Valle et Guillaume Faye, que ce musulmanisme insupportait à juste titre, notamment celui du chaouch favori du lamentable polygraphe de Benoist, cet autre pitoyable graphomane inculte sans formation aucune: j’ai nommé Arnaud Guyot-Jeannin. Le site “You Tube” nous apprend, par le truchement d’un vidéo-clip, que ce dernier s’est récemment produit à une émission de la télévision iranienne, où il a débité un épouvantable laïus de collabo caricatural qui me faisait penser à l’épicier chafouin que menacent les soldats français déguisés en Allemands, pour obtenir du saucisson à l’ail, dans la célèbre comédie cinématographique “La 7ième Compagnie”… Il y a indubitablement un air de ressemblance… Cependant, pour échapper à de tels clowns, Del Valle et Faye se sont plongés dans un discours para-sioniste peu convaincant. Faut-il troquer l’épicier de la “7ième Compagnie” pour la tribu de “Rabbi Jacob”, la célèbre comédie de Louis de Funès? En effet, force est de constater que le fondamentalisme judéo-sioniste est tout aussi néfaste à l’esprit et au politique que ses pendants islamistes ou américano-puritains. Tous, les uns comme les autres, sont éloignés de l’esprit antique et renaissanciste de l’Europe, d’Aristote, de Tite-Live, de Pic de la Mirandole, d’Erasme ou de Juste Lipse. Devant toutes ces dérives, nous affirmons, haut et clair, un “non possumus”! Européens, nous le sommes et le resterons, sans nous déguiser en bédouins, en founding fathers ou en sectataires de Gouch Emounim. On ne peut qualifier d’antisémite le rejet de ce pseudo-sionisme ultra-conservateur, qui récapitule de manière caricaturale ce que pensent des politiciens en apparence plus policés, qu’ils soient likoudistes ou travaillistes mais qui sont contraints de rejeter les judaïsmes plus féconds pour mieux tenir leur rôle dans le scénario proche- et moyen-oriental imaginé par l’hegemon. Le sionisme, idéologie au départ à facettes multiples, a déchu pour n’être plus que le discours de marionnettes aussi sinistres que les Wahabites. Tout véritable philosémitisme humaniste européen participe, au contraire, d’un plongeon dans des oeuvres autrement plus fascinantes: celles de Raymond Aron, Henri Bergson, Ernst Kantorowicz, Hannah Arendt, Simone Weil, Walter Rathenau, pour ne citer qu’une toute petite poignée de penseurs et de philosophes féconds. Rejeter les schémas de dangereux simplificateurs n’est pas de l’antisémitisme, de l’anti-américanisme primaire ou de l’islamophobie. Qu’on le dise une fois pour toutes!
(Réponses données à Bruxelles, le 7 décembre 2009).
00:25 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, synergies européennes, politique, politique internationale, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 décembre 2009
Qu'est-ce que la démondialisation?
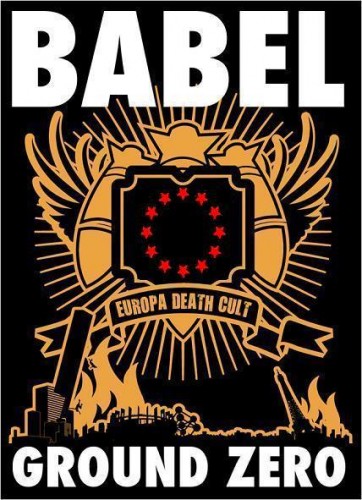 |
|
Qu'est-ce que la démondialisation? | |
|
« Le modèle de démondialisation se déline en onze point clés : 1 Le centre de gravité de l’économie doit être la production destinée au marché intérieur et non à l’exportation. 2 Le principe de subsidiarité doit être inscrit dans la vie économique par des incitations à produire les biens à l’échelle locale ou nationale tant que cela peut se faire à des coûts raisonnables, afin de protéger la communauté. 3 La politique commerciale (autrement dit les quotas et les barrières douanières) doivent avoir pour but de protéger l’économie locale contre les importations de matières premières subventionnées, à des prix artificiellement bas. 4 La politique industrielle (qui inclut subventions, barrières douanières et échanges commerciaux) doit avoir pour objectif de revitaliser et de renforcer le secteur manufacturier. 5 Toujours remises à plus tard, les mesures de redistribution équitable des revenus et des terres (y compris la réforme foncière en milieu urbain) peuvent créer un marché intérieur dynamique qui deviendra le pilier de l’économie et produira au niveau local des ressources financières pour l’investissement. 6 Accorder moins d’importance à la croissance, mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie et renforcer l’équité, c’est contribuer à réduire les déséquilibres environnementaux. 7 La mise au point et la diffusion de technologies vertes doivent être encouragées tant dans l’agriculture que dans l’industrie. 8 Les décisions économiques stratégiques ne peuvent être laissées au marché ni aux technocrates. Toutes les questions vitales (déterminer quelles industries développer, celles qu’il faut abandonner progressivement, quelle part du budget de l’Etat consacrer à l’agriculture, etc.) doivent au contraire faire l’objet de débats et de choix démocratiques. 9 La société civile doit en permanence surveiller et superviser le secteur privé et l’Etat, selon un processus qui doit être institutionnalisé. 10 Le régime de la propriété doit évoluer pour devenir une économie mixte intégrant coopératives et entreprises privées et publiques mais excluant les groupes multinationaux. 11 Les institutions mondiales centralisées comme le FMI ou la Banque mondiale doivent céder la place à des institutions régionales bâties non sur l’économie de marché et la mobilité des capitaux, mais sur des principes de coopération qui, selon l’expression utilisée par Hugo Chavez pour décrire son Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA), “transcendent la logique du capitalisme”. Le modèle de démondialisation a pour objectif d’aller au-delà de la théorie économique étriquée de l’efficacité, pour laquelle le critère essentiel est la réduction du coût unitaire, quelles qu’en soient les conséquences en termes de déstabilisation sociale ou écologique. Il s’agit de dépasser un système de calcul économique qui, selon les termes de l’économiste John Maynard Keynes, a transformé “l’existence tout entière en parodie d’un cauchemar de comptable”. »
Walden Bello, membre de la Chambre des représentants des Philippines, professeur de sociologie, Foreign Policy in Focus (USA), septembre 2009 |
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : globalisation, globalisme, mondialisation, économie, politique internationale, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'identité entre devenir individuel et devenir collectif
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
L’identité entre devenir individuel et devenir collectif
Les racines finissent toujours par surgir du passé, là et au moment où on les attend le moins, au détour d'une identité qui s'affermit et consolide ses linéaments culturels, philosophiques et esthétiques. Les racines constituent le socle "gaïen" dans lequel viennent s'ancrer les identités individuelles, plurales, locales, ethniques, régionales et nationales. Ces mêmes racines fondent le "nomos" de nos origines, sa limite spatiale et territoriale, et le cadre ontologique des devenirs collectifs. Les racines, lesquelles sont à la base de nos communautés charnelles de sang et de sol, ont un langage holiste, unilatéral et statique. Tout autre est le devenir individuel des identités qui prend corps dans les matrices du nomos de nos racines. Le devenir des identités individuelles s'inscrit dans un langage dynamique, transversal et constructiviste. En effet, si les racines s'emploient à enfanter biophysiquement à l'état brut une identité, il importe à chaque être humain de façonner, mûrir et affirmer une identité propre. Là se situe la frontière entre le déterminisme de nos origines naturelles et la liberté personnelle qui n'est autre que volonté de puissance. Car nous n’affirmons une identité que dans la mesure ou nous sommes pleinement libres, ç'est à dire capables de générer et d'affirmer dans le présent des valeurs propres, voir selon un schéma heideggerien d'actualiser des actes en puissance.
L'identité individuelle serait en quelque sorte une puissance de flux intégrationiste, qui reçoit, conquiert et digère. C'est pourquoi, la logique des identités individuelles peut parfois être paradoxalement centrifuge à l'endroit même où leurs racines demeurent immuables. Les identités individuelles culminent dans le voyage intérieur, virtuel, et ont pour terrain d'élection l'inconnu multiforme. Elles disposent de capacités d'appréhension et d'attraction inépuisables, et cultivent le goût d'une curiosité insatiable et à bon escient. Dans le cadre d'une perspective deleuzienne, le devenir des identités individuelles progresse dans le temps présent en traçant des lignes de fuite, qui partent toujours du milieu où elles s'affirment instantanément. C'est au cœur de cette perpétuelle gestation de lignes de fuites d'un présent à un autre que peut se produire la rencontre d’une amitié ou d'un amour inestimable entre deux identités authentiques et intrinsèquement différentes. Ce devenir se caractérise par la conquête d'espaces idéologiques et la fermentation d'une pensée vive, d’un savoir libéré des inhibitions morales et sociales. Au carrefour du devenir individuel d'une identité en gestation, peut surgir le devenir collectif et centripète de ses racines.
Alors de la croisée de ses deux routes distinctes pourra naître une navigation existentielle commune, si le dialogue s'instaure organiquement, sans mutilations, blocages et préjugés. Le devenir individuel de l’identité se retrempera progressivement dans le fleuve nourricier du devenir collectif des racines si ce dernier se fait le réceptacle et la brèche ouverte à la maturation et l'épanouissement du premier. Le recentrage au présent de ces deux devenirs complémentaires se fera au prix d'un parallélisme tolérant des formes et du contenu, en évitant les dysfonctionnements toujours possibles. Le réancrage de l’identité individuelle au cœur des racines communautaires fournira à la stabilité d'un socle "gaïen" les denrées d'une pensée éclectique que génère chaque devenir identitaire. Les dimensions architectoniques d'une identité peuvent être profondément urbaines et imbriquées dans les ramifications bétonnées d'une ville qui constitue son champ d'expérimentation et d'expression comme elle représente sa première ligne de front. Son essence originellement tellurique et élémentaire s'encrassera dans l’artificialité des constructions théoriques, comme dans une mélasse confuse d'apocryphes citadins, et participera à ce que Schauwecker écrivait, "le ruissellement des sources souterraines en regardant pourrir et grandir l'époque, dans le creuset d'âmes et d’excréments qui est au cœur de toute ville" .
Retrouver ses racines démétriennes supposera alors de briser les chaînes envoûtantes des rhytmes cinétiques, de la fébrilité et de l’anonymat quantitatif, et de se libérer de l’asservissement du langage individualiste abstrait et autocentrée pour renouer avec le langage élémentaire et polymorphe de la nature, en sachant l'écouter puis communier dans la simplicité en apprenant lentement à comprendre l'arbre de la vie, lequel est vert et florissant alors que toute théorie est grise (pour citer Goethe). Se libérer des circuits de bitume qui convergent vers un centre épidermique et fictif, supposera de déplacer son individualité vers son propre centre spirituel dans les dédales de notre labyrinthe intérieur. Les devenirs collectifs appartiennent à l'ordre de l'immanence et sont versés dans l’historicité comme Dieu reste à l'intérieur du monde comme “causa immanenta”, ainsi que Spinoza l'a si bien enseigné; les devenirs individuels quant à eux s’expriment grâce à la transcendance et appartiennent à la sphère de « l’être possible et global » pour reprendre une catégorie de Jaspers. Elles ont les potentialités pour dépasser le domaine du naturel, de la pure expérience, pour parvenir aux frontières kantiennes du « méconnaissable». Devenir collectifs et devenirs individuels, l'immanence et la transcendance sont sur le chemin rectiligne d’un ciseau qui "ne coupe pas”, pour reprendre une métaphore jüngerienne. Les ciseaux évoluent dans un monde ouvert et fermé; l’effet réside dans la coupure.
Pour des ciseaux qui ne coupent pas, le chemin ne s’est pas encore ouvert, et la souffrance reste secondaire. Dans ce sens, le chemin ne se s'est pas confronté à la qualité (abgespalten), et c'est ainsi que le chemin est plus significatif que le but. Avec cette métaphore, Jünger nous enseigne que les mondes de l’immanence et de la transcendance ne se recouvrent pas, et gardent entre eux une distance comme une certaine tension. La même tension oppose les devenirs collectifs aux devenirs individuels. C’est pourquoi le retour inopiné d'un enfant arrivé à sa maturation identitaire au sein de sa communauté charnelle, peut ressembler au commencement d'une nouvelle ligne de fuite se situant à l’intercession de deux devenirs, entre immanence et transcendance, dont on peut penser que la rencontre est le fruit du destin.
Maître Jure VUJIC.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 décembre 2009
Entretien avec Pavel Toulaev
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Entretien avec Pavel Vladimirovitch Toulaev, Vice-Président de « Synergies Européennes » à Moscou
1. Pavel Vladimirovitch, comment vous présenteriez-vous à vos amis synergétistes d’Europe occidentale ?
PVT : Je m'appelle Pavel Vladimirovitch Toulaev et j'ai 39 ans. Russe et citoyen de la Russie, je réside à Moscou. De par ma formation, je suis traducteur-interprète en langue espagnole, anglaise et française et licencié en histoire ; par vocation je suis poète, philosophe et homme de lettres ; par profession, je suis professeur à l'Université linguistique d'Etat de Moscou ; par engagement social, je suis rédacteur scientifique et littéraire de la revue historique et culturelle Naslednié Predkov (Les legs des ancêtres). J'ai une cinquantaine de publications à mon actif sur la Russie, l'Espagne, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord dans les genres les plus divers: des études scientifique aux visions mystiques. Parmi les plus significatives, je citerai: « Comprendre l'Entité russe », « Sept rayons », « La croix sur la Crimée », « La Révolution conservatrice en Espagne », « La Russie et l'Espagne s’ouvrent l'une à l'autre ». Parmi les livres sortis sous ma rédaction, je choisirais les recueils suivants: « La Russie et l'Europe: expérience d’une analyse à partir de l'idée de "sobornost " », « Le peuple et les intellectuels», « Perspective russe » et également « Philosophie posthistorique» par Vitalii Kovalev et « Comment l'ordre organise les guerres et les révolutions » par Antony Sutton.
2. Quelles sont les sources de votre mode de penser ?
PVT : Ma famille, mes amis et ma Patrie ont joué le rôle principal dans ma formation. Elevé dans les bonnes traditions russes et dans la famille d'un officier des services de renseignement pour l'étranger, j'ai reçu une éducation avec une forte orientation idéologique, fidèle aux principes du patriotisme, du socialisme soviétique et de la pratique sportive et culturelle au sein des organisations des pionniers et du Komsomol. Depuis l'enfance, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Né à Krasnodar, dans le sud ensoleillé de la Russie, j'ai passé ma jeunesse au bord de la mer Noire à Sotchi, j'ai été plus d'une fois dans la ville natale de mon père, Saint-Pétersbourg, et en Sibérie, pays natal de ma mère ; j'ai vécu en Autriche et en Australie, j'ai travaillé en Espagne et aux Etats-Unis. Mon expérience à l'étranger a considérablement influencé ma vision du monde, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la capitale de la Russie. C'est surtout grâce à Moscou, avec ses traditions russophiles, orthodoxes et impériales, que j'ai atteint ma maturité.
La beauté et le mystère qui se manifestent dans la nature, dans l'érotisme et dans l'art ont aussi exercé une grande influence depuis toujours sur ma façon de penser. J'ai toujours considéré la création artistique et l'amour comme l'expression la plus naturelle du monde intérieur. Dans ma jeunesse je me suis appliqué à la peinture, j'ai été barde lorsque j'étais étudiant et j'ai vécu d'impressions musicales et théâtrales, j'ai écrit et exécuté moi-même des chansons. Après avoir adopté la foi orthodoxe, j'ai appris à chanter la messe. L'esthétique m'attire sous toutes ses formes et surtout sous sa forme musicale, qui n'a jamais cessé de m'envoûter véritablement. J'écoute régulièrement la musique classique de Bach et Tchaïkovski à Richard Strauss et Rachmaninov. J'aime également la musique populaire y compris l’occidentale par sa vitalité et son naturel.
3.Quels auteurs et quels livres vous ont marqué le plus dans votre jeunesse ?
PVT : Il est difficile d'opérer une sélection parmi les centaines d'auteurs et de livres que j'ai lus. Depuis l'enfance, j'ai avalé de tout selon de contes, des livres d'aventures, des romans policiers, des romans d'amour et des poésies. La première œuvre sérieuse dont je me rappelle est l'Odyssée d'Homère dans ma jeunesse, en dehors de ma passion pour la peinture et pour la musique, j'ai pris goût aux œuvres ayant trait aux beaux-arts aux musées et aux albums d'art.
Pendant les années universitaires sous l'influence de mon éducation soviétique, je me suis passionné pour le romantisme soviétique et le mouvement des partisans de l'époque. Une fois devenu boursier de thèse à l'Institut de lyrique latine de l'Académie des sciences de l'URSS, où je me suis spécialisé dans le Pérou, j'ai été enchanté par les travaux et la biographie de Che Guevara, de Fidel Castro, de Ho Chi Min, de José Carlos Mariategui, de Aya de la Torre, de Simon Bolivar et de José Marti. J'ai traduit et chanté les chansons de Victor Hara.
C'est au cours d’un stage de boursier de thèse que j'ai souhaité me familiariser avec les auteurs classiques russes de Pouchkine et Gogol, Tolstoï et Essenine, en dehors des œuvres de Marx, Hegel et Lénine, qu'il fallait obligatoirement lire à l'époque. Je me suis littéralement plongé dans leurs œuvres complètes pendant des semaines et des mois entiers dans les bibliothèques.
Dostoïevski m'a profondément secoué et ce sont surtout Les Démons et Les frères Karamazov qui ont produit une grande impression sur moi. En lisant Dostoïevski, je me suis reconnu sans réfléchir... Ensuite cela a été le tour de Nikolaï Fedorov, utopiste l'excès, qui rêvait de redonner la vie tous nos ancêtres, une idée qui m'a stupéfié. En bon élève de la période soviétique, j'avais étudié l'histoire selon les principes du matérialisme historique et je me trouvais alors confronté à la résurrection des pères, aux racines aryennes, aux recherches de berceaux indo-européens, à la guerre pour Constantinople. En un mot, j'étais confronté à la contre-révolution. J'ai éprouvé un grand bonheur esthétique en lisant Nabokov. Sa langue somptueuse, veloutée et extraordinairement poétique, m'a charmé. Le roman surréaliste de Nabokov Le Don est un des meilleurs romans du XXième siècle.
 Parmi les philosophes, mon premier maître à penser a été Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pendant mon stage de boursier de thèse, j'ai été obligé d'étudier Les cahiers philosophiques de Lénine qui contiennent beaucoup d'extraits de la philosophie classique allemande. Je n'en suis pas resté là. M'étant armé de patience, j'ai consacré plusieurs mois à l'étude en autodidacte de la dialectique de l’absolu. J'ai étudié L'Encyclopédie philosophique, La
Parmi les philosophes, mon premier maître à penser a été Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pendant mon stage de boursier de thèse, j'ai été obligé d'étudier Les cahiers philosophiques de Lénine qui contiennent beaucoup d'extraits de la philosophie classique allemande. Je n'en suis pas resté là. M'étant armé de patience, j'ai consacré plusieurs mois à l'étude en autodidacte de la dialectique de l’absolu. J'ai étudié L'Encyclopédie philosophique, La
science de la logique, L'éstétique et ensuite La philosophie de l'histoire, le résultat a surpassé toute attente car je suis devenu un idéaliste convaincu.
Platon, que j'ai aussi lu en entier, a suivi Hegel et j'ai même composé deux dialogues philosophiques en m'inspirant des siens. Aristote ne m'a pas vraiment captivé et, au lieu d'étudier la Métaphysique, j'ai relu les biographies philosophiques de Diogène Laërce, les poèmes d'Homère et des magnifiques traductions d'hymnes anciens. Les classiques orientaux ont également exercé une influence considérable sur moi: parmi eux le « Rigveda », le « Mahabharata », Le chevalier dans la peau de tigre de Chota Roustavéli ainsi que la poésie lyrique dans l'esprit de Nizami et de Omar Khayyam. En général, j'ai une prédilection pour l'Orient à laquelle ont contribué le Précis d'Histoire mondial de Djavaharlal Nehru, mon engouement pour les livres et les tableaux de Nikolaï Roerich, mon intérêt scientifique pour l'lnde, la Chine et la Corée du Nord. L'Orient de l’époque classique m'a toujours inspiré un sentiment de respect profond et parfois même d'exaltation et de vive émotion.
Le Zarathoustra de Friedrich Nietzsche m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu pour la première fois dans une édition d'avant la révolution (il n'y avait pas d'éditions soviétiques), par la suite, j'ai eu accès aux nouvelles traductions et j'ai lu avec inspiration La naissance de la tragédie et l’esprit de la musique, L'Antéchrist et d'autres œuvres. C'est en partie sous l'influence de Nietzsche que j'ai créé la société littéraire moscovite « Prométhée » avec une orientation pour l'esthétique musicale, pour le « cosmos russe » et l'astronautique. C'était une étape importante de mon cheminement spirituel, où trouvèrent leur expression les recherches et les élans de ma jeunesse romantique.
4. Quels penseurs ont attiré votre attention dans la maturité ?
PVT : Parmi les auteurs occidentaux, ce sont Wagner, Schopenhauer, Heidegger, Camus, Dali, Ortega y Gasset qui m'ont captivé, ensuite Dante, Baltasar Gracian, Ignace de Loyola, Rafael Calvo Serrer (surtout sa Théorie de la Restauration), Escriva de Balaguer (Chemin) et aussi la grandiose poésie épique espagnole « El Cid », que j'ai étudiée dans le texte original. Après avoir travaillé à Séville pour l'Expo-92 et avoir fait connaissance avec des phalangistes, j'ai étudié les œuvres de José Antonio Primo de Rivera, j'ai écrit la brochure La révolution conservatrice en Espagne et l'essai biographique Franco - Caudillo de l'Espagne.
Peu à peu, j'ai commencé à préférer les penseurs russes. Encore dans les années soviétiques grâce aux recherches fondamentales du fondateur de l'école mythologique A.H. Afanasiev (son travail principal Les conceptions poétiques des Slaves sur la nature) et de l'académicien B. A. Rybakov (Le paganisme des anciens Slaves et Le paganisme de l'ancienne Russie), j'ai découvert le monde de l'antiquité slave et je me suis sérieusement intéressé aux racines aryennes de notre civilisation. C'est ainsi que mon intérêt profond pour le passé est né et que j'ai été amené à lire avec la plus grande attention l'ouvrage en plusieurs tomes l’Histoire de l'Etat russe par N. M. Karamzine, à cela ont suivi les œuvres choisies sur l'histoire russe de S. M. Soloviev et les conférences renommées de M. O. Klioutchevski. Dans cette période, je suis devenu militant de la Société panrusse de protection des monuments historiques et culturels.
Depuis le debut de la « perestroïka », j'ai essayé de lire tout ce qui était interdit auparavant et qui était désormais disponible: les livres des écrivains russes-blancs, les analyses des dissidents soviétiques sur le rôle des juifs et des francs-maçons. Je me suis abonné à une montagne de revues copieuses: Problèmes de philosophie, Notre contemporain (Nach Sovremenik), Moscou, Science et religion et d'autres sans compter quelques journaux politiques d'orientation patriotique dans le genre du Messager russe (Russkii Vestnik) et de Jour (Dyeïnn). C'est avec difficulté que j'ai avalé cette avalanche d'informations où foisonnaient les scandales, les sujets à sensation et les nouvelles tragiques.
Après l'abolition de la censure et la libération totale de la presse, les classiques de la pensée russe ont commencé à être publiés en gros tirages: Vl. Soloviev, N. Berdiaev, P. Florenski, Illin, E. Troubetskoi, L. Tikhomirov, I. Solonevitch et d'autres. Ils sont tous des idéalistes orthodoxes de tendances différentes. Je ne peux affirmer avoir lu toutes leurs œuvres (il y en a des centaines), mais j'ai étudié sérieusement l'essentiel. Sous l'influence des philosophes orthodoxes, j'ai élaboré l'idée russe: la « sobornost », qui signifie la liberté hiérarchique et différenciée en Dieu.
C'est à cette époque que j'ai étudié la Bible et que j'ai lu plusieurs fois l'Evangile. L'Ancien Testament a produit sur moi une impression sombre et lors de la lecture du Nouveau Testament j'ai été particulièrement touché par l'Evangile de Saint-Jean et par l'Apocalypse. La Liturgie divine et l'expérience mystique du martyr aident sensiblement à la compréhension de la véritable Orthodoxie.
Sur le plan personnel c'est le père Dmitri Doudko, éminent pasteur moderne et chef spirituel reconnu de l'opposition nationale-patriotique qui m'a offert son aide. J'ai en effet eu l'occasion de réviser un recueil de ses sermons choisis.
Alexei Fedorovitch Lossev reste pour moi encore aujourd'hui le dieu de la philosophie. Il est en même temps philosophe, philologue, musicologue, écrivain, expert de l'antiquité. C'est en la personne de Lossev que la pensée russe a surpassé pour la première fois l'école allemande, réunissant en soi les théories les plus innovantes de la dialectique antique et classique, de la phénoménologie moderne, de la philosophie de l'histoire et de la linguistique. La conception de Lossev est complète ; et elle est aussi exquise ; sa compréhension seule offerte un plaisir esthétique. Les travaux de Lossev, que je préfère, sont : La dialectique du mythe, La mythologie des Grecs et des Romains, Le problème du symbole et l’art réaliste et bien sûr, son oeuvre fondamentale Histoire de l'Esthétique de l'Antiquité. Lossev est encore inconnu en Occident mais, avec le temps, il occupera sans aucun doute la place qui lui revient dans l'Olympe intellectuel.
Dans le cadre de cet interview, il faut réserver une place à part au fameux livre de Nikolaï Yakovlevitch Danilevsky La Russie et l'Europe: Aperçu sur l’attitude culturelle et politique du monde slave vis-à-vis du monde romano-germanique, où l'on élabore pour la première fois, sur une base scientifique, la doctrine du « type slave du point de vue historico-culturel ». J'ai non seulement étudié soigneusement cette œuvre fondamentale qui a exercé en son temps une influence fondamentale sur Spengler et qui a suscité un débat animé dans le milieu intellectuel russe de la fin du XIXième et du début du XXième siècle, mais j'ai aussi étudié l'histoire du problème, j'ai tenu une conférence scientifique à ce sujet dans le cadre du programme de la société historico-religieuse « Sobor » que je dirige et j'ai publié la première anthologie de la philosophie russe de l'histoire, qui comprenait des extraits de l’œuvre des slavophiles classiques, des occidentalistes et des eurasiens: Khomiakov, Kiréevski, Tioutchev, Herzen,
Danilevski, Léontiev, Rosanov, Troubetskoï, Ivanov, Fedotov, Lossev, et aussi des articles de mes contemporains et amis: Vitali Kovalev, Igor Demine, Vladimir Martchenkov, Nikolaï Licovoï, Andreï Pavlenko, Gueïdar Djemal, Viatcheslav Parchkov et d'autres auteurs de talent.
6. Quelles sont les grandes lignes de votre conception du monde ?
L'esprit russe a l'habitude d'écarter les structures de pensée rigides et encombrantes. Le paganisme slave était ouvert et polythéiste. L'Orthodoxie est à sa base apophatique. Les partisans de Bakounine et les marxistes-léninistes ont transformé la dialectique de Hegel en dialectique de la révolution. Les systèmes philosophiques, tels que « la sophiologie » de Vladimir Soloviev ou « la philosophie du nom » d'Alexeï Lossev, sont de rares exceptions.
Je n'ai jamais essayé de créer un système philosophique qui soit en même temps développé et achevé. De temps en temps, naturellement, j'ai dressé le bilan de mes recherches, mais à chaque fois une nouvelle vision du monde s'est ouverte à moi. De la fougue révolutionnaire de ma jeunesse, je suis passé à un prométhéisme créatif, du prométhéisme à l'esprit de « sobornost », de cet esprit de « sobornost » à l'académisme romantique. Maintenant je préfère contempler le monde, l'écouter, l'étudier, le comprendre en profondeur, le savourer, l'apprécier tout en exprimant ma volonté dans l'aspiration à la perfection et à la supériorité. D'ailleurs, je n'ai pas tiré un trait définitif sur mes recherches et je reste ouvert à la vie et à la connaissance. Disons que dans la poésie pendant un certain temps j'ai sciemment visé le symbolisme ontologique, mais actuellement, je me sens plus proche de la simplicité organique d'un romantisme concret et combatif. La paix, la guerre, l'amour, le foyer familial, une mort digne me sont nécessaires en tant que tels et non pas par le biais de symboles et de reflets.
Dans la thèse que je prépare actuellement sur l'histoire des relations russo-hispaniques, je développe une nouvelle tendance de la sémiotique historique. Je considère, étudie et lis toute l'histoire y compris les relations internationales comme un texte. Pour moi, en tant que culturologue qui se veut objectif et impartial, il est important de fuir l'idéologisation et la modernisation des faits historiques. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que je n'ai pas de préférences, de convictions civiques et d'opinions politiques. Je suis un fondamentaliste russe, un patriote, j'aime la liberté et je déteste le pouvoir de l'argent.
Ce sont surtout mes poésies et mes essais réunis dans le livre Comprendre l’Entité russe qui illustrent le mieux ma conception. A ceux qui s'intéressent aux racines indo-européennes, aryennes et slaves, je recommande la lecture de mon étude Nos Dieux originaires: Zeus, Léto, Artemis, Apollon et leurs ancêtres et aussi le précis bibliographique Pôle hyperboréen (in : Naslédnié Predkov, n°4). Mes opinions actuelles, fondées sur un paradigme qualitativement nouveau, qui a été élaboré en tenant compte de l'utilisation de l'ordinateur et de l'expérience acquise aux Etats-Unis, ont été exprimées dans le recueil Prospective russe et également dans une série de nouveaux articles de revues et dans des interventions publiques. Une place particulière devrait être réservé, selon moi, à l’article « Les guerres de la nouvelle génération » (NdSE n°39).
7. Quel est le contenu du livre Perspective russe?
Perspective russe est un recueil collectif d’une dizaine d'écrivains russes, publié en 1996 par le centre de coordination «Pôle» en tant que supplément spécial à la revue Naslédnié Predkov. Ce recueil a le mérite fondamental de créer un modèle de passage au mouvement patriotique russe où le mode de pensée littéraire et idéaliste cèdera la place à une approche militaire et stratégique et où le national-conservatisme sera remplacé par le national-technocratisme.
Dans ce livre il y a six divisions: « L'ideologie nationale », « Guerre et Géopolitique », « La percée technologique », « La Russie et le monde contemporain », « Les conférences et les rencontres scientifiques », « Les nouvelles publications », qui contiennent les analyses des intellectuels les plus avancés de mon entourage. A part mon introduction, « La Renaissance russe: objectifs et priorités», les articles présents dans ce recueil sont: « Russie: principe aristocratique » (Alekseï Chiropaév), « La dictature du capital commercial » (Serguéï Gorodnikov), « La compétitivité de la Russie à l’avenir » (Andréï Saveliev), « La quatrième guerre mondiale » (Vladimir Popov), « Le Temps et le poids de la Russie » (Valeriï Milovanov), « Est-ce que la Russie possède une armée apte à combattre ? » (Evguénii Morozov), « La situation géostratégique après la guerre froide » (Alexandre Bedritzki), « L’exposition aéronautique et astronautique à Joukovskii » (Serguéï Guérasioutine). Ce recueil contient aussi une partie analytique, des traductions, des critiques, des nouvelles et de brèves informations: « Qui Crée notre espace d’information? », « Le résultat des élections présidentielles », « Les droites en Europe Orientale » (d'après le livre de Paul Holenos La liberté de haïr) ; la discussion du livre d'Antony Sutton Comment l'Ordre organise les guerres et les révolutions avec la critique « Conflits à régler: vers un nouvel ordre mondial », les critiques du « Recueil de géopolitique russe » ; du livre de K. E. Sorokine « La géopolitique de l'époque contemporaine et la géostratégie de la Russie » et le numéro qui vient de paraître de la Revue militaire et aussi la réponse à deux calomniateurs russophobes: Walter Laqueur et Alexandre Yanov, suite à la parution de leur livre Les Cent-Noirs. Naissance de l’extrême droite en Russie et Après Eltsine. La Russie de Weimar. A côté de ces articles, il y a, dans le recueil, mon interview intitulé: « Les USA sont un monde qualitativement à part ».
J'attire votre attention sur le fait que c'est justement dans « La perspective russe 1996 » que l'on a osé la première tentative de formuler les objectifs fondamentaux de la « Quatrième guerre mondiale ». En effet, la troisième guerre mondiale (appelée « guerre froide ») contre l'URSS et le communisme mondial, s'est officiellement close le 20 avril 1996, avec la signature au niveau étatique le plus élevé, de la « Déclaration de la rencontre moscovite ». C'est de là que sont nés de nouveaux problèmes et que des questions ont été soulevées ; c'est de là également que vient l'actualité de notre travail que les analystes les plus clairvoyants ont défini comme « une attaque intellectuelle de la nouvelle génération des patriotes ».
8. Quelles sont vos opinions géopolitiques et leur influence sur les débats à la Douma ?
Mes opinions politiques ainsi que ma vision du monde sont en développement perpétuel. Mon intuition de départ et ma volonté sont assez simples. Tout ce qui est bénéfique pour la Russie, pour ma Patrie, me convient. Tout ce qui est contre les Russes et la Russie dans son ensemble est inacceptable pour moi. Méthodologiquement, je dérive mon argumentation de la multiplicité et de la hiérarchie de l'être unique indivisible, composé de plusieurs types d'espaces: personnel, sacré, physique, historique, économique, d'information, etc. Une telle typologie peut varier. L'important est de comprendre que nous, notre famille, notre people, notre histoire, nos intérêts, nous sommes à l'intersection de ces mondes. Si l'on me lance un défi, je suis obligé de répondre. De surcroît, je veux gagner même si la mort me menace. Je le veux tellement et je ferai tout pour que mon désir se réalise, devienne réel. Cela c'est la substance. Quant à la forme, mon modèle métahistorique et descriptif, si l'on peut le synthétiser au maximum, contient trois espaces, grands et complexes, et de type différent, qui pénètrent l'un dans l'autre:
1) La Croix russe (elle se forme à l'intersection du chemin historique « des Varègues aux Grecs », direction Nord-Sud et de l'artère trans-européenne qui s’étend dans toute la Russie de l'Ouest à l'Est, où se cristallise le noyau russe renouvelé et ethniquement compact).
2) L'axe trans-aryen (il traverse la partie méridionale de l'espace central depuis le Nord-Ouest au Sud-Est et crée une attraction entre le Nord et le Sud aryens).
3) Le bouclier euro-asiatique (l'espace le plus étendu et le plus hétérogène qui pourrait être constitué potentiellement par tous les Etats de notre continent avec les îles adjacentes; son but essentiel consiste à créer une large union de défense contre les forces de l'atlantisme occidental, du mondialisme et du sionisme international). Il est important de ne pas confondre ces trois grands espaces car c'est à l'intérieur de chacun d'entre eux que les problèmes particuliers trouvent leur solution.
C'est par un souci d'exactitude scientifique que je dois préciser que mes opinions en matière de géopolitique se sont formées sous l'influence des œuvres d'Alexandre Douguine, surtout de sa revue Elementy. Je souhaite également mentionner le travail de Robert Steuckers « Panorama théorique de la géopolitique » ( j'ai participé à sa traduction en russe), les études d'Evguéniï Morozov et de ses compagnons de lutte dans le Recueil géopolitique russe et aussi les recherches en matière de race et d'eugénisme de Vladimir Avdéev, mon ami, membre du conseil de rédaction de Naslédnié Predkov.
Actuellement, j'interprète les anciens problèmes d'une nouvelle façon, je complète et je précise mes études précédentes. Il est indispensable de tenir compte de ce qui a été publié par d'autres auteurs ces dernières années. C'est surtout les Principes de géopolitique de A. G. Douguine, la Géopolitique contemporaine de K. E. Sorokine, L'Europe unie: problèmes et perspectives de V. Wiedemann, les Manœuvres de la nouvelle géopolitique de A.V. Mitrofanov, l'étude critique de l'« eurocentrisme » de S. Kara-Mouzza. Ce qui différencie essentiellement mes anciennes vues des actuelles, c'est mon plus grand réalisme et le refus du schématisme occidental.
Vous me demandez quel est l'impact des projets géopolitiques sur les débats à la Douma. Je ne peux pas répondre avec précision à votre question car j'ai été au Comité de géopolitique seulement quelques fois (récemment, on y a présenté la revue Naslédnié Predkov). Toutefois, s'il faut s'en tenir à quelques démarches pratiques de l'administration actuelle des affaires étrangères du gouvemement d'Eltsine, signalons quelques points qui nous paraissent intéressants et positifs : une amitié préférentielle avec l'Allemagne, des rapports extrêmement chaleureux avec la France, un certain rapprochement avec le Japon, le fait d'accorder un plus grand poids au rôle de l'Espagne, l'intensification de la présence russe dans les Balkans malgré les menaces de la Turquie, et, en même temps, l'évident passage d’un stade à un autre : de l’alliance temporaire avec les USA, nous passons à un éloignement graduel par rapport aux Américains ; nous constatons aussi un rapprochement ostentatoire avec la Chine. La reprise de la lutte en faveur des anciens alliés dans le monde arabe, en Asie, en Amérique latine etc. On ne peut pas s'empêcher de remarquer les changements en faveur de mes amis politiques.
9. Comment voyez-vous la future collaboration entre les nouvelles droites en Russie et
en Europe occidentale ?
D'un point de vue géopolitique, ce qui m'intéresse ce n'est pas le fait d'être à droite ou à gauche, mais l'attitude réelle par rapport aux Russes, à la Russie, à notre passé, présent et futur. C'est cette vision qu’expriment mes amis espagnols, qui me disent: « Nous aimons les Russes indépendamment du fait qu’ils soient communistes ou monarchistes ». Ils incarnent l'idéal. Et ils ont raison car il y a non seulement des individus mais aussi des pays entiers qui changent leur orientation politique, bien que, malgré cela, les intérêts fondamentaux restent les mêmes dans le fond.
En définitive, je me sens beaucoup plus proche de la droite. Ce n'est pas par hasard que Naslédnié Predkov (« L'héritage de nos ancêtres »), possède un sous-titre « revue des perspectives de droite ». Mais la question est de savoir de quelle droite il s'agit. « Les anciennes droites » diffèrent entre elles, les « nouvelles droites » sont aussi hétérogènes. Chez nous en Russie, par exemple, il y a des tendances extrémistes qui n'ont pas de lien réel avec la tradition nationale. Ce sont les habituels extrémistes de gauche: soit par le fond, soit par le langage, soit par la forme. C'est pour cette raison que la première chose à faire consiste à s'entendre sur les questions principales et à chercher ensuite des alliés.
Mais il y a autre chose. L'Europe occidentale, actuellement, n’est pas satisfaite de l'influence excessive des USA dans sa région. Mais elle possède des intérêts russes. En effet, l’intégration des petits Etats de l’Europe orientale ou septentrionale dans le marché commun et l'OTAN etc l'arrange parfaitement car dans ce cas, le rôle de ces mêmes Etats d'Europe occidentale s'accroît et leur structure s'actualise et se dynamise. Il serait plus avantageux pour les Russes que ce processus de dynamisation se développe à l'Est et au Sud par le territoire russe. Mais ce sont justement les conflits militaires provoqués et artificiellement entretenus en Europe orientale qui l'empêchent.
Votre organisation a lancé l’initiative « Synergon/Synergies Européennes » avec laquelle je me suis familiarisé en lisant les pages de la revue Impérativ (n°2), dirigée par Vladimir Wiedemann. Le document qu’il y a publié contient des pensées remarquables et constructives et comme, on le dit dans ce cas, chargées d'optimisme. Je suis surtout frappé par l'appel des auteurs à la conservation de la mémoire historique, des cultures enracinées et développées, ayant des traditions spirituelles riches. Vous comprenez profondément les problèmes écologiques et économiques de l'époque actuelle, vous ouvrez des perspectives aux jeunes, aux innovateurs, aux forces dynamiques. Ce sont surtout notre politique d'information et votre intention de contribuer à la création des bases d'un système de soutien intellectuel réciproque entre ceux qui partagent les mêmes idées « sur toute l’étendue du Grand Ordre continental » qui n'ont intéressé. Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas ici de l'Europe occidentale qui attire vers elle une partie des pays d'Europe orientale dans les intérêts de l’OTAN mais de la formation sur tout notre continent d'une communauté qualitativement différente pour toute l'Eurasie.
Quelle forme prendra cette nouvelle communauté géopolitique, c'est avec le temps que nous le verrons. S'agirait-il de cet Empire Sacré entièrement autonome auquel vous aspirez ou d'une nouvelle Sainte-Allianœ ou de l'héritière de l'Union Soviétique ? Pour le moment, il n'y a pas de réponse précise à cette question comme à beaucoup d'autres. Il est clair que le chemin vers le bloc continental ne sera pas facile et, à l'avenir, il ne faut pas s'attendre à une solution rapide et pacifique de tous les problèmes existants.
Qu'est-ce que l'on peut proposer de concret aux membres de la « Synergies européennes » ? Tout d'abord, il s'agira d’apprendre à se connaître en profondeur. Pour le moment, je ne connais pas bien l'UE et je ne suis prêt qu'à avoir un rôle d'observateur. En deuxième lieu, il s'agira d'un champ intellectuel et d'information. Il sera indispensable de comparer notre terminologie, nos valeurs, nos objectifs. Il ne faut pas se hâter de créer un « nouvel ordre », en imitant les modèles historiques qui n'ont pas fonctionné autrefois ou qui se sont auto-éliminés. La troisième étape pourrait être une conférence permanente apte à faciliter le passage de la solution des problèmes théoriques aux questions pratiques. Ensuite, on pourrait envisager la publication d'un périodique en plusieurs langues étrangères y compris le russe.
Mais actuellement la Russie n'offre que rarement le matériel, prêt à être publié, pour « Synergies Européennes ». C'est une situation anormale. Elle ne correspond pas à l'apport des Russes au développement du continent. Par conséquent, nous devons tout d'abord créer des conditions aptes à faire naître une collaboration réciproque et passer ensuite aux questions pratiques d'organisation et de droit.
Pour conclure, je voudrais remercier personnellement Robert Steuckers pour l'attention qu'il consacre à la Russie, au nouveau mouvement de droite, à la revue « L'Héritage de nos ancêtres » et aussi pour m'avoir offert l'occasion de m'exprimer sur les pages de votre publication. Pendant que l'on préparait l'interview à l'impression, Anatoli M. Ivanov m'a montré une sélection des numéros de «NdSE » et de «Vouloir» de ces dernières années. Je m'en félicite ! Vous publiez une revue tout à fait nécessaire et sérieuse. Ce sont surtout les éditions spéciales consacrées à l'idée russe et au bolchevisme national qui m'ont plu.
Permettez moi de souhaiter que nos rapports se développent ultérieurement sur la base d’un intérêt réciproque, d'une profonde compréhension mutuelle et des liens constructifs et amicaux. Ensemble, nous constituerons une force !
Pavel TOULAEV.
2 février 1998, rédaction : 15.10.98
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : synergies européennes, nouvelle droite, russie, entretiens, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 04 décembre 2009
Entretien avec Tomislav Sunic - Journal "zur Zeit" (Vienne)
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Entretien avec Tomislav Sunic
Journal zur Zeit (Vienne)
Tomislav Sunic est né en 1953 à Zagreb. Il est l'auteur de trois ouvrages importants: Against Democracy and Equality. The European New Right et Dissidence and Titoism (tous deux chez Peter Lang à Berne/Francfort) et Americka Ideologija (= L'idéologie américaine). A cause de sa dissidence politique, il a dû émigrer aux Etats-Unis en 1983, où il a étudié et obtenu son doctorat à la California State University à Sacramento et à l'University of California à Santa Barbara. Il a écrit pour plusieurs journaux aux Etats-Unis et enseigné à la California State University à Long Beach et au Juniata College en Pennsylvanie. Depuis 1993, il est revenu en Europe. Il écrit aujourd'hui pour Chronicles of American Culture et pour les journaux croates Hrvatsko Slovo et Matica. Robert Steuckers l'a interrogé pour l'hebdomadaire viennois zur Zeit.
Q.: Dr. Sunic, dans quel contexte familial avez-vous grandi? Quelles sont les influences idéologiques que vous a transmises votre père?
TS: Mon père était avocat, il défendait les dissidents politiques. Deux fois, il a été emprisonné pour non-conformité politique dans la Yougoslavie communiste. Il était hostile au communisme et fortement imprégné du catholicisme paysan croate. Amnesty International l'a adopté comme exemple, parce qu'en 1985 il était le prisonnier politique le plus âgé du bloc communiste est-européen. La Frankfurter Allgemeine Zeitung et le journal Die Welt se sont engagés pour lui. Nous vivions dans des conditions très modestes, nous n'avions ni télévision ni voiture. Mon père pensait que seuls les livres transmettaient une culture réelle. Nous subissions sans cesse toutes sortes de tracasseries; mon père a rapidement perdu le droit d'exercer sa profession. Pendant la guerre, il n'avait nullement appartenu au parti oustachiste et se montrait plutôt critique à l'égard du système politique de Pavelic. Mon père a simplement servi dans les unités de défense territoriale (Domobran). Il a aujourd'hui 83 ans et a publié ses mémoires en 1996 sous le titre Moji “inkriminari” zapisi (= Mes papiers “incriminés”), ce qui a suscité beaucoup d'intérêts dans le nouvel Etat croate.
Q.: Comment décririez-vous votre propre voie philosophique et idéologique?
TS: Pour être bref, je commencerais par dire que je suis un “réactionnaire de gauche” ou un “conservateur socialiste”. Je n'appartiens à aucune secte, à aucun parti théologien et idéologue. J'étais anti-communiste comme mon père mais, quand j'étais jeune, ma révolte personnelle a pris l'aspect du hippisme. Je me suis rendu à Amsterdam puis en Inde, à Srinagar au Cashemir et dans la ville de Goa. L'alternative au communisme, pour moi, était, à l'époque, la communauté hippy. Je m'opposais à toutes les formes d'établissement, quelle qu'en ait été la forme idéologique. J'ai cependant bien vite compris que le hippisme était une triste farce. Pour m'exprimer sans détours: “Même en tirant des joints, les hippies ont réussi à reproduire une sorte de hiérarchie accompagnée de toutes les hypocrisies possibles”. Cela vaut également pour le féminisme et le mouvement gay. Ma seule consolation a été la lecture des grands classiques de la littérature mondiale. Eux seuls sont les antidotes aux conformismes. Enfant, je lisais Tintin en français, Karl May en allemand, de même que le poète Nikolas Lenau. Adolescent, j'ai continué à lire des livres allemands, français et anglais. C'est armé de cette culture livresque et de mon expérience hippy que j'ai découvert la musique rock, notamment Krafwerk et Frank Zappa, qui était tout à la fois anarchiste, pornographe et non-conformiste. Zappa a été très important pour moi, car il m'a appris la puissance de la langue réelle contre les hypocrisies des établis. Avec lui, j'ai appris à maîtriser le slang américain, que j'utilise très souvent dans mes écrits, afin de tourner en dérision l'établissement libéral de gauche, mais cette fois avec l'ironie et le sarcasme du conservateur.
Q.: Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos études?
TS: En Croatie, au temps de la domination communiste, j'ai étudié la littérature, les langues modernes et la littérature comparée. En 1977, j'avais achevé mes études. Sur les plans esthétiques et graphiques, je ne pouvais plus supporter le yougo-communisme, la langue de bois et l'économie népotiste des Balkans. Cela me faisait littéralement gerber. En 1980, j'ai saisi la première occasion venue pour sortir du pays en travaillant comme interprète dans une entreprise yougoslave en Algérie. En 1983, j'ai émigré aux Etats-Unis. Là-bas, je me suis aussitôt plongé dans la littérature non-conformiste. A cette époque, mes auteurs favoris étaient Kerouac et le Français Barbusse; j'ai aussi lu Sartre, non pas parce qu'il était homme de gauche, mais parce qu'il était un dénonciateur caustique, il démasquait les hypocrisies. Je n'oubliais pas Hermann Hesse qui me rappelait mon voyage en Inde.
Q.: Aux Etats-Unis, vous avez découvert le néo-conservatisme américain...
TS: Je dois d'abord vous préciser que le néo-conservatisme américain ne peut pas être mis sur pied d'égalité avec le néo-conservatisme européen. Ce sont des écoles de pensée différentes. Ensuite, la gauche, la droite, qu'est-ce que cela signifie encore aujourd'hui? Je préfère distinguer les gens entre conformistes et non-conformistes. Mais dans les milieux néo-conservateurs américains, l'homme qui m'a le plus impressionné est Thomas Molnar. C'était lui mon maître-à-penser, sans doute parce qu'il est Hongrois et appartient à l'espace culturel de l'ancienne monarchie austro-hongroise. A l'évidence, Molnar est un conservateur, mais il reste un homme capable de manier l'ironie avec beaucoup d'humour. C'est ainsi que Molnar va toujours à l'essentiel. Ensuite, le spécialiste américain de Hegel et de Schmitt, Paul Gottfried, a exercé sur moi une profonde influence. J'ai ensuite connu Paul Fleming, qui dirige le journal Chronicles of American Culture. Je fais partie de son équipe rédactionnelle depuis plus de dix ans. En dépit de mes excellents contacts avec les néo-conservateurs américains, je suis resté une âme rebelle; c'est pourquoi je me suis intensément proccupé de la nouvelle droite ou du néo-conservatisme en Europe, notamment de l'œuvre d'Armin Mohler avec sa vision du “réalisme héroïque”, des travaux de Caspar von Schrenck-Notzing et de son hostilité à la dictature de l'“opinion publique”, des écrits de Gerd-Klaus Kaltenbrunner avec sa fascination pour la beauté dans notre monde en ruines, pour de Benoist et la synthèse qu'il a offerte dans Vu de droite. J'ai lu les auteurs que recommandaient les nouvelles droites européennes. Mon livre sur la nouvelle droite est en fait le résultat de mon plongeon dans cet univers culturel. Cependant, le label “nouvelle droite” peut être trompeur: je préfère parler de ce mouvement culturel, du moins pour son volet français, de “grecisme”. Je partage là la vision de de Benoist quand il conçoit son propre mouvement comme une centrale de recherche dynamique visant le maintien de la vivacité de notre culture européenne. Inutile d'ajouter que j'ai apprécié Céline (avec son âpre argot parisien qui détruit préventivement toutes les certitudes établies), Benn et Cioran, avec leur style inimitable. Ils restent tous trois les auteurs favoris du rebelle, que je suis et resterai.
Q.: En 1993, vous êtes rentré en Croatie et en Europe. Comment jugez-vous la situation en Europe centrale et orientale?
TS: Le destin de la Croatie est étroitement lié à celui de l'Allemagne, quel que soit par ailleurs le régime politique qui règne dans ce pays. Comme le disait le fondateur suédois de la géopolitique, Rudolf Kjellén: “on ne peut échapper à sa détermination géopolitique”. D'autre part, Erich Voegelin nous a appris que l'on peut certes rejeter les religions politiques comme le fascisme ou le communisme, mais que l'on ne peut pas échapper au destin de sa patrie. Le destin allemand, celui d'être encerclé, est comparable au destin croate, même si la Croatie n'est qu'un petit pays de la Zwischeneuropa. Un facteur géographique lie les Allemands et les Croates: l'Adriatique. Le Reich et la Double-Monarchie austro-hongroise ont été des Etats stables tant qu'ils ont bénéficié d'une ouverture sur la Méditerranée par la côte adriatique. Les puissances occidentales ont toujours tenté de barrer la route de l'Adriatique aux puissances centre-européennes: Napoléon a verrouillé l'accès de l'Autriche à l'Adriatique en annexant directement la côte croate à la France. C'était les “départements illyriens”. Plus tard, les architectes du désordre de Versailles ont réussi à parfaire magistralement cette politique. L'Allemagne et l'Autriche ont perdu leur accès à la Méditerranée et la Croatie a perdu son hinterland centre-européen et sa souveraineté. C'est là la clef du drame croate au cours du XXième siècle.
Q.: La Croatie sera-t-elle en mesure de trancher le nœud gordien? Pourra-t-elle utiliser sa position entre la Mitteleuropa et la Méditerranée de façon optimale?
TS: Notre classe moyenne et notre intelligentsia ont été totalement liquidées par la répression titiste après 1945. D'un point de vue sociobiologique, ce fut la pire catastrophe pour le peuple croate. La circulation optimale et normale des élites n'a plus été possible. L'“homo sovieticus” et l'“homo balkanicus” ont dominé le devant de la scène, au détriment de l'“homo mitteleuropeus”.
Q.: Comment voyez-vous les relations futures entre l'Etat croate et ses voisins dans les Balkans?
TS: Tout mariage forcé échoue. Deux fois au cours de ce siècle, le mariage entre la Croatie et la Yougoslavie a échoué. Il vaudrait mieux vivre avec les Serbes, les Bosniaques, les Albanais et les Macédoniens en bons voisins qu'en mauvais époux qui ne cessent de se quereller. Tous les peuples de l'ancienne et de l'actuelle Yougoslavie devraient pouvoir disposer de leur Etat. L'expérience yougoslave est un exemple d'école qui montre clairement l'échec de toute multiculture imposée de force.
Q.: Que se passera-t-il après Tudjman?
TS: L'avantage principal de Tudjman a été de dénoncer totalement l'historiographie propagandiste du yougo-communisme. Pour une grande partie, il a contribué à guérir le peuple croate et surtout sa jeunesse des affres de la falsification de l'histoire.
Q.: Docteur Sunic, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
(propos recueillis le 13 décembre 1997).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : croatie, europe centrale, mitteleuropa, politique internationale, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 novembre 2009
Pour sortir de l'hyperconsommation

Pour sortir de l'hyperconsommation |
| « La définition du bien-vivre a profondément changé au cours de ces dernières années, de même que l’importance accordée à la réussite économique et à la consommation ostentatoire. Que faut-il changer aujourd’hui ? Selon moi, il faut éradiquer ou, à tout le moins, largement tempérer cette obsession de l’achat qui est devenue le principe organisateur de la vie occidentale. […] Le lien avec la crise économique actuelle est évident. Dans une culture où l’envie impérieuse de consommer domine la psychologie des citoyens, les gens sont prêts à tout pour se donner les moyens d’acheter : trimer comme des esclaves, faire preuve de rapacité au travail et même enfreindre les règles pour maximiser leurs gains. C’est également pour cela qu’ils achètent des maisons au-dessus de leurs moyens et multiplient les crédits. On peut dire sans risque de se tromper que l’hyperconsommation a elle aussi joué un rôle dans le désastre économique. Toutefois, il ne suffit pas de la pointer du doigt pour la faire disparaître du cœur de nos sociétés. Il faut la remplacer par quelque chose d’autre. […] L’expérience montre que, lorsque la consommation sert de substitut à l’objet des besoins supérieurs, elle est semblable au tonneau des Danaïdes. Plusieurs études ont révélé que, dans les pays où le revenu annuel moyen par habitant est supérieur à 20’000 dollars, il n’y a aucune corrélation entre l’augmentation des revenus et le bien-être des populations. Ces travaux indiquent en outre qu’une grande partie des habitants des pays capitalistes se sentent insatisfaits, pour ne pas dire profondément malheureux, quel que soit leur pouvoir d’achat, parce que d’autres personnes gagnent et dépensent encore plus qu’eux. Ce n’est pas la privation objective qui compte, mais le sentiment relatif de privation. Et comme, par définition, la plupart des gens ne peuvent pas consommer davantage que les autres, l’hyperconsommation nous renvoie toujours à ce dilemme. […] L’hyperconsommation ne touche pas seulement la classe dominante des sociétés d’abondance ; les classes moyennes et populaires sont elles aussi concernées. Un grand nombre de personnes, toutes catégories sociales confondues, ont le sentiment de travailler pour tout juste parvenir à joindre les deux bouts. Pourtant, un examen attentif de leur liste courses et de leurs garde-robe révèle qu’elles consacrent une bonne part de leurs revenus à l’achat de biens liés au statut social, comme des vêtements de marque et autres produits dont le besoin n’est pas réel. Cette mentalité peut sembler tellement ancrée dans la culture occidentale que toute résistance serait vaine. Mais la récession économique a déjà poussé bon nombre d’individus à acheter moins de produits de luxe, à freiner sur les fêtes somptueuses et même à accepter de réduire leur salaire ou de prendre des congés sans solde. Jusqu’à présent, la plupart de ces comportements ne sont pas volontaires ; ils sont dictés par la nécessité économique. Il faut toutefois voir là l’occasion d’aider les gens à comprendre qu’une consommation réduite ne reflète pas un échec personnel. C’est le moment ou jamais d’abandonner l’hyperconsommation pour se consacrer à autre chose ! […] Une société qui résisterait au consumérisme au profit d’autres principes organisateurs ne se contenterait pas de réduire la menace d’une crise économique et de rendre ses membres plus heureux. Elle présenterait également d’autres avantages. Elle consommerait par exemple moins de ressources matérielles et aurait donc beaucoup moins d’effets nocifs sur l’environnement. Elle favoriserait aussi une plus grande justice sociale. »
Amitai Etzioni, Prospect (Londres), janvier 2009 |
00:15 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, sociologie, philosophie, consommation, critique, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 novembre 2009
Meltdown
 Meltdown
Meltdown
February 19, 2009
By Joe Priestly / http://bnp.org.uk
It seems like every day brings with it a new and significant development and always more evidence of the conspiracies and cock-ups of Brown and co. It’s impossible to keep pace with events – this feels like meltdown. Nothing works and nothing makes sense; reality is catching up with the liblabcon fantasy.
Over the past sixty years or so the liblabcons have been spinning a web of lies to justify the destruction of British culture and the genocide of the British people. Their common purpose is to remake Britain as a society consisting of peoples and cultures from every corner of the earth. The responsibility for putting in place the final pieces of this multicultural jigsaw fell to the New Labour government, ably supported of course by the ‘opposition’. The economy was the key. It was essential that people had money to spend on the latest distractions. Hence the government-sponsored credit boom; it was a smokescreen behind which they hid our demise.
They didn’t want us to trouble ourselves with concerns about immigration, Islam, asylum, education, crime, the EU… just in case we came to the wrong conclusion. So they gave us easy credit and unbridled consumerism and added the big match and the soaps to stop us thinking about what really matters.
But a financial storm blew away their easy-money smokescreen and left the liblabcons with nowhere to hide. People are now counting their pennies and thinking less about hi-tech toys and the latest Big Brother controversy and more about the state of the nation and its impact on their lives and futures. They’re waking up to the mess that the liblabcons have made of this country.
The establishment is ideology-led and has convinced itself that nature can be moulded to fit its plan. And it’s this thinking that’s brought Britain to its sorry state. But perhaps it had to come to this. Maybe nothing short of crisis would have woken us from our slumber – that is the British way isn’t it? It seems to me though that we’re waking up now. What’s that they say about the problem being the catalyst for its own solution? And we can see it in action in the increasing number of people who are making the connection between the ideology and its manifestations.
The establishment is founded on a lie so monumentally absurd that it’s spent all its life lurking between the lines and only ever appearing as hint and suggestion. Stripped of all its camouflage the bare-faced lie is that the genocide of the British people is good for the British people – little wonder they had to sugar-coat it with a billions tending towards trillions credit boom.
But that alone wasn’t enough. It was necessary also for them to rework every aspect of society to discourage dissent and to encourage the British people’s acquiescence in their own genocide. It worked for a long time and that and the booming economy encouraged the liblabcons to think that the good times would last forever and that their transformation of Britain would proceed unnoticed.
That was then; the party finished a while back. Post party, in the cold light of a looming depression, the changes imposed on Britain are not all that their liblabcon architects had painted them to be. What they said would be utopia looks increasingly like chaos – and that’s before the lights start going out. The consequences of the lie are beginning to be felt and it’s dawning on British people that the reality of the lie is their destruction.
And as Nazi Propaganda Minister Goebbels* observed, “The lie can be maintained only for such time as the state can shield the people from the political (and) economic… consequences of the lie.” And he should know. The British political and media establishment used the credit boom to soften the impact of its ideology on the population; they encouraged people to focus on personal gain while they got on with the job of creating 21st century multiracial multicultural Britain. But the boom has turned to bust and their lie is there for all to see.
Politicians, power brokers, celebrities, and mainstream media-types have staked their reputations (read fortunes) on their sick lie and its bastard child multiracial multicultural Britain. The maintenance of the lie is all that separates them from ruin; without it they’d be irrelevant. They are the status quo and everything they do is aimed at holding that position; they have no choice but to maintain the lie. But now the spend fest is over. The cupboard is bare and winter approaches; the liblabcons have run out of the means to shield the British people from the consequences of the lie. The reality of mass third world immigration is upon us.
If we take fact as truth then a lie is a deliberate distortion of fact. In respect of mass immigration and its impact on British society the establishment distorts the facts so as to paint a positive picture of its creation the multiracial multicultural society. But the nearer a disaster looms the more it is recognised for what it is, irrespective of official explanations. Ignoring facts doesn’t make them go away nor does it diminish their truth.
The establishment lost the argument years ago and their position now is entirely dependant upon those members of the population that remain indifferent to politics and politicians until they impact on them personally. But the collapse of consumerism and the maturation of the multiracial multicultural society is encouraging even the formerly indifferent to pay attention to the shenanigans of people in power. The establishment sold out for short term advantage and the short term is almost up; the theft of a nation from under the noses of its people isn’t something that can go unnoticed forever. The British people are waking up to the liblabcons’ crimes.
Having distorted the facts for six decades the British establishment is in no position to face them. Facing facts will expose the lie and their world will come crashing down. Britain is a multiracial multicultural society because the establishment ignored the facts; in spite of the fact of the chaos of third world multiracial multicultural societies, Britain’s political and media elite facilitated the importation of millions of third world aliens into our midst as part of a plan to make Britain into such a society. Now the predictable is happening; multiracial multicultural chaos is playing on our streets.
Of course they never would have predicted it. Their world view, their equality dogma, prohibits any such prediction. And whereas a growing number of the rest of us are coming to believe that the liblabcons were negligent in failing to anticipate the chaos that would accompany mass third world immigration, the liblabcons continue the charade of the multiracial multicultural society as utopia – in the face of growing evidence to the contrary. You’ve got to laugh.
The liblabcons put me in mind of a kind of circus act that I saw on TV years ago but haven’t seen since. I don’t know what it’s called but it involved spinning plates (crockery) on canes. Those that know what I’m talking about please hum along for a moment while I explain for those that don’t… A number of canes (at a guess about 50) is set vertically and fixed at the lower point, the ‘artist’ gyrates each cane in turn and sets a plate spinning on the upper point so that it balances under its own momentum, he does the same with each cane until each has a plate spinning on it. He then attempts to maintain this equilibrium by moving from one cane to another to tend to those plates in danger of slowing beyond the critical and crashing to the floor. In a short while his movement has become a rush from one cane to another as the plates lose momentum faster than he can maintain it. And then the inevitable happens. First one plate then another and another until almost in unison the rest crash to the floor.
Their situation is analogous to that of the circus artist upon the realization that the inevitable is, well, inevitable. The plates haven’t yet all crashed to the floor but they’re going to. Like the circus artist the liblabcons have created something that can’t be maintained but unlike him they can’t just throw up their hands and walk away from the crashing plates; they’ve got far too much invested in keeping things spinning for as long as possible.
But in a meltdown everything goes wrong. And the liblabcons’ frantic effort to keep their metaphorical plates spinning merely draws attention to the illogic of setting them spinning that way in the first place. Our economy and our society aren’t working because they’re founded on an ideological fallacy, universal equality and the theory of the interchangeability of man. Yet the liblabcons’ solutions to the problems caused by their way of thinking is yet more of the same; they’re trying to solve society’s problems with the same thinking that created them. And they’re beginning to look ridiculous because of it; every time they open their mouths they contradict themselves. Their world view is in meltdown, and yet it looked so good on paper – or so they used to say.
To paraphrase Karl Marx, Marxism is collapsing under the weight of its own contradictions. There’s so much going wrong now in this country that our establishment and its idiotic thinking are permanently under the spotlight and both are being revealed as barrels of contradiction. That’s why no liblabcon type will ever stand his ground – they haven’t got a coherent argument so they avoid argument. It’s a variation on the no-platform theme. Even establishment media persons are shuffling their feet away from liblabcon egalitarianism. The lie is being found out and every time an establishment mouthpiece attempts a cover up they succeed only in shoving their foot further down their throat. Everything they do is founded on a lie and the lie is being undone by its own contradictions.
British society today is a manifestation of liblabcon equality ideology. The alienation that we feel is a consequence of society following the incoherent ideology of egalitarianism, which quite literally doesn’t make sense. It is smoke and mirrors and it’s survived to this point, since WWII, on a combination of bullying, bullshit, and brass neck. It’s bullied, bullshit, and brass necked its way to intimidating the rest of us into going along with its world view. But in spite of the power of its ‘followers’, equality ideology has never convinced more than a committed few. Tolerance of its ‘inherent contradictions’ requires a dedication far beyond the means of most people; the majority of those that go along with equality ideology do so because it’s the direction of least resistance.
The reality is that equality ideology has a fundamental weakness; it lacks continuity. Its argument is riddled with inconsistencies and so its proponents always seek refuge in vagueness. These people need plenty of room for manoeuvre.
Yet their room for manoeuvre is shrinking. It’s becoming clearer by the hour that the problem is the liblabcons and their equality thinking – the logical conclusion of which is the state of Britain today, economically, socially, and spiritually. Having created this mess, the establishment is now in the unfortunate position of not only having to defend it but to promote it as well. And so naturally incoherence features in every aspect of everything that the establishment does and says. Whatever the policy, whatever the department, whatever the statement, you know it won’t make sense. There are countless examples of the idiocy of liblabcon thought in action; three which immediately come to mind are free movement of labour, the incarceration of immigrants, and the Afghanistan ‘war’.
In their blind pursuit of ‘equality’ the liblabcons sanctioned the free movement of labour and in so doing signed away this country’s right to favour its own workers on its own soil over foreign workers on its soil – surely the most treasonable act ever committed. I wonder if they think they’re going to get away with that one forever. And as if that wasn’t bad enough, from the liblabcons’ long term health point of view that is, by severing their commitment to their own population they sort of compound their problems by effectively making themselves redundant. If they’re not there to represent our interests what exactly are they for? Is that what they mean by an unintended consequence, or was it intended and part of a conspiracy of extreme subtlety? I can never work out whether their determination to have us see them as lying, idiotic, thieving, hypocritical, treacherous cowards is due to incompetence or whether it’s part of a cunning plot that’s beyond my wit to understand.
It seems to me they’re paying the price of living a lie and the lie is coming back to haunt them.
Having said that, I’m sure I could put the case for the liblabcons better than they do. Consider the gaga they offer in explanation for the statistical over-representation of ethnic minorities in prisons and in secure mental health institutions. You don’t need me to tell you what it is – they parrot the Marxist line, that these inequalities of outcome are a consequence of the racism of the criminal justice and mental health systems. Any other explanation would set in motion a train of thought that leads back to the source of the problem, equality dogma and its application; the Marxists’ intention is to set the train of thought on a wild goose chase after whites as the cause of the problem. It’s the easy option and it’s the only one that doesn’t question their insane world view.
But there’s a nice irony in this; their explanation is a perfect example of the inconsistency it was intended to disguise. For them the problem is not the equality idea but opposition to the idea. And so every explanation they offer for any of society’s problems must always be tailored to protect the easily bruised equality idea. It’s this that has them tripping over their own feet.
Ethnic minorities are over-represented in prisons and mental hospitals either because they’re more inclined to criminality and mental health problems or because they’re not treated the same as the majority population. If it’s not one it’s the other. And that’s a no brainer for the establishment whose equality dogma dictates that ethnic minorities can never be the cause of any problem. The problem therefore is the majority population. It’s that catch-all again, racism, the only explanation that doesn’t question the equality idea.
But it’s here they get their wires crossed. According to them the criminal justice system is racist because it treats ethnic minorities differently from ethnic Britons, and the mental health system is racist because it treats ethnic minorities the same as ethnic Britons and fails to take into account cultural and ethnic difference in behaviour when diagnosing mental illness. Doesn’t that just sum up these gibbering liblabcon wrecks? The criminal justice system is racist because it discriminates; the mental health system is racist because it doesn’t discriminate.
They’re less concerned with the soundness of their argument than they are with arriving at the right conclusion; equality ideology must never be seen to be a problem. All their roads lead to racism.
The “racism” accusation began as a tactic, it developed into a strategy, and now it looks increasingly like a last ditch effort. You can tell they’re no longer comfortable with it, it’s like they’re suddenly aware that British people are sick to death with the accusation and contemptuous of its argument. But when liblabcon backs are against the door – it’s either racism or the admission that their thinking has been wrong all along.
Nothing they say makes sense because their argument is founded not on hard facts but on wishful thinking. Their explanations run contrary to the facts and as the facts become clearer so do the holes in the explanations. That’s what’s happening now; the reality of the multiracial multicultural society is hitting home and the liblabcons’ equality/diversity sweet talk is at such odds with the facts that it’s encouraging the scepticism it’s designed to stop.
Consider the conflict in Afghanistan: The establishment is putting our soldiers’ lives on the line in Afghanistan allegedly to protect Britain from terrorism yet at the same time it keeps Britain’s borders open to any Tom, Dick, or Harry who cares to cross them. Anybody else see the contradiction here? Yet the liblabcons don’t get it – their idiotic ideology won’t allow them to.
They’re in denial. It’s a common response to overwhelming collapse. They’re taking the only option open to them, they’re burying their faces in their comfort blankets and singing nursery rhymes about joy and diversity. Liblabcon thought is reaching its logical conclusion – illogicality. They’re in meltdown.
00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, grande-bretagne, angleterre, europe, affaires européennes, politique, politique internationale, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 novembre 2009
La réinformation par l'Histoire, les valeurs et les permanences
La réinformation par l'Histoire, les valeurs et les permanences
Deuxième Journée d’études sur la réinformation, organisée le 24 octobre 2009 par la Fondation Polémia.
Communication de Timour Jost / Ex: http://polemia.com/
L’identité est un postulat. Elle est vraie parce qu’elle repose sur la vie, sur les conditions mêmes de l’existence. Maurice Barrès disait : « Vous préféreriez que les faits de l’hérédité n’existassent pas, que le sang des hommes et le sol du pays n’agissent point, que les espèces s’accordassent et que les frontières disparussent . Que valent vos préférences contre les nécessités » (1).
L’Histoire donne à l’identité une constance dans le temps. Elle inscrit dans la longue durée les permanences de l’inné. Qui sommes nous ? D’où venons nous ? Où allons nous ?
A l’inverse de l’Histoire, l’actualité s’inscrit dans le temps court, le présent immédiat. Un évènement chasse automatiquement l’autre. Les faits apparaissent comme désarticulés, sans connecteurs logiques. Face au péril de ce « présent permanent », l’Histoire pose un fil conducteur, celui de notre « plus longue mémoire ».
La réinformation s’organise autour de l’observation des faits. L’Histoire est donc un formidable outil pour la réinformation car la réalité l’emporte toujours sur l’abstraction idéologique.
L’observation des faits
La première règle à respecter pour un réinformateur est l’observation des faits. Sentiments, emportements doivent être laissés de coté. L’idéologie ne doit pas se substituer aux faits. Bossuet disait à ce sujet que « le plus grand dérèglement de l’esprit consiste à voir les choses telles qu’on le veut et non telles qu’elles sont ».
Trop souvent l’observation froide des évènements est délaissée au profit du plaquage d’idées préconçues. Ainsi, pour nombres de commentateurs, l’identité est une illusion. Elle relève du mirage, de la fixation, de la reconstruction tardive. Si l’on suit le discours colporté par les élites mondialisées, il n’y a pas de choc des civilisations. Tout juste quelques déraillements ponctuels et regrettables de la grande machine à uniformiser la planète.
Mais pour qu’elle raison devrions-nous emprunter de tels prysmes déformants ? Nous savons que si les réalités, géographiques, historiques, identitaires, pèsent encore tant sur les destinées collectives, c’est parce qu’elles sont des constances que des millénaires de progrès scientifiques, techniques, et d’innovations idéologiques n’ont jamais réussi à effacer.
Le 18 avril 1984, huit ans avant que la Yougoslavie n’implose, des milliers de manifestants protestent à Sarajevo contre le pouvoir communiste, cela en brandissant non pas des drapeaux de l’OTAN ou des Etats-Unis mais ceux de l’Arabie Saoudite et de la Turquie. Les habitants de Sarajevo en agissant de la sorte, voulaient montrer combien ils se sentaient proches de leurs coreligionnaires musulmans et montrer au monde qui étaient leur vrais amis et donc par jeu de miroir leurs vrais ennemis (2).
Un observateur avisé aurait pu prédire au vu d’une telle démonstration, les signes annonciateurs du processus de décomposition de l’Etat yougoslave et la création d’Etats islamiques dans les Balkans.
Le temps long
La deuxième règle à respecter repose sur le principe de causalité. Etudier un fait conduit mécaniquement à se poser la question de son origine. Les commentateurs, par paresse intellectuelle, délaissent trop souvent cet exercice de remonter dans le temps. Un événement politique ne surgit jamais au hasard. Il est l’aboutissement d’un processus, qui au cours du temps conduit à son paroxysme. Comme le précise l’historien Jacques Bainville, « D’ordinaire en politique les effets sont aperçus quand ils commencent à se produire, c’est- à dire quand il est trop tard » (3).
Le 16 octobre 1994 à Los Angeles, cent mille personnes ont défilé dans les rues dans une mer de drapeaux mexicains. Il s’agissait de protester contre la proposition 187 qui allait faire l’objet d’un référendum populaire. Celle-ci stipulait que les immigrés illégaux et leurs enfants n’auraient plus accès aux subsides de l’Etat californien. Des commentateurs candidement s’étonnèrent : « Pourquoi défilent-ils sous la bannière mexicaine alors qu’ils exigent des Etats-Unis le libre accès aux études et autres prestations sociales ? Ils auraient du se munir de la bannière étoilée » (4).
Les causes d’un tel phénomène sont toujours à rechercher dans le temps long. Les permanences, les lignes de césure civilisationnelles, s’inscrivent dans ce cadre ; certains conflits identitaires, dits conflits d’antériorité, font référence à la fixation ancienne de populations sur une terre pour légitimer un contrôle territorial.
En 1848, suite à la guerre américano-mexicaine, le Mexique est contraint de céder par le traité de Guadalupe Hidalgo, plus de 40% de son territoire soit plus de 2 millions de Km2. Les Etats de Californie, du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, de l’Utah, du Colorado sont rattachés à Washington. Ce traumatisme n’a depuis lors jamais cessé de hanter l’imaginaire national des Mexicains. Loin de se considérer comme étrangers en Californie, ils estiment qu’ils n’ont pas traversé la frontière mais que c’est la frontière qui les a traversés… Par conséquent, ils n’ont pas à arborer les couleurs de la puissance occupante.
Vouloir remonter le fil du temps empêche de s’arrêter à un temps figé. Si les causes sont anciennes, il faut être apte d’aller à leur rencontre jusque dans les époques les plus reculées ; et il faut ensuite les accompagner à travers les siècles pour souligner les redondances de leurs effets.
Les permanences
La troisième règle à respecter réside dans la compréhension des permanences. En politique disait Bainville « Il n’y a pas de politique nouvelle. Il y a la politique tout court, fondée sur l’expérience historique, sur la connaissance des hommes et des peuples » (5).
La connaissance de notre passé est une clef irremplaçable pour la compréhension de notre monde. « Les morts gouvernent les vivants », remarquait Auguste Comte. Outre les dates, les évènements, le reinformateur doit tenir compte de la nature humaine et de sa pluralité. Il n’existe pas d’homme abstrait et interchangeable de l’Amazonie au Caucase, mais un homme réel enraciné, tributaire de son identité. A travers les âges, les mêmes données, politiques, religieuses, civilisationnelles entraînent les mêmes conséquences.
Quelle différence entre le djiadhisme terroriste d’aujourd’hui et celui conduit par les compagnons du Prophète Mahomet ? Aucun. Tous les deux prennent leur source dans le Coran.
En réalité, la technique contemporaine ne fait qu’accélérer ce phénomène en intensité et en violence sans en altérer la nature profonde. Si on considère le périmètre qu’occupe l’Islam, on peut en conclure que les musulmans vivent difficilement en paix avec leurs voisins. Or les musulmans ne représentent qu’un sixième de la population planétaire. Cette propension de l’Islam à la violence s’explique par sa nature. Religion du glaive, l’Islam glorifie l’esprit de conquête. Il a pris naissance dans les tribus belliqueuses de la péninsule arabique, accoutumées aux pillages et aux razzias. Autre facteur déterminant est l’inassimilation des musulmans. Elle est double : les pays musulmans ont des problèmes avec leurs minorités non-musulmanes, tout comme les pays non-islamiques en ont réciproquement avec leur communauté islamique. L’expulsion des populations morisques d’Espagne au XVIIe siècle, le génocide arménien trois siècles plus tard sont autant d’exemples frappants. Plus encore que d’autres religions monothéistes, l’Islam est une foi totale qui unit religion et politique. Il marque une distinction claire entre l’ami et l’ennemi. Ceux qui font partie du Dar al-Islam et du Dar al-Harb. Cette permanence se vérifie dans tous les conflits inter-religieux de ces vingt dernières années. En 2009, le New York Times a localisé quelques soixante-deux conflits ethniques à travers le globe. Dans la moitié des cas, il s’agissait d’affrontements entre musulmans et non musulmans (6).
Dans le monde d’après la guerre froide, l’identité, la tradition ont retrouvé une place centrale. Les permanences du passé sont autant de clefs pour comprendre les convulsions du temps présent. Ce qui régit la réalité ce n’est pas la bonté ou une quelconque morale droit de l’hommiste. Ce n’est pas « à force de plaintes et de tribunaux moraux que l’on se débarrasse des faits » disait Oswald Spengler (7). Sur le fond, la nature humaine ne change pas car animée des mêmes désirs, des mêmes soifs d’absolu ou de pouvoir, surtout quand elles se superposent à des constances géographiques, historiques ou religieuses. En fait, comme le rappelle Bainville, « L’homme, à toutes les époques et dans tous les siècles, se ressemble, il a les mêmes passions, les mêmes rêves. C’est le point capital. Hors de là, il n’y a qu’erreur et fantaisie» (8) .
Notes :
1) Maurice Barrés, Scènes et doctrines du nationalisme, Editions du Trident, Paris, 1988, p.441.
2) Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Editions Odile Jacob, Paris, 2001, p.15.
3) Jean Montador, Jacques Bainville, Paris, Editions France-Empire, 1984, p.108.
4) Op.cit. (2).p.16.
5) Op.cit.(3).p.88.
6) New-York Times, 22 janvier 2009.
7) Oswald Spengler, Ecrits historiques et philosophiques, Copernic, Paris, 1980.p.155.
8) Op.cit (3).p.243.
Timour Jost
00:20 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, réinformations, valeurs, philosophie, actualité, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 novembre 2009
Nada que celebrar y mucho que lamentar
Nada que celebrar y mucho que lamentar
Estos días se ha conmemorado el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Fecha para celebrar, ciertamente. En cambio es para lamentar el mismo aniversario del ‘consenso de Washington’: la peor versión del capitalismo que los siglos han visto (el neoliberalismo) cuyo antecedente fue la atroz involución conservadora perpetrada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los ochenta.
El cineasta Costa Gavras, comprometido siempre con la democracia y la justicia, formula así esa lamentación: “Cuando cayó el muro de Berlín pensamos que por fin el mundo sería diferente. Pero fue peor. Todo, medio ambiente, economía, paro. No se propuso una vida mejor, sólo ir hacia un mundo más oscuro”.
En la dogmática aplicación del neoliberal ‘consenso de Washington’ están las causas de la crisis que ha colocado el mundo al borde del desastre. Redactado por un oscuro economista del Institute for International Economics en noviembre de 1989, pretendía ser inicialmente un listado de directrices económicas para América Latina. Pero el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otras entidades internacionales rápidamente lo canonizaron como único programa económico posible para impulsar el crecimiento mundial. Demasiado tarde la crisis feroz les ha arrancado la venda de los ojos.
En esa dogmática lista de políticas económicas que es el ‘consenso de Washington’, se impone reordenar las prioridades del gasto público (entiéndase recortar el gasto público social). También es inaplazable la reforma fiscal (es decir, quienes tienen más, que paguen menos). Así como imprescindible liberalizar el comercio internacional (los países ricos hacen lo que quieren, pero los pobres y emergentes han de renunciar a sus aranceles). Por supuesto, hay que liberalizar la entrada de capitales extranjeros (descontrol y alfombra roja a la evasión de impuestos y ocultación de capitales). Y es indiscutible la desregulación de lo financiero (ahí está la crisis para demostrar cuan acertada fue tal directriz). Además de privatizar lo público (¿porque impedir que una minoría se enriquezca con lo que es de todos?).
Eso es el ‘consenso de Washington’. Quien pretenda que nada tiene que ver con la crisis demuestra que no hay peor ciego que quien no quiere ver. Hemos hablado y escrito sobre la crisis hasta la saciedad, pero hay que remachar que las causas de la crisis (reconocidas y confesadas con golpes de pecho y presunto arrepentimiento) no son más que la fiel aplicación de las políticas económicas del consenso de Washington. Como Chicago en los años 30, el de Capone, Moran y Frank Nitti; esto quiero, esto cojo.
En la lúcida versión del humorista español El Roto, el desorden neoliberal perpetrado hace veinte años se sintetiza en un humor agudo ilustrado con siniestras figuras de hombres poderosos, bien vestidos y gesto feroz o con abrumadas imágenes de pobres sorprendidos: “Si nada ganábamos cuando se forraban, porque hemos de perder cuando se la pegan. ¿El capitalismo? Una manita de pintura y como nuevo. Todo lo que dé dinero debe ser privado, y lo que arroje pérdidas, público. ¡Así que el desarrollo sólo era delincuencia! ¡La operación ha sido un éxito: hemos conseguido que parezca crisis lo que fue un saqueo!”
Recurrimos de nuevo a Costa Gavras cuando dice que “volvemos a los años anteriores a la Revolución Francesa, en los que una minoría, la nobleza, lo tenía todo. Hoy parece revivir aquello: una mayoría que hace todo el trabajo y consigue que la sociedad funcione, frente a la nueva aristocracia de los capitalistas. Necesitamos otra revolución, sin sangre, pero una revolución. Para cambiar esta situación”.
Hay que enfilar el hilo en la aguja y no estaría mal que fueran hechos y no palabras. Por ejemplo, volver a pelear por un impuesto a los movimientos especulativos de capital. Lo propuso en 1971 quien fue Nobel de Economía en 1982, James Tobin. La tasa Tobin es un 0,1% sobre el capital que se mueva para especular. Otro Nobel de Economía, Stiglitz, se ha sumado a quienes reclaman la implantación de dicha tasa. Para mostrar que es posible y no delirio de izquierdoso fumado, el gobierno de Lula impondrá un Impuesto de Operaciones Financieras (2%) al capital extranjero de operaciones especulativas con divisas en Brasil.
No es la revolución, pero todo es empezar.
Xavier Caño Tamayo
Extraído de Argenpress.
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : berlin, mur de berlin, allemagne, réflexions personnelles, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 septembre 2009
Lettre ouverte à Hervé Morin, ministre de la Défense euro-atlantiste
Lettre ouverte à Hervé Morin,
ministre de la Défense euro-atlantiste
Monsieur le ministre de la Défense de l’Occident,
Je m’autorise de vous interpeller avec un titre erroné puisque, renouant avec une mauvaise habitude pratiquée sous le septennat giscardien, le terme « nationale » a été supprimé de l’intitulé officiel de votre ministère. Permettez-moi par conséquent de vous désigner tour à tour comme le ministre de la Défense euro-atlantiste ou celui de la Défense de l’Occident, tant ces deux appellations me paraissent vous convenir à merveille.
Si je vous adresse aujourd’hui la présente algarade, sachez au préalable que je ne vise nullement l’élu local normand que vous êtes par ailleurs. L’adhérent au Mouvement Normand que je suis soutient, tout comme vous, l’indispensable (ré)unification normande des deux demi-régions. Notre désaccord concerne l’avenir de la France, de son armée et de l’Europe de la défense.
Je vous dois d’être franc. Quand en mai 2007, vous avez été nommé au ministère de la rue Saint-Dominique, j’ai immédiatement pensé à une erreur de recrutement : vous n’êtes pas fait pour occuper ce poste, faute d’une carrure suffisante. Comment cela aurait pu être autrement avec un Premier ministre qui, lui, est un fin connaisseur de la chose militaire depuis de longues années ? Il s’agissait surtout de vous récompenser pour avoir abandonné (trahi, diraient de mauvaise langues) entre les deux tours de la présidentielle votre vieil ami François Bayrou et rallié le futur président.
D’autres, tout aussi non préparés aux fonctions de ce ministère éminemment régalien, auraient acquis au contact des militaires une stature politique afin de viser, plus tard, bien plus haut. Hélas ! Comme l’immense majorité de vos prédécesseurs depuis 1945, voire depuis l’ineffable Maginot, et à l’exception notable d’un Pierre Messmer, d’un Michel Debré ou d’un Jean-Pierre Chevènement, vous êtes resté d’une pâleur impressionnante. Pis, depuis votre nomination, vous avez démontré une incompétence rare qui serait risible si votre action ne nuisait pas aux intérêts vitaux de la France et de l’Europe.
À votre décharge, je concède volontiers qu’il ne doit pas être facile de diriger un tel ministère à l’ère de l’« omniprésidence omnipotente » et de sa kyrielle de conseillers, véritables ministres bis. Faut-il en déduire qu’une situation pareille vous sied et que vous jouissez en fait des ors de la République ?
Je le croyais assez jusqu’à la survenue d’un événement récent. Depuis, j’ai compris que loin d’être indolent, vous effectuez un véritable travail de sape, pis une œuvre magistrale de démolition systématique qui anéantit quarante années d’indépendance nationale (relative) au profit d’une folle intégration dans l’O.T.A.N. américanocentrée, bras armé d’un Occident mondialiste globalitaire.
Vous vous dîtes partisan de la construction européenne alors que vous en êtes l’un de ses fossoyeurs les plus déterminés. L’Europe, sa puissance sous-jacente, ses peuples historiques vous indiffèrent, seule compte pour vous cette entité despotique de dimension planétaire appelée « Occident ».
Qu’est-ce qui m’a dessillé totalement les yeux en ce 6 février 2009 ? Tout simplement votre décision inique et scandaleuse de congédier sur le champ Aymeric Chauprade de son poste de professeur au Collège interarmées de Défense (C.I.D.). Brillant spécialiste de géopolitique, Aymeric Chauprade présente, dans un nouvel ouvrage Chronique du choc des civilisations, des interprétations alternatives à la thèse officielle des attentats du 11 septembre 2001. Exposer ces théories « complotistes » signifie-t-il obligatoirement adhérer à leurs conclusions alors qu’Aymeric Chauprade, en sceptique méthodique, prend garde de ne pas les faire siennes ?
Peu vous chaut l’impartialité de sa démarche puisque, sur l’injonction du journaliste du Point, Jean Guisnel, auteur d’un insidieux article contre lui, vous ordonnez son exclusion immédiate de toutes les enceintes militaires de formation universitaire. Mercredi dernier – 11 février -, l’infâme Canard enchaîné sortait une véritable liste d’épuration en vous enjoignant d’expulser d’autres intervenants rétifs au politiquement correct. Auriez-vous donc peur à ce point (si je puis dire) de certains scribouillards pour que vous soyez si prompt à leur obéir, le petit doigt sur la couture du pantalon ? Faut-il comprendre que Jean Guisnel et autres plumitifs du palmipède décati sont les vrais patrons de l’armée française ?
Avez-vous pris la peine de lire l’ouvrage incriminé ? Votre rapidité de réaction m’incite à répondre négativement. Il importe par conséquent de dénoncer votre « attitude irresponsable, irrespectueuse et indigne », car « nier la réalité est une attitude particulièrement inquiétante pour un ministre et qui n’atteste pas du courage que chacun est en droit d’attendre d’un haut responsable politique ». Qui s’exprime ainsi ? M. Jean-Paul Fournier, sénateur-maire U.M.P. de Nîmes, irrité par la fermeture de la base aéronavale de NÎmes – Garons, cité par Le Figaro (et non Libé, Politis ou Minute) du 9 février 2009. Le sénateur Fournier a très bien cerné votre comportement intolérable et honteux.
Aymeric Chauprade interdit de tout contact avec le corps des officiers d’active, vous agissez sciemment contre l’armée française, contre la France. En le renvoyant, vous risquez même de devenir la risée de l’Hexagone. En effet, le 12 juillet 2001, Aymeric Chauprade publiait dans Le Figaro un remarquable plaidoyer en faveur d’un « bouclier antimissile français ». Et que lit-on dans Le Figaro du 13 février 2009 ? « La France se lance dans la défense antimissile »… Certes, nul n’est prophète en son pays, mais quand même, ne peut-il pas y avoir parfois une exception ?
Votre action injuste me rappelle d’autres précédents quand l’Institution militaire sanctionnait des officiers coupables de penser par eux-mêmes et de contester ainsi le conformisme de leur temps : le général Étienne Copel, le colonel Philippe Pétain, le lieutenant-colonel Émile Mayer, le commandant Charles de Gaulle.
Anticonformiste, Aymeric Chauprade l’est avec talent et intelligence; il s’inscrit dans la suite prestigieuse des Jomini, Castex et Poirier. Voilà pourquoi le réintégrer au C.I.D. serait un geste fort pour l’indispensable réarmement moral d’une armée qui en a grand besoin.
Je doute fort, Monsieur le ministre de la Défense euro-atlantiste, que ma missive vous fera changer d’avis. Qu’importe ! Libre à vous de rester insignifiant et de figurer dans les chroniques comme le Galliffet de la réflexion stratégique.
Recevez, Monsieur le Ministre, mes salutations normandes.
Georges Feltin-Tracol
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, europe, otan, atlantisme, occidentalisme, affaires européennes, politique internationale, géopolitique, politique, géostratégie, défense, polémique, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 septembre 2009
Etre rebelle selon Dominique Venner
Être rebelle selon Dominique Venner

Je me demande surtout comment on pourrait ne pas l’être ! Exister, c’est combattre ce qui me nie. Etre rebelle, ce n’est pas collectionner des livres impies, rêver de complots fantasmagoriques ou de maquis dans les Cévennes. C’est être à soi-même sa propre norme. S’en tenir à soi quoi qu’il en coûte. Veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse. Préferer se mettre tout le monde à dos que se mettre à plat ventre. Pratiquer aussi en corsaire et sans vergogne le droit de prise. Piller dans l’époque tout ce que l’on peut convertir à sa norme, sans s’arrêter sur les apparences. Dans les revers, ne jamais se poser la question de l’inutilité d’un combat perdu.
Dominique Venner
Source : Recounquista [1]
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
URL to article: http://qc.novopress.info/6108/etre-rebelle-selon-dominique-venner/
URLs in this post:
[1] Recounquista: http://recounquista.com/
13:15 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, nouvelle droite, philosophie, rebellion, non conformisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 septembre 2009
Garder les traditions ou vivre selon la Tradition?

Garder les traditions ou vivre selon la Tradition ?
L’un des premiers motifs de l’engagement militant aux Identitaires, c’est le refus volontariste de rester les bras croisés devant la « perte » de nos traditions, échos d’une identité lointaine que l’on souhaite défendre à travers l’entretien de ces rites ancestraux. Mais dans une société comme la nôtre, où les mœurs ont plus évolué en 50 ans qu’en 1 000 ans, « garder les traditions » s’apparente plus à un slogan révélateur du dépit des militants devant les grands bouleversements sociaux et culturels engendrés par le Progrès, qu’à une revendication politique sérieuse. En effet, rien de plus négatif qu’un tel slogan, rien de plus rasoir et de plus démotivant qu’une telle revendication. Le verbe « garder » a un sens précis : il est synonyme de conserver. Tel un pêcheur qui tenterait vainement de garder au bout de sa ligne l’énorme poisson emporté par l’irrésistible courant de la rivière. Je m’explique : on ne s’engage pas en politique, d’autant plus dans la mouvance identitaire, pour « sauver les meubles ». « Garder », « conserver », voire même « défendre » dans une certaine mesure, s’apparente à une posture rétrograde et aigrie, c’est un repli en défense plein d’amertume, un retour en arrière. Or, pour nous autres Identitaires, la politique est une aventure, une quête enthousiaste et une entreprise pleine de joie. Nous partons à l’assaut du pouvoir : nous ne nous agenouillons pas devant lui, implorant par nostalgie un sursis supplémentaire pour une fête ou une célébration laissée à l’abandon. Nous ne voulons pas réinstaurer un passé fantasmé (ce qui est de toute manière impossible) mais plutôt puiser dans le passé les éléments positifs utiles à une renaissance sociale, civilisationnelle et politique.
Nous ne nous engageons pas en politique comme le chauffeur de taxi, selon la caricature populaire, se lance dans une diatribe enflammée contre le fait que « tout fout le camp ». Soyons honnêtes : nous ne pouvons ressusciter ce qui est déjà mort. J’entends par là : nous ne pouvons pas vivre comme nos aïeux vivaient il y a deux siècles. Telles ces reproductions médiévales dans lesquelles de nombreux Français trouvent un certain exutoire, loin de leur malaise existentiel, blasés du métro-boulot-dodo. Cela, c’est le « folklore », c’est-à-dire l’exact contraire de l’identité, de la Tradition. Alors que le folklore consiste à danser la gigue autour du feu, habillés comme nos ancêtres et au son d’instruments disparus, vivre selon son identité, c’est tout simplement maintenir vivace, mais sous d’autres formes que celles aujourd’hui disparues, l’esprit qui animait nos ancêtres du temps où l’on dansait encore la gigue.
La Tradition ne se « garde » pas : elle s’entretient. Car la Tradition est avant tout un état d’esprit célébré sous des formes qui peuvent évoluer : la forme est importante mais le sens de la Tradition, c’est-à-dire sa raison d’être, l’est plus encore.
Or aujourd’hui, la plupart des associations s’étant donné pour objectif de « faire vivre » les traditions se limitent à faire du « folklore ». En effet, celles-ci se contentent d’être un musée itinérant d’une identité morte et enterrée. Car quiconque affirme défendre le « folklore » et le « patrimoine » formule en réalité un cruel aveu d’échec. A l’image de ces villages de Provence, vidés de leurs habitants par l’exode rural, colonisés par le tourisme de masse, résidence secondaire pour Parisiens, Britanniques et Hollandais aisés, où l’expression « enfants du pays » ne recouvre plus aucune réalité. Ces villages sont des territoires mis sous cloche (ou emballés sous vide, au choix), destinés à justifier notre statut de « première destination touristique mondiale ». Il y a des commerçants et des pseudo-artisans qui sont là pour faire rêver les touristes sur de « l’authentique » made in China, mais pas d’habitants, et donc pas de vie de village. Cela, c’est le folklore. Un mur de fumée « à l’ancienne » pour berner les touristes. C’est « sympa », « touchant », « naïf », « pittoresque », mais mort.
Ouvrons une parenthèse. La différence entre le folklore et la Tradition a des conséquences pratiques en termes de positionnement sur l’échiquier politique. Alors que l’homme « de droite » standard va draguer les électeurs à grands renforts d’images d’Epinal sur la « France des terroirs » (en tapotant le cul d’une vache devant les caméras par exemple), le militant identitaire va, lui, identifier les causes de la désertification rurale (la ruralité est le dernier refuge des traditions populaires, d’où l’intérêt de la préserver) et tenter d’y remédier via des mesures sérieuses : relocalisation de l’économie, lutte contre l’urbanisation et la spéculation immobilière, subventionnement de l’agriculture biologique, enseignement de la culture et de la langue régionale dès l’école primaire, etc.
Ainsi, une politique identitaire ne vise pas à manger du saucisson au Salon annuel de l’Agriculture, bref à être le « type sympa », mais à lutter en profondeur contre ce qui tue nos traditions depuis la racine. Refermons la parenthèse.
Les Identitaires ne s’accrochent pas désespérément à ce qui a disparu. Respectueux des rites ancestraux qui régissent une tradition millénaire, nous tenons plus encore à en respecter leur sens profond. Nous n’oublions pas qu’une tradition est la fille de circonstances sociales et culturelles, ou politiques, d’une époque donnée dans un lieu donné.
Par exemple, la bénédiction des calissons à Aix-en-Provence : chaque année, autour du 6 et 7 septembre, une messe est donnée, suivie d’une procession d’associations « folkloriques », en costume d’époque, avant de participer à la distribution populaire de calissons. Cette fête, appelée aussi « renouvellement du vœu Martelly », trouve son origine dans l’épidémie de peste qui toucha la capitale des comtes de Provence au début du 18ème siècle. L’élite politico-administrative et économique de la cité fuya, laissant derrière elle une population affamée. Seuls demeuraient l’évêque et l’assesseur (gouverneur de la ville pour le compte du roi) qui avaient organisé la bénédiction d’un grand nombre de calissons destinés à nourrir partiellement les Aixois. Martelly fait alors le vœu, en mémoire de ce drame, de faire bénir chaque année des calissons pour les distribuer aux Aixois. A l’origine, la « bénédiction des calissons » n’a donc rien de festif : elle répondait à une véritable catastrophe sanitaire et alimentaire, probablement la plus grave qu’ait connue Aix depuis sa fondation par les Romains. Aujourd’hui, combien d’Aixois connaissent le sens social et religieux de cette tradition ? De la même manière, combien d’Aixois savent que la plupart des saintes vierges qui ornent l’angle des immeubles de leur cité ont été installées à la même époque pour permettre à leurs ancêtres de prier pour la fin de l’épidémie et la guérison des blessés, depuis chez eux, afin d’éviter la contamination ? Pour un identitaire, ce qui importe par-dessus tout, ce n’est pas de défiler dans des costumes colorés pour provoquer les crépitements de flash des appareils photos tenus par les hordes de touristes japonais, mais plutôt de continuer à célébrer les valeurs humaines qui inspirent toute tradition.
Quand chaque année, des militants identitaires se retrouvent autour d’un « Noël provençal » (repas traditionnel), peu importe qu’il manque une nappe sur la table (trois selon le rite), que l’omelette aux truffes soit en réalité composée d’une autre spécificité de champignons ou que la traditionnelle morue ait cédé sa place à un poisson meilleur marché : une célébration ancestrale ne doit pas être une lubie de bourgeois aisés mais un moment de convivialité populaire. Si, pour faire perdurer un certain esprit, il est nécessaire (pour des raisons financières souvent), de déroger à quelques points précis de la règle, alors soit, il en sera ainsi, l’essentiel est de respecter l’âme d’une fête : pas de reproduire bêtement les gestes de nos aïeux par obsession mimétique. Pour nous, l’identité, ce « n’est pas ce qui ne change jamais, mais ce qui nous permet de rester nous-mêmes en changeant tout le temps » (Alain de Benoist).
Nous ne « gardons » pas les traditions, nous vivons selon la Tradition, tous les jours et en tout lieu : c’est-à-dire selon notre identité trente fois millénaire, malgré les évolutions et les révolutions. Fidèles au sens initial des traditions et à l’état d’esprit qui a présidé à leur naissance, soucieux de l’intégrité des rites qui servent de médium entre l’esprit d’antan et le peuple d’aujourd’hui, nous veillons toutefois à ne pas laisser la lettre primer sur l’esprit (selon la leçon des évangiles à propos des Pharisiens). La Tradition, c’est l’identité : passée, présente et future.
Julien LANGELLA
Article printed from :: Novopress.info France: http://fr.novopress.info
URL to article: http://fr.novopress.info/30642/garder-les-traditions-ou-vivre-selon-la-tradition/
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, réflexions personnelles, philosophie, identité, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 septembre 2009
Variations autour du thème "Russie"

Robert STEUCKERS:
Variations autour du thème “Russie”
Discours de Robert Steuckers lors du colloque de la “nouvelle alternative solidariste” à Ruddervoorde/Bruges, 11 octobre 2008
La Russie –vous l’entendez et le lisez chaque jour dans les médias du système— est l’objet d’une inlassable propagande, toujours dénigrante et négative, d’un harcèlement permanent des esprits, qui la campent comme un immense foyer où se succèdent sans discontinuité horreurs et entorses à la “bonne gouvernance”; cette propagande a été bien réactivée depuis la “Guerre d’août” dans le Caucase, il y a deux mois. Cette propagande négative, cette “Greuelpropaganda” (“gruwelpropaganda”), n’est pas nouvelle, car, les historiens le savent, elle s’est déjà déployée dans l’histoire des deux derniers siècles, essentiellement pour deux faisceaux de motifs:
Premier faisceau de motifs:
D’abord à cause de l’autocratisme de certains tsars: Paul I, qui voulait marcher avec Napoléon contre l’Inde britannique et démontrait, par cette volonté, que la maîtrise de la Mer Noire et de la Caspienne permettait à terme de déboucher en Inde, arsenal civil et source de profit pour la puissance dominante anglaise; et Nicolas I, qui a entamé la marche des armées russes en direction du Caucase et de l’Asie centrale; ce tsar voulait régler la question d’Orient en liquidant l’Empire ottoman, ce qui a déclenché la Guerre de Crimée. Ce reproche d’autoritarisme fait partie d’un arsenal propagandiste récurrent car il s’adresse également à des tsars d’ouverture tels Alexandre II, qui lance un programme d’industrialisation, de modernisation et de libération des serfs, ou Nicolas II, qui sera tantôt ange tantôt démon, selon les fluctuations de la géopolitique anglaise, qui entendait d’abord ébranler la Russie pour s’emparer des pétroles du Caucase puis s’allier à elle dans le cadre de l’Entente pour faire pièce à une Allemagne devenue ennemie principale, prenant ainsi, au titre de cible première des propagandes dénigrantes, le relais de l’Empire des Tsars comme le démontre d’excellente manière le géopolitologue suédois William Engdahl dans son ouvrage sur la guerre du pétrole (1). Nicolas II partage avec les Mexicains Zapata et Pancho Villa le triste honneur d’avoir été tout à la fois, en l’espace de quelques années seulement, tyran sanguinaire et brave allié. Les deux Mexicains, rappellons-le, voulaient nationaliser les pétroles de leur pays, les arracher aux tutelles britannique et yankee... L’an passé, nous avons eu à déplorer la disparition de Henri Troyat, de l’Académie Française, écrivain de souche russe et arménienne, qui nous a laissé des biographies de tous les tsars: elles nous expliquent en long et en large les grands axes de leur politique, dans un langage clair et limpide, accessible à tous, sans jargon. Je conseille à chacun de vous de s’y référer.
Deuxième faisceau de motifs:
Ensuite à cause du bolchevisme et de la bolchevisation de la Russie, après 1917, la démonisation propagandiste se focalise sur l’idéologie et la pratique du communisme. Elle a la tâche bien plus facile car le tsarisme était moins démonisable que le soviétisme. Le monde catholique belge et flamand, notamment, dépeint la Russie soviétisée comme le foyer du mal absolu, surtout pour empêcher tout envol du communisme en Belgique même; la publication de l’album d’Hergé, “Tintin au pays des Soviets” relève, pour ne donner qu’un seul exemple, de cet anti-communisme catholique et militant des années 20 et 30. Cette propagande anti-soviétique a laissé des traces: en dépit de l’effondrement définitif de l’Union Soviétique et de la débolchevisation de la Russie, les réflexes anti-russes mobilisés pour combattre le soviétisme, notamment la propagande en faveur de l’OTAN, restent ancrés dans les mentalités, incapables d’intégrer les nouvelles donnes géopolitiques d’après 1989. A cet anti-communisme, mis en sourdine à partir de 1941 pour raisons d’union sacrée contre le nazisme et pour couvrir les agissements de la résistance communiste (en tant qu’instrument de la “guerilla warfare”), succède un anti-stalinisme, partagée par certains communistes ailleurs dans le monde; cet anti-stalinisme prête tous les travers du communisme à la seule gestion stalinienne de l’Union Soviétique. Comme Nicolas II, tyran sanguinaire puis “bon père des peuples de toutes les Russies” selon la propagande londonienne, Staline sera un monstre, puis le brave “Uncle Joe”, puis le “petit père des peuples” puis à nouveau un dictateur infréquentable.
Dans mon article, intitulé “La diplomatie de Staline” (cf. http://euro-synergies.hautetfort.com), et dont la teneur m’a été souvent reprochée (2), j’ai souligné l’originalité, après 1945, de la diplomatie soviétique, qui pariait sur des rapports bilatéraux entre puissances et non sur une logique des blocs, du moins au départ. De fait, le pacte de Varsovie nait en 1955 seulement, après la mort du leader géorgien. Ce Pacte a bétonné la logique des blocs et est l’oeuvre du post-stalinisme que Douguine dénonce, aujourd’hui à Moscou, comme une émanation d’un certain “atlanto-trotskisme”. En dépit d’atrocités comme l’élimination des koulaks dans les terres noires et si fertiles d’Ukraine, qui a privé l’Union Soviétique d’une paysannerie capable de lui assurer une totale autonomie alimentaire, et comme les épurations du parti et de l’armée lors des grandes purges de 1937, il faut objectivement mettre à l’acquis de la période stalinienne tardive les notes de 1952, proposant la neutralisation de l’Allemagne sur le modèle prévu pour l’Autriche, en accord avec le filon “austro-marxiste” de la social-démocratie autrichienne.
Déstalinisation et logique des blocs
La volonté de réhabiliter les rapports bilatéraux entre puissances, selon les vieux critères avérés de la diplomatie classique, et le projet de neutralisation d’une large portion du centre de l’Europe entre l’Atlantique et la frontière soviétique, dont l’arsenal industriel allemand appelé à renaître de ses cendres (“les Hitlers vont et viennent, l’Allemagne demeure”), sont deux positions qui ont l’une et l’autre déplu profondément à Washington et entraîné ipso facto une propagande anti-stalinienne puis, dans la foulée, la déstalinisation, au profit d’une logique des blocs parfaitement schématique, qui condamnait l’Europe à la division et la stagnation, au blocage géopolitique permanent. La déstalinisation, en dépit de la “bonne figure” qu’elle se donnait, interdisait de revenir au message de la fin de l’ère stalinienne: diplomatie classique et neutralisation de l’Allemagne.
La Chine actuelle, partiellement héritière de ce communisme de la fin des années 40 et du début des années 50, préconise des relations internationales basées sur des rapports bilatéraux, dans le respect des identités politiques des acteurs de la scène internationale, en dehors de toute formation de blocs et de toute idéologie “immixtionniste” (wilsonisme, stratégie cartérienne et reaganienne des “droits-de-l’homme”, etc.) (cf. nos articles sur la question: Robert Steuckers, “Les amendements chinois au ‘nouvel ordre mondial’” & “Modernité extrême-orientale et modèle juridique ‘confucéen’”; ces deux articles sont repris dans: Robert Steuckers, “Le défi asiatique et ‘confucéen’ au ‘nouvel ordre mondial’”, Synergies Européennes, Forest, 1998; les deux textes figurent dorénavant sur: http://euro-synergies.hautetfort.com).
Le retour des thématiques anti-autocratiques
Avec Poutine et Medvedev, la propagande habituelle recompose les thématiques de l’anti-autocratisme, de l’hostilité à tout pouvoir non seulement fort mais simplement solide, à celle des résidus de communisme, dans le sens où toute réorganisation des anciennes terres de l’Empire russe et toute velléité de contrôler l’économie et le marché des matières premières s’assimilent à un retour au communisme. Ce sont des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, en tenant compte des arguments suivants:
- la Russie a besoin d’un pouvoir plus contrôlant que les terres situées à l’Ouest du sous-contient européen, la coordination des ressources de son immense territoire exigeant davantage de directivité;
- dans une perspective européenne et russe, le contrôle pacifique de l’Asie centrale, du Caucase, de la Caspienne et de la Mer Noire est un atout géopolitique et géostratégique important, dont il ne faut pas se défaire avec légèreté, sous peine de voir triompher le voeu le plus cher de la géopolitique anglo-saxonne, dont les fondements ont été théorisés par Halford John Mackinder et Homer Lea dans la première décennie du 20ème siècle;
- la démonisation de la Russie a une forte odeur d’hydrocarbure; chaque étape historique de cette démonisation est marquée par l’un ou l’autre enjeu pétrolier; hier comme aujourd’hui, dans le Caucase;
- le communisme, en tant que messianisme qui s’exporte et ébranle les équilibres politiques des nations voisines, a cessé d’exister et les réflexes défensifs que son existence dictait n’ont plus lieu d’être et vicient, s’ils jouent encore, la perception de la réalité actuelle;
- la propagande anti-russe d’hier et d’aujourd’hui participe de la stratégie immixtionniste et internationaliste mise en oeuvre à Londres hier, à Washington depuis la présidence de Teddy Roosevelt et du système wilsonien; elle a eu pour résultat de torpiller toutes les oeuvres d’unification continentale et de faire, à terme, de l’Europe un nain politique, en dépit de son gigantisme économique.
L’historiographie dominante fait donc de la Russie un croquemitaine et cette historiographie est dictée aux agences médiatiques, à la presse internationale, par des officines basées à Londres ou à Washington. Il s’agit désormais, dans les espaces de liberté comme le nôtre, de contrer les poncifs toujours récurrents de cette propagande et de se référer à une autre interprétation de l’histoire, à une historiographie alternative, différente aussi de l’historiographie soviétique/communiste (liée à l’historiographie anglo-saxonne pour les événements de la seconde guerre mondiale).
Le souvenir de “Pietje Kozak”
Dans le cadre restreint du mouvement flamand, il faut se rappeler que sans les cosaques d’Alexandre I, les provinces sud-néerlandaises n’auraient jamais été libérées du joug napoléonien et que leur identité culturelle et linguistique aurait disparu à tout jamais si elles étaient demeurées des départements français. Si un quartier s’appelle “Moscou” à Gand, c’est en souvenir des libérateurs cosaques, conduits par “Pietje Kozak”, dont les chevaux avaient galopé d’Aix-la-Chapelle aux rives de l’Escaut, en passant par Bruxelles, où ils avaient campé à la Porte de Louvain, l’actuelle Place Madou. Les cosaques n’ont pas laissé de mauvais souvenirs. Ils ne sont pas restés longtemps: ils ont foncé vers Paris, tandis que les Gantois volontaires étaient incorporés dans l’armée prussienne, armée pauvre, levée en masse, selon les consignes de Clausewitz, qui voulait faire pièce à la conscription républicaine puis napoléonienne. Cette armée devait vivre sur la population, notamment sur la rive orientale de la Meuse que la Prusse convoitait, en inquiétant les Anglais, qui voyaient une grande puissance s’approcher d’Anvers et occuper une vallée mosane menant directement au Delta et au Hoek van Holland, à une nuit de navire à voile de Londres, comme au temps de l’Amiral De Ruyter. Les réquisitions prussiennes ont laissé de mauvais souvenirs, surtout en pays de Liège, dans les Ardennes et le Condroz. Les Anglais, eux, payaient tout ce qu’ils prenaient et se taillaient bonne réputation: c’est là qu’il faut voir l’origine de l’anglophilie belge.
Après l’effondrement du système napoléonien qui avait l’avantage peut-être d’unir l’Europe mais le désavantage de le faire au nom des philosophades modernistes de la révolution française, l’Europe acquiert, à Vienne en 1814-15, une sorte d’unité restauratrice. Ce sera la Pentarchie, le concert des cinq puissances (Prusse, Russie, Angleterre, Autriche, France) dont le territoire s’étend de l’Atlantique au Pacifique. Nous avons donc pour la première fois dans l’histoire un espace européen et eurasien entre les deux plus grands océans du globe. La cohérence de cet espace demeure un idéal et une nostalgie, en dépit des faiblesses de cette Pentarchie, sur lesquelles nous reviendrons. Rappellons qu’elle subsistera à peu près intacte jusqu’en 1830 et que les premières lézardes de son édifice datent justement de cette année fatidique de 1830, de la révolte belge de Bruxelles, où Français et Britanniques acceptent les exigences des insurgés, les uns dans l’espoir d’absorber petit à petit le pays; les autres pour briser l’unité des Pays-Bas, qui alliaient de considérables atouts à l’aube de la révolution industrielle: une industrie métallurgique liégeoise, des mines de charbons de Mons à Maastricht, une bonne industrie textile en Flandre et dans la Vallée de la Vesdre, une flotte hollandaise impressionnante et des colonies en voie de développement en Insulinde (Indonésie), un pôle germanique continental et littoral aussi attrayant, sinon plus attrayant, pour les populations d’Allemagne du Nord que la Prusse et le Brandebourg (3). Tandis que Français et Britanniques favorisaient la sécession belge, les autres puissances européennes y voyaient une première entorse à la cohésion “pentarchique” et le triomphe d’un particularisme stérile.
La Doctrine de Monroe contre la Pentarchie
Preuve des potentialités immenses de la “Pentarchie”: c’est à l’époque de sa plus forte cohésion que les puritains d’Amérique du Nord s’en inquiètent, tout en devinant les potentialités de leur propre vocation continentale et bi-océanique dans le Nouveau Monde. La proclamation de la Doctrine de Monroe en 1823 constitue un défi américain à cette formidable cohésion européenne qui s’impose sur la masse continentale eurasiatique (4). Il fallait de l’audace pour oser ainsi défier les cinq puissances de la Pentarchie. Avec un culot inouï, sans avoir à l’époque les moyens de défendre sa politique sur le terrain, James Monroe a osé prononcer ce programme d’exclusion des puissances européennes, à commencer par l’Espagne affaiblie, car si la Pentarchie l’avait voulu, elle se serait partagé le Nouveau Monde en zones d’influence et les treize colonies rebelles n’auraient pas pu dépasser les Appalaches ni atteindre le bassin du Mississippi si Bonaparte n’avait pas eu la funeste idée de leur vendre la Louisiane en 1803.
La Guerre de Crimée (5) va définitivement rompre la cohésion de la Pentarchie et inaugurer l’ère des compositions et recompositions d’alliances qui conduiront à l’explosion de 1914, à la première guerre mondiale et à l’implosion de la culture européenne. Le Tsar Nicolas I entendait parachever le travail de liquidation de l’Empire ottoman, commencé en 1828, où les flottes anglaise, française et russe, de concert, avaient forcé le Sultan à concéder l’indépendance à la Grèce, qui aura un roi bavarois. L’objectif du Tsar était de liquider progressivement l’Empire ottoman, corps étranger à la Pentarchie sur le sous-continent européen, en protégeant puis en accordant l’indépendance aux sujets chrétiens (orthodoxes) de la Sublime Porte. La logique du Tsar est continentaliste: il veut un élargissement de “l’ager pentarchicus” et la ré-occupation de positions statégiques-clefs que les impérialités européennes, romaines et byzantines, avaient tenues avant les raz-de-marée arabe et ottoman. L’élargissement de “l’ager pentarchicus” impliquait, après la parenthèse de l’indépendance grecque soutenue par tous, d’englober tout le territoire maritime pontique et de débouler, partiellement ou par nouvelles petites puissances orthodoxes interposées, dans le bassin oriental de la Méditerranée, avec la Crète et Chypre, à proximité de l’Egypte. La logique de l’Angleterre est, elle, maritime, thalassocratique. Pour le raisonnement impérial anglais, l’Empire des Tsars, avec ses immenses profondeurs territoriales et ses énormes ressources, ne peut pas s’avancer aussi loin vers le Sud, peser de tout son poids sur la ligne maritime Malte-Egypte, au risque de couper la voie vers les Indes, car on compte déjà à Londres percer bientôt l’isthme de Suez.
Le centre névralgique de l’Empire britannique n’est plus en Europe
Les préoccupations anglaises du temps de la Guerre de Crimée (1853-1856) demeurent actuelles, à la différence près que ce sont désormais les Américains qui les font valoir. Pour Londres hier et pour Washington aujourd’hui, la Russie, ni aucune autre puissance européenne d’ailleurs, ne peut avoir la pleine maîtrise de la Mer Noire ni disposer d’une bonne fenêtre sur la Méditerranée orientale. En 1853, Londres prendra fait et cause pour la Turquie, entraînant la France dans son sillage, et les deux puissances occidentales ruinèrent ainsi définitivement la notion féconde et apaisante de Pentarchie: elles sont responsables devant l’histoire de toutes les catastrophes qui ont saigné l’Europe à blanc depuis la Guerre de Crimée. L’unité et la cohésion de l’Europe ne comptent pas pour Londres et Paris, puissances excentrées par rapport au coeur du sous-continent. L’Occident s’alliera avec n’importe quelle puissance ou n’importe quelle peuplade extérieure à l’Europe pour détruire toute force de cohésion émanant du centre rhénan, danubien ou alpin de notre sous-continent. Cette stratégie de trahison et d’anti-européisme avait commencé avec François I, le Sultan et Barberousse au 16ème siècle (6); l’Angleterre vole, elle, au secours de l’Empire ottoman moribond, prolonge la servitude des peuples balkaniques en ne montrant aucune solidarité avec des Européens croupissant sous un joug musulman, parce que le centre névralgique de la puissance britannique ne se situe plus en Europe, ni même dans la métropole anglaise, mais en Inde. L’Angleterre possède donc un empire dont le centre, sur le globe, est le sous-continent indien; bien qu’hegemon, elle se situe en périphérie de l’espace-tremplin initial, du coeur même de son propre empire et combat tout ce qui, autour de l’Inde, pourrait, à moyen ou long terme, en réalité ou en imagination, en menacer l’intégrité territoriale. Les logiques française et anglaise de la seconde moitié du 19ème siècle ne sont donc plus euro-centrées mais exotiques. Ce glissement scelle la fin de la cohésion pentarchique.
C’est à la suite de la Guerre de Crimée que le terme “Occident” devient péjoratif en Russie. Nul autre que Dostoïevski ne l’a expliqué aussi clairement que dans son “Journal d’un écrivain”. En 1856, quand la Russie doit accepter les clauses humiliantes de la paix, une première césure traverse l’Europe pentarchique, une césure qui constitue une première étape vers l’épouvantable cataclysme d’août 1914. En effet, la césure sépare désormais une Europe occidentale (France et Angleterre), d’une Europe centrale et orientale (Prusse, Russie, Autriche-Hongrie). En dépit de la méfiance autrichienne avant et pendant la Guerre de Crimée, qui voyait d’un mauvais oeil la Russie qui tentait de s’installer dans le delta du Danube en prenant sous sa protection les principautés roumaines (Valachie et Moldavie), de confession orthodoxe. Sous l’impulsion de Bismarck, les trois puissances impériales chercheront à reproduire, à elles seules, la cohésion de la Sainte-Alliance. Après l’unification allemande de 1871, on parlera de “l’alliance des trois empereurs” (“Drei-Kaiserbund”). Bismarck exhortera les Autrichiens à ne pas succomber aux tentations occidentales, ce qui sera d’autant plus aisé que l’Autriche n’a jamais eu de colonies extra-européennes.
La crainte de voir renaître un Empire russo-byzantin sur le Bosphore
Le théoricien le plus pertinent de la “Pentarchie” fut incontestablement Constantin Frantz (7): c’est lui qui a démontré que “l’excentrage” exotique de l’Angleterre en direction des Indes principalement et de la France en direction de l’Afrique (Algérie, Saint-Louis/Dakar, Côte d’Ivoire, Gabon, avant 1860) brisait la cohésion de l’Europe et pouvait induire sur son territoire des conflictualités générées ailleurs. La Guerre de Crimée est la première conflagration inter-européenne après 1815, dont les motivations dérivent de préoccupations extra-européennes: l’Angleterre ne veut pas d’une flotte russe en Méditerranée orientale parce que cela menace l’Egypte et comporte le risque de voir s’installer des postes et bases russes en Mer Rouge, avec accès à l’Océan Indien; la France n’en veut pas davantage car une flotte russe dans les bases auparavant ottomanes risque de menacer l’Algérie fraîchement conquise, qui, rappelons-le, était tout de même la base la plus avancée des Ottomans en Méditerranée occidentale au 16ème siècle. La crainte partagée par Paris et Londres en 1853 était de voir se reconstituer, sur les débris de l’Empire ottoman, un empire russo-byzantin rechristianisé capable, avec les réserves russes, de contrôler les principaux points stratégiques à la charnière des masses continentales asiatiques et africaines, et de remplacer ainsi l’Empire ottoman. Cette crainte n’existait pas encore vingt-cinq ans auparavant, au moment de l’accession de la Grèce à l’indépendance: la France n’avait pas encore débarqué ses troupes en Algérie et l’Angleterre escomptait simplement faire de la Grèce un satellite plus solide que le seul petit cordon d’îles ioniennes, dont elle avait fait, en 1815, une république sous protectorat anglais.
Revenons à la propagande anti-russe actuelle: elle remonte à l’époque de la Guerre de Crimée. Aujourd’hui encore, les linéaments de cette propagande et les motifs géopolitiques qu’elle dissimule ou travestit demeurent et s’utilisent toujours. Et montrent plus de virulence dans la sphère anglo-saxonne et en France qu’ailleurs en Europe, mis à part les pays de l’est fraîchement libéré du communisme. Les cénacles, journaux, publications des milieux dits “nationalistes” ou “nationaux-conservateurs” de l’Occident français et anglais évoquent bien moins souvent une alliance euro-russe que leurs pendants d’Europe centrale germanique (Allemagne, Autriche). En Flandre, nous assistons à une contagion anglaise, à une véritable “anglo-saxonnite aigüe”, totalement contraire aux intérêts européens de cette région liée à la Rhénanie-Westphalie, et improductive pour tout combat métapolitique face au danger français, à l’heure où la conquête n’est plus militaire ou culturelle mais économique.
Les “nouveaux philosophes”, instruments de la russophobie
La propagande anti-russe, et aujourd’hui hostile à Poutine, fonctionne à merveille dans la sphère linguistique anglo-saxonne. C’est au départ d’officines de moins en moins britanniques et de plus en plus américaines qu’elle se déploie sur la planète entière. En France, cette propagande se distille, sous un déguisement différent, au départ, non pas de cercles conservateurs ou nationaux-conservateurs, mais de réseaux trotskistes, d’obédience affichée ou infiltrés dans les cénacles syndicaux ou socialistes et surtout au départ des niches médiatiques et journalistiques où s’est incrustée la secte des “nouveaux philosophes”, à cheval entre une gauche nouvelle (les fameuses deuxième et troisième gauches) et une droite atlantiste, molle, libérale et “orléaniste” qui cherche à tourner le dos au gaullisme. Ce bastion, bien positionnée sur le carrefour entre droite centriste et gauche centriste, permet à cette propagande de s’insinuer partout et d’empêcher l’éclosion d’une pensée géopolitique alternative, non atlantiste, qui pourrait émerger dans plusieurs franges politiques potentielles, aujourd’hui houspillées dans les marges de la politique dominante et souvent décriées comme “extrémistes”: communiste, gaulliste (dans le sens de Couve de Meurville), nationaliste, souverainiste ou néo-maurrassienne.
La Guerre de Crimée a donc fracassé définitivement la Pentarchie, la seule cohésion européenne de l’ère moderne et contemporaine. Néanmoins, le conflit dominant, celui dont les enjeux géopolitiques avaient le plus d’envergure territoriale car ils concernaient et la Terre du Milieu (sibérienne et centre-asiatique) et l’Océan du Milieu (l’Océan Indien avec le sous-continent indien), demeurait le conflit russo-britannique. Le conflit franco-prussien de 1870-71, perçu comme essentiel en France ou en Allemagne car il était local, reste marginal, malgré tout, malgré son importance, malgré qu’il est l’une des sources majeures des deux conflits mondiaux du 20ème siècle.
Versailles ou le retour de la politique de Richelieu
Cependant, la permanence du conflit anglo-russe aux confins de l’Hindou Kouch, la rivalité entre Londres et Saint-Pétersbourg en Asie centrale et la volonté française de revanche et de reconquête de l’Alsace et de la Lorraine thioise vont peser d’un poids suffisant pour modifier la donne entre 1871 et 1914. La France va investir en Russie, afin d’avoir un “allié de revers”, comme François I s’était allié au Sultan et aux pirates barbaresques pour prendre le Saint-Empire et l’Espagne en tenaille et faire échouer l’offensive espagnole et vénitienne en Afrique du Nord et en direction de la Méditerranée orientale. On ne mesure pas encore complètement l’impact désastreux de cette politique. La politique française des investissements en Russie, mieux connue sous l’appelation des “emprunts russes” va contribuer à la dislocation progressive de l’alliance des “Trois Empereurs”, ultime résidu de l’esprit de la Pentarchie de 1814. A ce projet de s’adjoindre le “rouleau compresseur russe”, s’ajoutera une volonté maçonnique d’émietter l’espace de la “monarchie danubienne” austro-hongroise, de fractionner l’Europe centrale et orientale en autant de petits Etats que possible, tous condamnés à la dépendance ou à l’inviabilité économique: ce sera une réactualisation de la politique de Richelieu, visant la “Kleinstaaterei” dans les Allemagnes (pluriel!), qui trouvera un nouvel aboutissement dans le Traité de Versailles.
Bismarck serait indubitablement parvenu à maintenir la cohésion de l’alliance des Trois Empereurs. Ses successeurs n’auront pas cette intelligence politique et ce “feeling” géopolitique. Ils laisseront libre cours, sans réagir de manière opportune, à cette politique française de satellisation de la Russie. Quand celle-ci bascule définitivement dans le camp français, la politique alternative de l’Allemagne sera d’aller chercher dans l’Empire ottoman moribond un espace pour écouler les biens d’exportation de sa nouvelle industrie et y puiser des matières premières. Cette politique heurtera la volonté russe de trouver un débouché au-delà des Dardanelles, en direction de la Méditerranée orientale, de Suez et de l’Egypte et la volonté britannique de maintenir ou de créer un verrou partant du Caire pour aboutir à Calcutta au Bengale, afin de parachever, avec les possessions anglaises d’Afrique et d’Australie, une domination absolue sur l’ensemble des rivages de l’Océan Indien.
Une vingtaine d’années pour parfaire l’Entente
Il faudra cependant une vingtaine d’années pour consolider l’alliance que sera l’Entente entre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. Les sources de conflits potentiels demeurent latentes entre l’Angleterre et la France, en Indochine où l’Angleterre accepte, bon gré mal gré, que les Français contrôlent la façade pacifique de cette Indochine mais n’acceptent aucune extension de ce contrôle en direction du Siam et du Golfe du Bengale. De même, l’Angleterre voit d’un mauvais oeil la conquête violente puis la pacification de Madagascar par le Général Gallieni (qu’ils détesteront même au plus fort de la bataille de la Marne en 1914, alors que cette bataille a décidé du sort de la guerre en faveur des alliés). Ensuite, l’affaire de la prise de contrôle par les Britanniques du Canal de Suez ne s’est pas apaisée rapidement, a connu des rebondissements, surtout, notamment, quand l’expédition du Capitaine Marchand en direction de Fachoda au Soudan laissait présager une installation française sur les rives du Nil, axe liant l’Egypte à l’Afrique du Sud.
Une présence française sur le Nil aurait pu briser la cohésion territoriale de l’Empire britannique en Afrique en s’alliant soit à la Somalie sous domination italienne soit à l’Abyssinie chrétienne soit au Congo belge. Il y aurait eu une présence européenne continentale sur une portion importante du littoral africain de l’Océan Indien, avec, d’une part, une grande profondeur territoriale, reliant l’Atlantique à l’Océan du Milieu, et d’autre part, une base navale (et, plus tard, un porte-avion) malgache en face du Mozambique portugais, du Tanganyka alors allemand et surtout des mines d’Afrique du Sud, où demeurait une population boer rebelle, partiellement d’ascendance française. Imagine-t-on aujourd’hui quelle puissance aurait pu avoir un bloc colonial européen, regroupant les colonies françaises, belges, allemandes et portugaises et les Etats indépendants boers? La Mer Rouge aurait été contrôlée à hauteur d’Aden et de Djibouti par une constellation européenne germano-turque, italienne et française. Pour Londres, l’un des résultats les plus intéressants de la première guerre mondiale a été de contrôler la Mer Rouge de Suez à Aden, d’y éliminer toute présence germano-turque et, indirectement, française, la France sortant exsangue de la Grande Guerre.
Ratzel, Tirpitz et le réveil de l’Allemagne
Dans les années 90 du 19ème siècle, les Russes se rendent encore maîtres de l’actuel Tadjikistan et exercent une influence prépondérante sur le “Turkestan chinois” au nord du Tibet. Tandis que pour contrer ce gain de puissance, les Anglais annexent à l’Empire des Indes les régions afghanes aujourd’hui pakistanaises et que l’on appelle la “zone ethnique” pachtoune, actuellement en pleine rébellion et sanctuaire des rebelles talibans en lutte contre l’occupation de l’Afghanistan. Entre 1890 et 1900, rien ne laissait augurer une alliance anglo-russe, tant les conflits potentiels s’accumulaient encore le long des frontières afghanes. Le très beau film “Kim”, d’après une nouvelle de Rudyard Kipling, met en scène un Indien musulman local, fidèle à la Couronne britannique, et des explorateurs russes, soupçonnés d’espionnage et de venir soulever les tribus hostiles à la présence anglaise. Le scénario du film se déroule précisément dans les années 90 du 19ème siècle.
Après la guerre des Boers et l’élimination impitoyable de leurs deux républiques libres d’Afrique australe, période où l’Angleterre victorienne avait été honnie dans toute l’Europe, l’Allemagne devient l’ennemi numéro un, parce qu’elle développe des stratégies commerciales efficaces, concurrence les produits industiels britanniques partout dans le monde, se met à construire une flotte sous l’impulsion du géopolitologue Friedrich Ratzel et de l’Amiral von Tirpitz, exerce une influence prépondérante dans les “Low Countries”, propose une “Union de la Mittelafrika” à la Belgique et au Portugal susceptible de ruiner les projets de Cecil Rhodes et surtout réorganise l’Empire Ottoman pour un faire un espace complémentaire de son industrie (un “Ergänzungsraum”), coupant la route des Russes vers Constantinople et occupant des positions stratégiques en Méditerranée orientale, en prenant, avec l’Autrriche-Hongrie et ses marins dalmates, le relais de Venise la “Sérénissime” dans cet espace maritime, en face de Suez et sur un segment important de la route maritime vers l’Inde.
Mackinder et le “Terre du Milieu”
Malgré l’émergence, pour Londres, d’un “danger allemand”, la Russie demeure implicitement l’ennemi principal dans le dicours que tient Halford John Mackinder en 1904, pour expliquer, par la géographie, la dynamique Terre/Mer de l’histoire, où l’Angleterre tient la Mer et les Indes et la Russie, la Terre et l’Asie centrale, rebaptisée “Terre du Milieu” et posée comme inaccessible à l’instrument naval de la puissance anglaise. Mackinder tire en quelque sorte le signal d’alarme en cette année 1904, parce que, contrairement à l’époque de la Guerre de Crimée, la Russie commence, sous l’impulsion de Sergueï Witte, à se doter d’un réseau de chemins de fer et d’une ligne ferroviaire transsibérienne qui lui procurent désormais la capacité militaire de transporter rapidement des troupes vers la Mer Noire, le Caucase, l’Asie centrale et l’Extrême-Orient. Sur le plan technologique, la donne a donc changé. La Russie, handicapée par l’immensité de ses territoires et les problèmes logistiques qu’ils suscitent, venait d’acquérir un supplément non négligeable de mobilité terrestre. Elle pèse d’un poids plus considérable sur les “rimlands”, dont la Perse et l’Inde, qui donnent accès à l’Océan Indien, “Océan du Milieu”.
De facto, la Russie devient la protectrice de la Chine, après la guerre sino-japonaise de 1895, ce qui lui permet de faire passer le Transsibérien à travers la riche province chinoise de Mandchourie. Cette Russie plus mobile, grâce au chemin de fer, et donc plus “dangereuse”, inquiète l’Angleterre: elle doit dès lors être tenue en échec par une politique d’endiguement et par la constitution d’un “cordon sanitaire” de petites puissances dépendantes de la principale thalassocratie de la planète. Mieux: la politique extrême-orientale de la Russie, face aux anciennes et nouvelles puissances asiatiques de la région, reçoit le plein aval de Guillaume II d’Allemagne, qui détourne ainsi la Russie du Danube et désamorce les conflits potentiels avec l’Autriche-Hongrie; face à ces encouragements allemands, l’Angleterre, qui voit en eux un danger de plus pour ses intérêts, entend ramener, à terme, la Russie en Europe, pour qu’elle agisse contre l’Autriche, principal allié de l’Allemagne montante.
La Russie avance ses pions vers le Pacifique
L’Entente se dessine: la France finance la Russie, mais la lie ainsi à elle, et l’Angleterre dispose de deux “spadassins continentaux” pour abattre la puissance qu’elle juge la plus dangereuse pour elle, avec le sang de leurs millions de conscrits. Sergueï Witte préconisait une politique de petits pas en Extrême-Orient: l’acquisition par l’Allemagne de la base chinoise de Tsingtao précipite les choses, oblige les Russes à abandonner leur modération initiale et à revendiquer et occuper Port Arthur; du coup, les Anglais s’emparent de Weihaiwei. Les puissances s’abattent sur la Chine, grignotent sa souveraineté pluriséculaire, déclenchant une révolte xénophobe, celles des Boxers, soutenue in petto par l’Impératrice douairière. Pour mater cette révolte, les puissances organisent une expédition punitive, au cours de laquelle les Russes prennent l’ensemble de la Mandchourie. Via Kharbin et Moukden, le Transsibérien est prolongé jusqu’à Port Arthur: du coup, la Russie est présente dans les eaux chaudes du Pacifique (8). L’Amiral Alexeïev, gouverneur de la région, entreprend l’exploitation du port et de la nouvelle base navale puis lorgne directement vers la péninsule coréenne, susceptible de fournir un pont territorial entre Vladivostok et Port Arthur. Sur le cours du fleuve Yalou, les Russes découvrent de l’or. La politique d’Alexeïev heurte le Japon qui convoite la Corée. Le scénario est en place pour une nouvelle guerre. Cette fois contre le Japon, avec le désavantage que cette guerre est très impopulaire, ne correspond pas aux mythes politiques habituels du peuple russe, qui veut toujours un élan vers Constantinople, les Balkans et l’Egée.
En 1905, lors de la guerre russo-japonaise, l’Angleterre et déjà les Etats-Unis, soutiennent le Japon, archipel en lisière du “rimland” sino-coréen. Le Japon devient ainsi le petit soldat asiatique de la première politique d’endiguement, immédiatement après le discours de Mackinder. La propagande contre Nicolas II, posé comme “bourreau” de son peuple, bat son plein. Quelques cercles révolutionnaires perçoivent de mystérieux financements. La flotte russe de la Baltique, qui part du Golfe de Finlande pour porter secours à celle du Pacifique, ne peut s’approvisionner en charbon le long de son itinéraire, dans les bases britanniques, les plus nombreuses. Résultat: le désastre de Tchouchima.
Notons, dans ce contexte, l’ignoble hypocrisie de la France, qui avait promis monts et merveilles à son “allié” russe, mais l’a froidement laissé tomber face au Japon, pour ne pas désobliger l’Angleterre. Jeu dangereux car, un moment, cette trahison a failli ramener la Russie dans un système d’alliance comprenant l’Allemagne sans exclure la France. L’Axe Paris-Berlin-Saint-Pétersbourg a failli voir le jour en octobre 1904. La France a refusé et le Tsar, dépendant des fonds français, n’a pas signé. En juillet 1905, deuxième tentative de rétablir une unité européenne avec l’Allemagne, la France et la Russie, lors de l’entrevue entre Guillaume II et Nicolas II dans l’île suédoise de Björkö. Ces entretiens ne relèvent que de la bonne volonté des deux monarques qui ne bénéficiaient d’aucun contre-seing ministériel. Une fois de plus, la France refuse, tablant sur son alliance anglaise et sur les avantages immédiats que lui procurait celle-ci au Maroc. Pour les Anglais, l’affaiblissement de la Russie, suite à sa défaite face au Japon, ne permettait plus aucune manoeuvre dangereuse en direction de l’Inde. Elle n’est donc plus l’ennemi principal.
Terrible année 1905
La Russie, battue par le Japon et fragilisée par les menées révolutionnaires, assouplit ses positions: elle est mûre pour entrer dans l’Entente franco-britannique, signée en 1904. Pire, à l’humiliation militaire succède un dissensus civil de nature révolutionnaire: dès juillet 1904, les nihilistes assassinent le ministre de l’intérieur Plehwe; en janvier 1905, une manifestation menée par le Pope Gapone tourne au carnage; en février 1905, c’est au tour du Grand-Duc Serge d’être assassiné; des troubles surgissent en Mandchourie sur l’arrière des troupes; en juin, des mutineries éclatent sur les bâtiments de la flotte de la Mer Noire, dont le fameux cuirassé Potemkine; en octobre 1905, Lénine organise un premier mouvement révolutionnaire à Saint-Pétersbourg, qui débute par une grève générale; les frondes paysannes procèdent à des “illuminations”, c’est-à-dire des incendies de châteaux ou de bâtiments publics, dans les provinces; les Baltes s’attaquent à l’aristocratie allemande et incendient ses domaines; en décembre 1905, Lénine frappe à Moscou mais les troupes sont revenues de Mandchourie et le mouvement bolchevique est maté. Witte, rappelé aux affaires, lance le “Manifeste d’Octobre”, promettant la création d’une Douma dûment élue et des réformes. En 1906, quand la Russie renonce à sa politique d’expansion extrême-orientale, quand elle accepte de nouveaux prêts français, les troubles intérieurs cessent “miraculeusement”; le Tsar, de “monstre” qu’il était, redevient un “brave homme”.
En 1907, Britanniques et Russes signent un accord sur le dos de la Perse des Qadjars décadents, se partageant le pays en zones d’influence. L’année suivante, 1908, est marquée par deux événements majeurs: l’annexion par l’Autriche de la Bosnie-Herzégovine et la révolution des “Jeunes Turcs”. En dépit des menées franco-britanniques pour créer la discorde entre Vienne et Saint-Pétersbourg, les relations austro-russes étaient au beau fixe. En juin, les Autrichiens envisagent de construire une voie ferrée à travers le Sandjak de Novi Pazar, afin d’organiser la péninsule balkanique selon leurs intérêts. Cette intention provoque imméditement un renforcement des liens entre la Russie et la Grande-Bretagne, suite à l’entrevue entre Nicolas II et Edouard VII à Reval. En juillet, les “Jeunes Turcs” triomphent, réclament une constitution et des élections, auxquelles sont conviés les habitants de Bosnie-Herzégovine, administrés par les Autrichiens mais toujours citoyens ottomans. La Russie craint que les “Jeunes Turcs” donnent une vitalité nouvelle à la Turquie, s’allient aux Français et aux Britanniques, comme lors de la Guerre de Crimée, et reprennent la vieille politique de verrouiller les Détroits. La révolution des “Jeunes Turcs” rapproche Autrichiens et Russes. Ährental et Iswolski, ministres des affaires étrangères, lors des accords secrets de Buchlau en Moravie, seraient convenus de la politique suivante: 1) L’Autriche-Hongrie abandonne ses projets ferroviaires dans le Sandjak de Novipazar; 2) Vienne promet de soutenir tous les efforts russes en vue de déverrouiller les Détroits. Forts de ces accords, les Autrichiens annexent en octobre 1908 la Bosnie-Herzégovine, sans en référer aux Italiens et aux Allemands, leurs alliés réels ou théoriques au sein de la Triplice. Les Bulgares en profitent pour se déclarer totalement indépendants de la Turquie. Les épouses monténégrines de deux Grands-Ducs russes et du Roi d’Italie, hostiles à Vienne, incitent les partis bellicistes et interventionnistes à combattre toute politique autrichienne dans les Balkans. Stolypine ne veut pas la guerre, oblige les bellicistes à la modération, mais la Russie n’a plus aucun appui en Europe pour soutenir ses visées sur les Détroits. Les diplomates britanniques, tels l’Ambassadeur Nicolson et Sir Eyre Crowe, répandront la légende que les Autrichiens, et derrière eux, les Allemands, sont les seuls et uniques responsables du verrouillage des Détroits. En 1909, l’Angleterre appuie les prétentions françaises sur le Maroc, en échange d’une reconnaissance définitive de la prépondérance anglaise en Egypte.
De l’assassinat de Stolypine à l’attentat de Sarajevo
En 1911, avec l’assassinat de Stolypine par un révolutionnaire exalté, toutes les chances d’éviter un conflit germano-russe et austro-russe s’évanouissent. Sazonov, beau-frère de Stolypine et successeur d’Iswolski, opte pourtant pour une politique pacifiste et suscite une dernière entrevue entre Guillaume II et Nicolas II à Postdam, où Bethmann-Hollweg et Kiderlen-Wächter tenteront, pour la dernière fois, de sauver la paix, en proposant aux Russes de se joindre au projet de chemin de fer Berlin-Bagdad et de les associer à une future ligne ferroviaire dans le nord de la Perse. Mais les bellicistes ne désarmaient pas: l’ambassadeur russe à Belgrade, Hartwig, appuie le mouvement grand-serbe contre l’Autriche; Delcassé ordonne la marche des troupes françaises sur Fez au Maroc, bouclant ainsi la conquête définitive du royaume chérifain, où l’Allemagne perd tous ses intérêts; Lloyd George menace directement l’Allemagne. Celle-ci cède au Maroc, en acceptant, pour compensation, une bande territoriale qu’elle adjoindra à sa colonie du Cameroun. En Europe, elle est bel et bien encerclée. Le scénario est prêt: il n’attend plus qu’une étincelle; ce sera l’attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914.
En 1918, quand l’Allemagne perd définitivement la guerre et que la Russie devient bolchevique, plusieurs voix s’élèvent, à gauche et à droite de l’échiquier politico-idéologique, pour réclamer une nouvelle alliance germano-russe. Ces tractations conduiront aux accords de Rapallo entre Tchitchérine et Rathenau (1922). L’Allemagne et la Russie maintiendront des rapports privilégiés, notamment sur le plan de la coopération militaire, jusqu’en 1935, date où Hilter décide de réintroduire le service militaire obligatoire, de réoccuper la Rhénanie et de relancer un programme de réarmement.
En 1936, avec l’Axe Rome-Berlin et la création du Pacte Anti-Komintern, les liens sont rompus avec la Russie soviétisée. Quand éclate la guerre civile espagnole, l’Allemagne soutient les nationalistes de “l’Alzamiento nacional” et l’URSS les Républicains du “Frente Popular”, qui comptent les communistes dans leurs rangs. Le soutien à Franco rapproche définitivement l’Allemagne de l’Italie, mais les communistes espagnols et leurs alliés soviétiques se désolidarisent du bloc, d’abord uni, du “Frente Popular” et se heurtent aux autres factions militantes de gauche, anarchistes et trotskistes (POUM), dans les territoires contrôlés par les Républicains espagnols, notamment à Barcelone, contribuant à la ruine définitive du “Frente Popular” et à l’effondrement de ses forces armées. Après la victoire du camp franquiste et l’émiettement du camp des gauches, tout est en place pour rapprocher l’Axe, et plus particulièrement l’Allemagne, de l’URSS. En août, le fameux Pacte germano-soviétique, ou Pacte Ribbentrop-Molotov, est signé à Moscou. L’Allemagne est libre pour tourner toutes ses forces vers l’Ouest, tout en recevant pétrole et céréales soviétiques. L’idylle durera jusqu’en 1941, quand Molotov, déjà inquiet de la politique balkanique des Allemands, ne peut admettre leur contrôle définitif de la Yougoslavie et de la Grèce. Ces dissensus, renforcés par les menaces réelles que les Anglais faisaient peser sur le Caucase à portée des appareils de la RAF, constituent les préludes de l’Opération Barbarossa, déclenchée le 22 juin 1941. Les rapports germano-russes entre 1918 et 1945 méritent à eux seuls qu’on leur consacre un séminaire entier. Ce n’est pas notre propos aujourd’hui. C’est pourquoi je demeurerai bref sur ce thème pourtant capital afin de comprendre la dynamique du siècle (9).
Pas d’Europe libre si la bipolarité Est/Ouest persiste
Après 1945, la Guerre Froide s’installe avec le blocus de Berlin et le coup de Prague. Elle durera plus de quarante ans, imprègnera les esprits car tous imaginaient que cette situation allait perdurer pour les siècles des siècles. Dans ce contexte bipolaire, où l’idéologie semblait dominer, l’Europe était coupée en deux, l’Allemagne était traversée par un Rideau de Fer et partagée en deux républiques antagonistes; le Danube, artère centrale de l’Europe, était bloqué peu après Vienne; l’Elbe, principal fleuve de la plaine nord-européenne, qui mène de Prague à Hambourg, était coupée dès l’hinterland immédiat de ce grand port. Une telle Europe n’était plus qu’un comptoir atlantique. Dans les années 50, elle possédait encore pleinement son poumon extérieur colonial. Dès la décolonisation des premières années des “Golden Sixties”, ce poumon n’est plus garanti et le palliatif des multinationales, qui créent de l’emploi et remplacent les vocations coloniales, plonge l’Europe dans une dépendance dangereuse. Voilà le contexte politique international dans lequel émergera la conscience politique de ma génération. Pour ma part, elle émergera cahin-caha à partir de mes quatorze ans; après cinq ou six années de tâtonnements, vers 1975-76, nos groupes informels, plutôt des groupes de copains, inspirés par la postérité de l’école des cadres de “Jeune Europe”, innervés par de nouvelles lectures et stimulés par de nouvelles donnes politiques, en arrivent à la conclusion générale qu’il est impossible de donner un avenir libre à la portion occidentale de l’Europe si la bipolarité Est/Ouest persiste.
Dans le contexte belge, Pierre Harmel avait tenté une ouverture à l’Est, en multipliant les rapports bilatéraux entre la Belgique et de petites puissances du bloc communiste, telles la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie. Il agissait de manière pragmatique, sans s’aligner sur la France de De Gaulle, qui, en tant que France, demeure toujours un danger pour l’intégrité psychologique et territoriale de notre pays (qui est, avec le G.D. du Luxembourg et avec ses frontières complètement démembrées au sud, le dernier lambeau indépendant du Grand Lothier de médiévale mémoire). Harmel n’imitait pas pour autant l’Ostpolitik de Willy Brandt, avec son discours empreint de ce sens allemand de la culpabilité, qui, en Belgique, n’était évidemment pas de mise. Harmel entendait restituer une “Europe Totale”, détacher le sous-continent de la logique figée des blocs. Ces efforts furent malheureusement de courte durée et, dans son propre parti, on ne l’a guère suivi. Après l’ère Harmel, l’ère Vanden Boeynants est arrivée, avec une politique atlantiste, pro-OTAN et philo-américaine. Plus tragique bien que moins visible: l’échec du “harmélisme” diplomatique signifie aussi la fin du catholicisme politique cohérent en Belgique, héritier de la tradition bourguignonne et impériale hispano-autrichienne. La Belgique oublie alors qu’elle a incarné cette tradition dans l’histoire de ces cinq derniers siècles, avec un brio inaltérable, et elle accepte, avec “Polle Pansj” (“Popol Boudin”, alias Vanden Boeynnants) et ses successeurs, le statut misérable de petit pion subalterne sur l’échiquier atlantiste.
Kissinger “drague” la Chine de Mao
Dans ce contexte, postérieur aux agitations de 1968, la donne générale, sur l’échiquier international, était en train de changer: pour disloquer le bloc communiste eurasien, reposant sur le pilier chinois et le pilier soviétique, pour embrayer sur un conflit bien réel qui venait de surgir au sein de ce bloc rouge, soit la guerre chaude sino-soviétique le long du fleuve Amour, la diplomatie américaine de Kissinger, posant pour principe que Moscou demeure et restera l’ennemi principal, va “draguer” la Chine de Mao et nouer avec elle, dès 1971-72, des relations diplomatiques normales, tout en la soutenant en Asie orientale contre l’URSS. Cette diplomatie repose, une fois de plus, sur les théories géopolitiques de Mackinder et de ses disciples: dans l’optique de ces théories, il convient, le cas échéant, de soutenir une puissance du rimland (ou “inner crescent”), ou une alliance de moindres puissances du rimland, contre la puissance détentrice de la “Terre du Milieu”. Les maoïstes de mai 68 basculeront partiellement dans le camp américain contre les “mouscoutaires”: Washington avait déjà déployé ses propres “communistes”, principalement d’obédience trotskiste ou issus de l’ancien POUM de la Guerre Civile espagnole; à ceux-ci s’adjoindront bientôt des maoïstes, forts de la nouvelle alliance Washington/Pékin.
Avec la disparition, à l’avant-scène, de Harmel et de sa politique des rapports bilatéraux entre petites puissances du bloc occidental et petites puissances du bloc oriental, et avec la disparition, dans les marges militantes de la politique, de “Jeune Europe” de Jean Thiriart, qui visait une libération de notre sous-continent des tutelles américaine et soviétique, aucun champ d’action politique réel et concret ne s’offrait encore à nous. Nous vivions les prémisses de la “Grande Confusion”, avec des lignes de fracture qui scindaient désormais tous les camps qui avaient été présents sur le terrain avant la réconciliation sino-américaine. Cette grande confusion frappait essentiellement les groupes activistes de gauche mais ne permettait pas davantage de clarté dans les petites phalanges européistes et nationales révolutionnaires.
Rapprochement euro-russe, seule solution viable
Dans l’optique de la mouvance “Jeune Europe” des années 60, les deux superpuissances étaient posées et perçues comme également nuisibles à l’éclosion d’une Europe libre. Quand Washington se rapproche de la Chine et que le bloc rouge se scinde en deux puissances antagonistes, “Jeune Europe” ne peut plus préconiser ni des alliances ponctuelles et partielles entre petites puissances des deux blocs (comme lors du voyage de Thiriart en Roumanie) ni une alliance de revers avec la Chine pour obliger l’URSS à lâcher du lest en Europe danubienne. Le bloc sino-américain devient une menace pour l’Europe et, ipso facto, un rapprochement euro-russe apparaît comme la seule solution viable à long terme pour les tenants de la Realpolitik. Ce pas, le Général italien e.r. Guido Gianettinni, Jean Thiriart et l’écrivain franco-roumain Jean Parvulesco le franchiront, en étayant leurs positions d’arguments solides.
Entre-temps, en 1975, les Etats-Unis abandonnent le Sud-Vietnam exsangue au Nord vainqueur et pro-soviétique et déclenchent aussitôt, avec leurs nouveaux alliés chinois, une guerre sur la frontière sino-tonkinoise et arment, via la Chine, le Cambodge de Pol Pot pour harceler en Cochinchine le nouveau Vietnam réunifié. Le Vietnam sera ainsi neutralisé et cessera d’être une “poche de résistance” sur le rimland du Sud-Est asiatique, désormais étendu à la Chine, comme c’était prévu d’ailleurs sur toutes les cartes dessinées par l’école anglo-saxonne de géopolitique de Mackinder à Lea et à Spykman. Plus personne, aujourd’hui, surtout dans les jeunes générations, ne s’imagine encore quel était l’état de confusion mentale au sein des gauches militantes, où se disputaient âprement mouscoutaires, trotskistes, maoïstes pro-albanais, autogestionnaires titistes, maoïstes anti-soviétiques, partisans et adversaires de Pol Pot ou de Ho Chi Minh. Ce chaos a scellé la fin de la gauche militante classique entre 1975 et 1978-79, quand l’émiettement en chapelles antagonistes ne permettait plus de faire émerger un bloc politique offensif et viable. Les gauches dures, juvéniles et révolutionnaires, sont mortes, faute d’avoir eu un raisonnement géopolitique cohérent. Pire, parce qu’elles avaient auparavant accepté des raisonnements géopolitiques étrangers à leur propre nation ou nation-continent.
Carter et les “droits de l’homme”, Reagan et l’ “Empire du Mal”
Avec l’arrivée au pouvoir du démocrate Jimmy Carter à Washington en 1976, nous entrons de plein pied dans la période de gestation de l’univers mental qui règne aujourd’hui et qui est de plus en plus ressenti comme étouffant. Les termes fétiches de la “political correctness” se mettent en place, avec l’introduction de la diplomatie dite des “droits de l’homme” et avec une opposition républicaine qui s’aligne sur les thèses du néo-libéralisme, par ailleurs propagées par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. En 1979, celle-ci inaugure l’ère néo-libérale qui prend fin avec la crise de cet automne 2008. En 1980, quand Reagan accède à la présidence américaine, sa version du néo-libéralisme, les “reaganomics”, vont étayer et non effacer la diplomatie cartérienne des “droits de l’homme”, et la mettre à la sauce apocalyptique en évoquant un “empire du Mal”, prélude à “l’Axe du Mal” de Bush junior.
En Europe, le discours sur les “droits de l’homme” oblitère tout et une partie de la gauche militante émiettée, orpheline, va marcher dans le sens de ce nouveau “subjectivisme” bien médiatisé, base philosophique première de la méthodologie hyper-individualiste du néo-libéralisme de Hayek, Friedmann, etc. Le moteur de cette nouvelle synthèse, dans une France marquée par l’étatisme gaulliste et communiste, sera le discours des “nouveaux philosophes”, porté essentiellement, en ces années-charnières, par deux écrits de Bernard-Henry Lévy, “Le Testament de Dieu” et “L’idéologie française”. Ce dernier constituant un véritable instrument de diabolisation de toutes les forces politiques françaises car, toutes, indifféremment, porteraient en elles les germes d’un fascisme ou d’une dérive menant à un univers concentrationnaire.
Les ingrédients idéologiques des deux manifestes de Lévy, dont les assises philosophiques sont finalement bien ténues, vont houspiller dans la marginalité politico-médiatique les discours plus militants de mai 68 et aussi, ce qui est plus grave parce que plus stérilisant, tout cet ensemble de pensées, de théories et de réflexions que Ferry et Renaud appelleront la “pensée 68”. Cette dernière constitue un dépassement intellectuel séduisant du simple militantisme étudiant et ouvrier de l’époque, qui était imbibé de ces vulgates rousseauistes et communistes (typiquement françaises) et avait reçu la bénédiction du vieux Sartre (“ne pas désespérer Billancourt”).
Potentialités de la “French Theory”, magouilles des “nouveaux philosophes”
Cette “pensée 68”, que les universitaires américains nomment dorénavant la “French Theory”, englobe Deleuze, Guattari, Lyotard et Foucault: elle est accusée, en gros par ses critiques parisiens, néo-philosophes à la Lévy ou néo-quiétistes à la Comte-Sponville, inquisiteurs tonitruants ou apologètes doucereux du ronron consumériste, de privilégier dangereusement la “Vie” contre le “droit”, d’opter tout aussi dangereusement pour des méthodologies généalogisantes et archéologisantes de nietzschéenne mémoire, etc. Pour le réseau, finalement assez informel, des “nouveaux philosophes”, “maîtres penseurs” allemands du 19ème (Glucksmann) et phares de la “French Theory” doivent céder la place à “un marketing littéraire et philosophique” (selon la critique cinglante que fit Deleuze de leur pandémonium médiatique), soit à un “prêt-à-penser” bien circonscrit qui se pose comme l’attitude intellectuelle indépassable qui va mettre bientôt un terme définitif aux horreurs de l’histoire, qui déboucheraient invariablement sur l’univers concentrationnaire décrit par Soljénitsyne dans “L’Archipel Goulag”. Les “nouveaux philosophes” et assimilés sont les “vigilants” qui veillent à ce qu’advienne la fin de l’histoire (Fukuyama) et que l’humanité aboutisse enfin à la grande quiétude antitotalitaire. La clique parisienne des “nouveaux philosophes” et assimilés entend représenter “l’espérance radicale de la disparition du mal”. L’antithèse de la pensée des maîtres penseurs, qui génèreraient l’univers concentrationnaire, se trouve tout entière concentrée dans le discours sur les droits de l’homme, inauguré par Carter, et constitue l’instrument premier pour lutter contre “l’Empire du Mal” et tous ses avatars, comme le voulaient Reagan et, plus tard, le père et le fils Bush. Le discours des “nouveaux philosophes” correspond donc bel et bien aux objectifs généraux de l’impérialisme américain, et son apparition dans le “paysage intellectuel français” n’est certainement pas l’effet du hasard: on peut sans trop d’hésitation le considérer comme une production habile et subtile des agences médiatiques d’Outre-Atlantique, fers de lance du “soft power” américain.
Ce glissement idéologique hors du questionnement inquiétant de la “French Theory”, a été systématiquement appuyé par les médias, qui ont écrasé toutes les nuances et les subtilités du discours politico-idéologique, pire, ne les tolèrent plus au nom d’une tolérance préfabriquée; il s’est opéré dès l’avènement de Thatcher au pouvoir à Londres et s’est considérablement renforcé quand Reagan a accédé à la Présidence américaine. Le passé maoïste militant de certains exposants, majeurs ou mineurs, de la “nouvelle philosophie” de Glucksmann, Lévy et autres homologues avait permis à Guy Hocquenghem d’ironiser dans une “Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary”. L’image est aussi pertinente que percutante: des maoïstes, jadis rabiques admirateurs sans fard des excès de la “révolution culturelle”, sont effectivement devenus “salonfähig”, dès le rapprochement sino-américain de la première moitié des “Seventies”. Dénominateur commun: l’anti-soviétisme. Ce soviétisme que leurs camarades trotskistes appelaient, pour leur part, le “panzercommunisme”. Donc, on peut aisément conclure que nos anciens révolutionnaires trotskistes ou maoïstes des barricades parisiennes avaient bien davantage que quelques points en commun avec Zbigniew Brzezinski. Celui-ci, rappellons-le, était l’avocat, au sein de la diplomatie américaine, d’une nouvelle alliance avec la Chine et le principal partisan d’une destruction de l’URSS par démantèlement de ses glacis caucasiens et centre-asiatiques. Plus tard en Afghanistan, il préconisera une alliance avec les mudjahiddins et, finalement, avec les talibans.
Le grand retour de la pensée slavophile
En Union Soviétique, la période qui va de 1978 à 1982 (année de la disparition de Brejnev) est marquée par une tout autre évolution intellectuelle. On assistait à une véritable “révolution conservatrice”, à un retour aux sources de la “russéité”, aux linéaments de la slavophilie du 19ème siècle, à un retour de Dostoïevski. La figure emblématique de ce renouveau “völkisch” (folciste) et slavophile a été sans conteste l’écrivain Valentin Raspoutine (10). Pour cet écrivain aux accents ruralistes, les notions de mémoire, de souvenir, de continuité sont cardinales et primordiales. Pour Raspoutine, la conscience n’est telle que parce qu’elle se souvient et s’inscrit dans des continuités imposées par le flux vital (et donc par l’histoire particulière du peuple dont le “je” fait partie). Une action humaine n’est justifiable moralement que si elle s’imbrique dans une continuité, que si elle lutte contre les manigances de ceux qui veulent, par intérêt particulier ou égoïste, provoquer des discontinuités. Le thème littéraire du déracinement et de l’aliénation (par rapport aux origines) implique celui de la perte simultané de l’intégrité morale. On l’avait déjà lu chez le Norvégien Knut Hamsun. L’oubli de son propre passé plonge l’homme dans la dépravation morale, la laideur d’âme.
Cette position philosophique fondamentale heurte de front les idéologies modernes de la “tabula rasa”, dont le communisme fut l’avatar le plus caricatural. Du jacobinisme ou du babouvisme français de la fin du 18ème siècle au communisme, court, sans discontinuité aucune, un fil rouge qui ne produit rien de bon, rien que germes et bacilles de déclin et de dépravation. Au moment où l’Union Soviétique atteignait son apogée, le faîte de sa puissance, et justifiait son existence et ses succès par une idéologie “progressiste” qui avait la prétention de laisser derrière elle tous les legs du passé, émergeait au sein même de la société soviétique un éventail de thèmes littéraires dont la teneur philosophique était radicalement différente de l’idéologie officielle. Je me souviens encore, dans ce contexte, avoir acheté, à la “Librairie de Rome”, avenue Louise, et à la “Librairie du Monde Entier”, gérée par le PCB, un exemplaire de “Sciences sociales”, revue de l’Académie de l’Union Soviétique, avec un long article de Boris Rybakov sur le paganisme russe avant la conversion au christianisme, et l’exemplaire de “Lettres soviétiques” consacré à la réhabilitation de Dostoïevski et édité, à l’époque, par Alexandre Prokhanov, l’éditeur de “Dyeïenn” et “Zavtra”, que j’allais rencontrer à Moscou en 1992. Les textes de Rybakov paraîtront dans les années 90 aux PUF.
“Occidentalistes” et “Slavophiles” dans la dissidence et dans l’établissement
Outre les articles de Wolfgang Strauss en Allemagne (11), l’ouvrage le plus significatif, à l’époque, qui explicitait, en le critiquant de manière fort acerbe, ce renouveau slavophile était dû à la plume d’un dissident exilé aux Etats-Unis: Alexander Yanov (graphie allemande: Janow), attaché à l’Institute of International Studies de Berkeley (Université de Californie). Pour donner ici les grandes lignes de l’ouvrage de Yanov (12), disons qu’il subdivisait, de manière assez binaire, le paysage politico-intellectuel de l’URSS de Brejnev, comme le champ d’affrontement entre “Zapadniki” (“occidentalistes”) et “Narodniki” (“populistes” voire “völkische/folcistes” ou, plus exactement, ce que nous appellons, nous, en Flandre, les “volkgezinden” ou au Danemark, les “folkeliger”). Yanov, émigré aux Etats-Unis se posait incontestablement comme un occidentaliste et fustigeait les nouveaux Narodniki ou néo-slavophiles, en les campant comme “dangereux”. Yanov, cependant, expliquait à ses lecteurs américains que la dissidence soviétique comptait en son sein des “zapadniki” et des “narodniki” (dont il convenait de se défier, bien entendu!), tout comme dans les hautes sphères du pouvoir soviétique où se côtoyaient également occidentalistes et populistes. Parmi les grandes figures qui tendaient vers le populisme, Yanov comptait Soljénitsyne. Sa conclusion? En URSS, fin des années 70, les populistes et les étatistes avaient gagné du terrain, par rapport aux occidentalistes, et constituaient in fine la force métapolitique majeure en Union Soviétique, une force certes non officielle et sous-jacente, mais néanmoins déterminante. Cette domination implicite des “Narodniki” sur les esprits devait, selon Yanov et bon nombre de dissidents occidentalistes, inciter les Etats-Unis et les atlantistes à la vigilance car, communiste ou non, la Russie demeurait un danger parce que son essence était intrinsèquement “dangereuse”, rétive aux formes “civilisées” de la gouvernance à l’occidentale ou à l’anglo-saxonne. Cette attitude “russophobe”, Soljénitsyne la fustigera avec toute la véhémence voulue, dans son tonifiant pamphlet “Nos pluralistes”. Nous nous empressons d’ajouter que la critique du “narodnikisme” sous toutes ses formes, nouvelles ou anciennes, et que les tirades haineuses que Soljénitsyne lui-même a dû essuyer, démontrent, toutes, que la russophobie qui visait les tsars du dix-neuvième siècle ou qui se profilait derrière un certain anti-soviétisme n’est pas prête à disparaître dans les discours occidentaux.
L’époque de la fin du brejnevisme était donc marquée par la nouvelle alliance sino-américaine, par le déploiement des thèses de Brzezinski chez les stratégistes du Pentagone et des services secrets, par la mise en place d’une russophobie déjà post-soviétique dans ses grandes lignes, et ensuite par l’alliance entre les Etats-Unis et les fondamentalistes wahhabites et, enfin, par l’élimination du Shah avec la création, de toutes pièces, d’un chiisme fondamentaliste et offensif en Iran. La carte du monde s’en trouve sensiblement modifiée: la cassure nette et duale, propre de l’hégémonisme duopolistique de Yalta, fait place à une plus grande complexité, notamment par l’avènement du facteur islamiste, voulu, dans un premier temps, par les stratégistes américains. Forts de cette alliance avec les mudjahhidins afghans, armés de missiles Stinger, les Etats-Unis tentent d’avancer leurs pions en Europe en déployant leurs fusées Pershing en Allemagne, face aux SS-20 soviétiques. En cas d’affrontement direct entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie, l’Allemagne, le Benelux, l’Autriche, l’Alsace et la Lorraine risquaient d’être vitrifiés. Cette éventualité, peu rassurante, fit aussitôt renaître en Allemagne le mouvement neutraliste, oublié depuis les années 50. Pour nous, le mouvement neutraliste a été incarné principalement par la revue allemande “Wir Selbst”, fondée en 1979 par Siegfried Bublies dans l’intention de dégager le mouvement national de sa cangue passéiste, de ses nostalgies stériles et de ses rodomontades ridicules. Bublies entretenait en Flandre des relations amicales avec les fondateurs de la revue “Meervoud” qui existe toujours.
De la rhétorique des “droits de l’homme” à la guerre permanente
Le combat contre le déploiement des missiles en Europe a connu son apogée dans les années 1982-83, portée essentiellement par une gauche pacifiste, que l’on accusait d’être “crypto-communiste” et, par conséquent, d’être stipendiée par Moscou. Mais cette hostilité au bellicisme de l’OTAN n’était pas le propre des seuls mouvements pacifistes de gauche et d’extrême gauche. Ailleurs sur l’échiquier politique, bon nombre d’esprits s’inquiétaient des nouvelles rhétoriques cartériennes et reaganiennes, qui contaminaient les milieux libéraux et conservateurs, voire d’extrême droite, et avaient pour corollaire évident de miner les principes de la diplomatie traditionnelle. En effet, la rhétorique des “droits de l’homme”, maniée dans les médias par les démocrates cartériens et les “nouveaux philosophes”, ruinait le principe cardinal de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, propre de la diplomatie traditionnelle. Quand le Républicain Reagan ajoute à cette pernicieuse rhétorique “immixtionniste”, le langage apocalyptique des fondamentalistes religieux américains, les principes de la diplomatie metternichienne, la logique des traités de Westphalie et de Vienne, reculent encore d’une case. Le processus de déliquescence de la diplomatie classique s’achèvera quand les néo-conservateurs de l’entourage de Bush-le-Fils, décrèteront tout de go que le respect de ces principes est un “archaïsme frileux”, indigne des Américains, posés comme “les fils virils du dieu Mars”, et l’indice le plus patent de la lâcheté de la “Vieille Europe”, gouvernée par “les pleutres fils de la déesse Vénus”. Pour nous, à partir de 1983-84, ce sera le Général Jochen Löser, ancien Commandeur de la 24ème Panzerdivision de la Bundeswehr, qui énoncera les lignes directrices de nos argumentaires (13) : la rhétorique des “droits de l’homme” rend impossible l’exercice de la diplomatie classique; les dissensus internes, qu’elle exploite via les médias et les agences qui les informent, ne trouvent plus aucune solution équilibrée, s’en trouvent pérennisés, inaugurant de la sorte des cycles de “guerres longues”; les “droits de l’homme”, contrairement aux apparences, n’ont pas été hissés au rang d’idéologie dominante pour faire triompher sur la planète entière un humanisme de bon aloi, mais pour amorcer un processus infini de guerres, de révolutions et de troubles.
Le mouvement neutraliste, tel que nous le concevions au début des années 80, reposait donc sur trois piliers: 1) le refus du déploiement de missiles en Europe, afin d’éviter la transformation définitive de notre sous-continent en “son et lumière”; 2) le refus de perpétuer la logique des blocs, avec la dissolution de l’OTAN et du Pacte de Varsovie et la création d’un vaste espace neutre en Europe centrale, de la Mer du Nord à Brest-Litovsk et de la Laponie à l’Albanie; cet espace neutre devait organiser un système défensif performant sur le mode helvétique; il ne refusait donc ni les forces armées ni le principe du citoyen-soldat à l’instar des pacifistes de gauche; 3) il entendait revenir aux principes de la diplomatie classique et refusait de ce fait d’embrayer sur les discours imposés par les médias (ou le “soft power”). Le neutralisme, en prenant le contre-pied du prêt-à-penser médiatique, s’avérait un espace de liberté, face à la “novlangue” planétaire, si bien fustigée par George Orwell dans “1984”.
Nous avons eu la naïveté de croire à l’avènement d’une “Maison Commune” européenne
Si le mouvement neutraliste avait pu distiller ses arguments pendant une période plus longue, imprégner plus durablement les esprits, la pensée politique diffuse en Europe aurait pu générer des anti-corps. Mais l’effervescence anti-missiles et les réflexions neutralistes se sont étalées sur quatre années seulement. Dès 1984-85, Gorbatchev lance deux idées: celle, très positive, de “Maison Commune européenne” et, celle, double, de “perestroïka” et de “glasnost”, de réforme et de transparence. Ce changement de discours à Moscou mine définitivement le communisme soviétique traditionnel. Entre 1989 et 1991, en effet, le communisme en tant que bloc monolithique disparaît du paysage politique international. Notre conclusion à l’époque: s’il n’y a plus de communisme, il ne peut plus y avoir d’animosité à l’endroit des peuples d’au-delà de l’ancien Rideau de Fer. Les motifs d’un conflit éventuel n’existaient plus. Nous avons eu la naïveté de croire à l’avènement d’une Maison Commune européenne pacifiée, à l’ouverture d’une ère marquée par un esprit plus ou moins équivalent à celui qui se profilait derrière l’idée de paix perpétuelle chez Kant.
Rapidement, l’idée universaliste armée du communisme soviétique allait faire place à un néo-conservatisme, dérivé de la matrice du trotskisme américain et new-yorkais. Alliant le néo-libéralisme, nouvelle grande idéologie universaliste, à ce trotskisme fidèle à la notion de révolution permanente mais habilement masqué par une phraséologie conservatrice et puritaine, le néo-conservatisme va se consolider en deux étapes: la première, avec Reagan, constituera un “mixtum” de paléo-conservatisme, d’anti-fiscalisme, de néo-libéralisme et, en politique internationale, d’une diplomatie en apparence plus classique qu’avec les droits de l’homme de Carter mais néanmoins érodée par une phraséologie apocalyptique (l’Empire du Mal, etc.). Reagan prend finalement le relais de Nixon, dernier président américain à avoir appliqué plus ou moins correctement les règles de la diplomatie classique. Mais, tout en prenant le relais de Nixon, il doit tenir compte des acquis ou des avancées de l’anti-diplomatie cartérienne, basée sur l’idéologie des droits de l’homme. Cependant, le langage apocalyptique s’atténuera pendant son second mandat.
Le néo-conservatisme crypto-trotskiste met un terme définitif à la diplomatie classique
Avec Bush le père commencent les tentatives de forcer la main aux instances internationales et de passer à de véritables offensives sur le terrain, la Russie d’Eltsine n’opposant aucun veto crédible. Clinton renouera, notamment pendant la Guerre des Balkans contre la Serbie, avec l’idéologie des droits de l’homme, prétendument bafouée par Milosevic dans la province du Kosovo. Avec Bush le fils, le néo-conservatisme crypto-trotskiste met un terme définitif à la diplomatie classique, la brocarde comme une “vieillerie” incapacitante, propre justement de la “Vieille Europe” et de la Russie (posée souvent comme “stalinienne” ou “néo-stalinienne” depuis l’avènement de Vladimir Poutine). Ce rejet de la diplomatie classique et des règles de bienséance internationale est l’indice le plus patent qui permet de démontrer, outre les liens et itinéraires personnels des exposants majeurs du néo-conservatisme, que le néo-conservatisme est en réalité un trotskisme dans la mesure où il affine la notion de “révolution permanente” en abolissant toutes les règles en vigueur, toutes les règles communément acceptées, et en recréant un monde incertain, où le recours aux guerres et aux invasions redevient un mode de fonctionnement tout à fait naturel et acceptable. Le “Big Stick Policy” de Teddy Roosevelt est désormais au service d’une bande trotskiste qui entend plonger le monde dans un chaos permanent (assimilé à la “révolution”).
C’est uniquement avec le recul que l’on perçoit clairement les vicissitudes de cette politique américaine et son jeu d’avancées et de reculs, camouflé par l’alternance des Démocrates et des Républicains au gouvernail du pouvoir. L’accession à la magistrature suprême aux Etats-Unis de Bush le père constitue aussi l’arrivée des pétroliers texans qui savent à tout moment se souvenir que la puissance américaine dérive du contrôle des hydrocarbures dans le monde, et en particulier dans la péninsule arabique et le Golfe Persique. La crainte d’un prochain “pic” pétrolier implique la volonté de contrôler le maximum de puits dans cette région afin de garantir l’hégémonie globale de Washington, au moins jusqu’à la fin du 21ème siècle. D’où le projet PNAC (“Project for a New American Century”). Les chanceleries européennes savent parfaitement que l’Amérique entend perpétuer son hégémonisme en contrôlant les sources d’hydrocarbures moyen-orientales au détriment de toutes les autres puissances du globe et que le rejet de la diplomatie classique finit par être un “modus operandi” commode pour imposer sa volonté sans discussion ni débat ni concertation. Mais ces mêmes chanceleries sont incapables d’opposer, par manque de volonté et de cohérence intellectuelle, par fascination imbécile du modèle américain, une métapolitique européenne générale, un “soft power” européen capable de distiller dans les esprits, via les médias, des raisonnements et de “grandes idées incontestables” contrairement à leur homologue américaine, “grandes idées incontestables” véhiculées par les grandes agences médiatiques d’Outre Atlantique.
Les “blanches vertus” du démocratisme planétaire
L’Amérique est maîtresse du monde non seulement parce qu’elle contrôle les hydrocarbures mais aussi et surtout parce qu’elle forge, répand et impose les opinions dominantes dans le monde, spécialement en Europe. En 1999, quand le “bon apôtre” Clinton, posé comme tel parce que “démocrate” donc de “gauche”, lance ses bombardiers contre Belgrade, les pays européens de l’OTAN emboîtent le pas sans régimber. Depuis Franklin Delano Roosevelt, le démocrate qui avait lancé la croisade contre l’Europe allemande en 1941, la “bonté” politique, les blanches “vertus” du démocratisme planétaire sont incarnées, avant tout, par les démocrates américains. Par conséquent, si on ne suit pas leurs injonctions, on plonge dans le “mal”, dans le “crypto-nazisme” ou dans une résurgence quelconque de l’hitlérisme. Cet immense simplisme est profondément ancré dans les mentalités contemporaines et malheur à qui tente de l’extirper comme une mauvaise herbe! De fait, les réseaux pro-américains sont nés, en Europe, dans les années 40, sous l’impulsion de l’Administration Roosevelt, d’obédience démocrate; l’atlantisme militant avait au départ un ancrage plutôt social-démocrate (à l’exception de Schumacher en Allemagne de l’Ouest), que conservateur ou même libéral au sens européen du terme à l’époque.
La participation des pays européens de l’OTAN, France chiraquienne comprise, aux bombardements des villes serbes, est l’indice d’un parfait “écervèlement politique”: la politique de Clinton et de son adjointe Madeleine Albright (qui a eu pour étudiante Condoleezza Rice; vous avez dit continuité?) réintroduisait indirectement la Turquie dans les Balkans, en détachant de la Serbie comme de la Croatie, et en dépit des peuplements serbes ou croates, les anciennes provinces ottomanes du tronc commun, induisant ainsi l’émergence d’une “dorsale islamique” de la Méditerranée à l’Egée et à la Mer Noire. Tous les Etats voisins s’en trouvaient fragilisés: la Macédoine, la partie de la Grèce entre Thessalonique et la frontière turque, la Bulgarie qui compte de dix à quinze pourcents de musulmans, souvent ethniquement turcs, sans compter la sécession du Kosovo, prévisible dès 1998. De plus, les minorités non musulmanes au sein des nouveaux Etats majoritairement musulmans sont menacées à terme en Albanie, au Kosovo, en Macédoine.
La création délibérée du chaos dans les Balkans n’est pas une politique démocrate, qui s’opposerait à une politique républicaine antérieure. Elle s’inscrit bien au contraire dans une parfaite continuité. Bush le père, Républicain, installe ses troupes en lisière de l’Irak de Saddam Hussein, contrôle l’espace aérien irakien et prépare ainsi la seconde manche, soit l’invasion totale de l’Irak, qui aura lieu, sous le règne de son fils, en 2003. Clinton, Démocrate, lui, s’empare du tremplin de l’Europe en direction du Proche et du Moyen Orient depuis l’épopée d’Alexandre le Grand. La maîtrise des Balkans et celle de la Mésopotamie participent d’une seule et même stratégie grand-régionale. L’empire macédonien-hellenistique d’Alexandre le Grand, l’empire ottoman ont toujours maîtrisé à la fois les Balkans et la Mésopotamie au faîte de leur puissance. C’est une loi de l’histoire. Les stratégistes américains s’en souviennent.
Les réseaux pro-américains étaient au départ socialistes
La guerre contre la Yougoslavie résiduaire de Milosevic en 1999, premier conflit de grande envergure en Europe depuis 1945, est donc le fait d’un président et d’une équipe issus du parti démocrate américain. C’est la raison pour laquelle les puissances européennes, grandes et petites, ont suivi comme un seul homme, contrairement à ce qui allait se passer en 2003, lors de l’invasion de l’Irak. Cette unanimité s’explique tout simplement parce que l’Europe place toujours sa confiance dans une Amérique démocrate, en se méfiant de toute Amérique républicaine. Pourquoi? Parce que, je le répète, les réseaux pro-américains ont émergé, lors de la seconde guerre mondiale, sous la double impulsion du Président américain et de son épouse Eleonor et que l’atlantisme militant, le “spaakisme” dit chez nous le Prof. Coolsaet de l’Université de Gand, avait un ancrage socialiste plutôt que conservateur (Pierre Harmel s’efforcera au contraire de se dégager de la logique des blocs, que Spaak avait bétonné).
En transformant le tremplin balkanique en une zone contrôlée par les Etats-Unis, le tandem Clinton/Albright neutralisait la région à son profit: celle-ci n’allait plus pouvoir constituer un atout pour le bloc centre-européen germano-centré ni pour une Russie régénérée qui aurait fait valoir ses anciens intérêts dans les Balkans. En 1999, l’Europe a perdu tous les atouts potentiels qu’elle avait gagnés à partir de 1989. Elle les a perdus parce qu’elle n’a pas cultivé le sens de son unité, parce qu’elle n’a pas une vision claire de son destin géopolitique. En 2001, suite aux “attentats” de New York, l’Amérique parachève son projet “alexandrin” en s’emparant rapidement de la zone orientale de l’antique Empire du chef macédonien. En 2003, lorque le fils Bush entend terminer le travail de son père en Mésopotamie, l’Europe semble se réveiller et crée autour de Paris, Berlin et Moscou un front du refus que les services américains fragilisent aussitôt en semant le dissensus entre cet “Axe”, nouveau et contestataire, et de petites puissances comme les Pays-Bas, la Pologne, la République Tchèque et les Pays Baltes, tout en bénéficiant de l’appui de la Grande-Bretagne et de la pusillanimité de l’Espagne et de l’Italie. On se souviendra de la distinction opérée entre “Vieille Europe”, aux réflexes dictés par la diplomatie classique, et “Nouvelle Europe”, alignée sur la logique du fait accompli des néo-conservateurs.
“Révolutions colorées” et pétrole
Les services américains et le soft power de Washington, vont s’activer pour vider l’Axe Paris Berlin Moscou de son contenu: de Villepin en France est éliminé de la course à la présidence, à la suite d’un dossier de corruption sans doute préfabriqué, au bénéfice de Sarközy, qui mènera, comme on le sait, une politique pro-atlantiste. Le social-démocrate allemand Schröder devra céder la place à Angela Merkel, plus sceptique face au bloc continental européen, plus prompte à tenir compte des exigences des Etats-Unis. Schröder demeure toutefois en place, en gérant de main de maître les relations énergétiques entre l’Allemagne et la Russie. Les révolutions orange, qui ont éclaté en Ukraine, en Géorgie, en Serbie (avec “Otpor”) ou au Kirghizistan ne sont donc pas les seules interventions des services et du soft power: en Europe occidentale aussi la politique est manipulée en sous-main, l’indépendance nationale et/ou européenne minée à la base dès qu’elle tente de s’affirmer, par le biais de la manipulation des élections et des factions. Dans l’avenir, un bloc européen indépendant devrait s’abstenir de reconnaître les gouvernements issus de “révolutions colorées”.
En Géorgie, le pouvoir mis en place par la “révolution des roses” a pour objectif de garantir le bon déroulement de la politique pétrolière américaine dans le Caucase et en lisière de la Caspienne. Pour les stratégistes américains, la Géorgie doit être un espace de transit pour les oléoducs et gazoducs amenant les hydrocarbures du Caucase et de la Caspienne vers la Mer Noire et vers la Méditerranée via la Turquie. De là, ils parviendraient en Europe sous le contrôle américain. Le malheur de l’Europe, c’est de ne pas avoir de pétrole. Nous devons acheter la majeure partie de nos hydrocarbures en Arabie Saoudite ou dans les Emirats par l’intermédiaire de consortiums américains. L’affrontement russo-géorgien de l’été 2008, à propos de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, a pour enjeu réel l’énergie. Pour échapper à la dépendance énergétique, l’Europe doit tenter, par tous les moyens techniques possibles, d’abord, de réduire cette dépendance pétrolière en pariant sur des sources propres comme l’énergie nucléaire et toutes les autres sources imaginables et réalisables, selon une optique de diversification adoptée mais non parachevée en son temps par la France gaullienne. Les panneaux solaires constituent une première alternative parfaitement généralisable dans notre pays: en effet, pourquoi les ménages qui constituent notre nation ne pourraient-ils pas générer leur propre électricité domestique, ou une bonne part de celle-ci, sans passer par des fournisseurs contrôlés par l’étranger comme “Electrabel”, entièrement aux mains de l’ennemi héréditaire français, qui occupe depuis trois siècles et demi près des trois quarts du territoire du Grand Lothier! Certaines voix nous disent: par année, le nombre de journées d’ensoleillement est trop restreint en Belgique par rapport à la zone méditerranéenne pour constituer une alternative au pétrole. Peut-être. Mais un pays comme la Norvège, disposant pourtant de pétrole propre, la technique des panneaux solaires génère 50% de l’énergie domestique de ses ménages dans un pays où l’ensoleillement moyen est bien plus réduit que chez nous. Notre objectif premier est la réduction graduelle de la dépendance, non pas l’obtention immédiate d’une autarcie totale.
Pacte de Shanghai et initiatives ibéro-américaines
Nous venons de voir que l’emprise américaine sur notre politique étrangère est complète. Elle détermine aussi notre politique énergétique. L’Amérique séduit les esprits (ou plutôt les masses écervelées) par le truchement de son soft power omniprésent. Le princpal danger qui nous guette dans l’immédiat en Europe est la disparition graduelle et silencieuse des espaces encore neutres. Les pays qui ont gardé le statut de neutralité lorgnent de plus en plus vers l’OTAN. Je rappelle que notre position initiale, calquée sur celle du Général Jochen Löser dans les années 80 en Allemagne fédérale, visait au contraire l’élargissement de l’espace neutre en Europe. Non le contraire! Löser entendait élargir le statut de la Suisse, de l’Autriche, de la Yougoslavie, de la Finlande et de la Suède aux deux Allemagnes, aux Etats du Benelux, à la Pologne, à la Tchécoslovaquie et à la Hongrie. Aujourd’hui, ces trois derniers pays font partie de l’OTAN et en sont même devenus les élèves modèles. De fiers représentants de la “Nouvelle Europe”, telle que l’a définie Bush jr. L’Europe, totalement abrutie par les propagandes distillées par le soft power, ne peut constituer, pour l’instant, dans les conditions actuelles, un espace de renouveau politique, exemplaire pour la planète entière. Les seuls môles de résistance cohérents se situent aujourd’hui en Asie et en Amérique latine. En Asie, la résistance s’incarne dans le “Pacte de Shanghai” et en Amérique latine dans les initiatives du Président vénézuélien Hugo Chavez, alliant, avec les autres contestataires ibéro-américains, les corpus doctrinaux péronistes, castristes et continentalistes qui, fusionnés, permettent aux Etats ibéro-américains de créer des structures unitaires capables de refouler l’ingérence traditionnelle des Etats-Unis dans leurs affaires politiques et économiques, au nom d’une idéologie soi-disant panaméricaniste, forgée au temps de la politique du “Big stick” de Teddy Roosevelt.
Sans le “Pacte de Shanghai” et sans la volonté indépendantiste et continentaliste des Ibéro-Américains, la domination américaine sur le monde serait totale, comme elle est quasiment totale en Europe depuis la liquidation du gaullisme par Sarközy et le “mobbing” systématique de la Suisse et de l’Autriche (affaires Waldheim et Haider). Les espaces potentiels de résistance se font de plus en plus rares: il reste des bribes de gaullisme en France, de bons réflexes neutralistes en Allemagne, une volonté de conserver le statut de neutralité en Autriche, en Suisse et en Suède; l’opinion publique en Belgique, d’après un sondage récent, craint davantage les initiatives bellicistes américaines que celles de la Russie de Poutine (en dépit de la propagande russophobe du “Soir”), alors qu’en Allemagne, où la russophilie de bon nombre de cercles établis est plus solidement ancrée, Washington et Moscou sont mis sur pied d’égalité.
“Volksgezindheid” et solidarisme
Pour faire éclore un môle de résistance en Flandre, il me paraît opportun de dire aujourd’hui qu’il devrait reposer sur deux piliers: la “volksgezindheid” (le populisme au sens défini par la tradition herdérienne ou par la tradition slavophile russe) et le solidarisme. La “volksgezindheid” est un sentiment plus profond que le “nationalisme” car il ne découle pas uniquement d’une option politique mais aussi et surtout d’un amour du passé et de la culture du peuple dont on ressort. Le terme “nationalisme”, de surcroît, recouvre des acceptions bien différentes selon les pays (14). L’utiliser peut semer la confusion, tandis que le terme “volksgezind”, lui, indique bien la teneur de notre propre tradition. Le solidarisme est un terme délibérément choisi pour remplacer celui de “socialisme”, désormais grevé de trop d’ambiguïtés ou assimilé à des déviances de tous ordres qui font que les socialistes officiels sont tout sauf socialistes. Le solidarisme devra exprimer dans l’avenir un socialisme sans atlantisme (à la Spaak ou à la Claes), un socialisme sans les “consolidations” à la Di Rupo (quand il s’agissait de privatiser la RTT pour qu’elle devienne “Belgacom”), un socialisme qui défende la solidarité de tous les producteurs directs de biens et de services contre les féodalités administratives et parasitaires. Un tel solidarisme découle aussi, pour ceux qui ont encore une culture classique, de la fameuse “fable de l’estomac” de la tradition romaine: “tous les organes de la communauté populaire servent les autres et construisent de concert l’harmonie”.
Une volonté de renouveau politique général basée sur la “volksgezindheid” et le solidarisme fera immédiatement se dresser devant elle des ennemis implacables. L’affirmation des valeurs populaires et solidaires implique automatiquement de désigner leurs ennemis, selon la formule de Carl Schmitt. Identifions-en trois aujourd’hui: 1) les médias formatés par le soft power américain; 2) l’idéologie néo-libérale, nouvel universalisme araseur des spécificités populaires et des politiques sociales, permettant le renouveau des élites (au sens où l’entendait Gaetano Mosca et Vilfedo Pareto); 3) l’idéologie festiviste qui noie les peuples dans l’impolitisme.
Le cas Verstrepen
“Volksgezindheid” et solidarisme impliquent de lutter contre tous les phénomènes culturels qui ne découlent pas naturellement d’une matrice populaire (la nôtre ou celle d’un autre peuple réel) mais nous sont imposés par le soft power internationaliste et cosmopolite. Un exemple: vous vous rappelez tous de ce journaliste branché, Jürgen Verstrepen, égaré, on ne sait trop pourquoi, dans le mouvement national flamand, où il s’était fait élire. Dans un entretien récent, accordé à l’hebdomadaire de variétés “Dag allemaal”, ce Verstrepen se plaignait du “passéisme” de ses co-listiers, qui chantaient des chants traditionnels, qu’il posait d’emblée comme “ringards” ou désuets, un “ringardisme” et une désuétude qui suscitait chez lui un avatar de ce même effroi ressenti par les dévots devant les oeuvres réelles ou supposées du Malin. Toute expression de la culture vernaculaire suscite donc en lui, à l’entendre, le dégoût du progressiste, pour qui rien d’antérieur aux panades médiatiques ou de différent d’elles n’a le droit d’exister. Et plutôt que d’aller se recueillir dans une belle abbaye bourguignonne, comme son parti le lui avait suggéré, il préférait flâner dans un “mall” pour se choisir des fringues branchés, des bouts de chiffon marqués d’un logo, en compagnie d’une autre députée-gadget, allergique aux racines. Inconsciemment, dans son entretien à “Dag allemaal”, Verstrepen révélait un état de choses bien contemporain: la lutte entre le vernaculaire matriciel, les racines et la culture traditionnelle, d’une part, et le médiatiquement branché, d’autre part. Reste une question: comment conciliait-il, ce Verstrepen, dans son cerveau soumis à l’homogénéisation postmoderniste, ce culte dévot du médiatiquement branché et son aspiration à lutter contre le “politiquement correct”? On ne peut aduler l’un et lutter contre l’autre: on ne peut, de notre point de vue, que les rejeter tous deux. On ne peut être atlanto-hollywoodien, succomber à la séduction du babacoolisme californocentré et se réclamer simultanément d’un “nationalisme” en lutte contre l’idéologie liberticide du “politiquement correct”. Verstrepen incarne bien l’incohérence de bon nombre de nos contemporains dans la Flandre d’aujourd’hui. Espérons que la crise va leur dessiller les mirettes. Car le soft power a promu le néo-libéralisme, cause de la crise, en même temps que les manipulations médiatiques, les modes (captatrices d’attentions) et le festivisme.
“Volksgezindheid” et solidarisme impliquent donc de lutter contre toutes les formes de néo-libéralisme que l’on nous a imposées depuis Thatcher et Reagan, depuis le début de la décennie 80. Nos admonestations, jusqu’ici, surtout celles, au début de notre aventure, de Georges Robert et Ange Sampieru, n’y ont rien changé. G. Robert et A. Sampieru étaient très attentifs aux productions des éditions “La Découverte” qui amorçaient déjà la critique du libéralisme outrancier qui pointait à l’horizon. Aujourd’hui, dans le monde occidental, l’américanosphère, l’espace euro-atlantique, dans la Commission européenne complètement inféodée à l’idéologie néo-libérale, la domination de cette idéologie est totale. Et la crise de ce début d’automne 2008 laisse entrevoir quelles en seront les conséquences catastrophiques, avec pour seule consolation que le système a appris à freiner les effets des crises et des récessions, à les délayer dans le temps. La crise prouve que la recette néo-libérale ne fonctionne pas: tout simplement. En attendant, les délocalisations perpétrées depuis près d’une trentaine d’années laissent l’Europe privée d’un tissu de petites et moyennes industries, pourvoyeuses de travail, et affligée d’un secteur tertiaire improductif qui n’offre que des emplois détachés du réel de la production et injecte dans les mentalités une idéologie délétère du “non-travail” (dénoncée très tôt par Guillaume Faye dans un texte que de Benoist avait refusé de publier). Cette idéologie du non-travail est aussi celle du festivisme: elle a servi d’édulcorant intellectuel pour justifier le processus de démantèlement de nos tissus industriels locaux, par le truchement des délocalisations vers l’Extrême-Orient, l’Afrique du Nord ou la Turquie (surtout le textile) et pour exalter le travail non productif du secteur tertiaire, devenu dangereusement inflationnaire.
Néo-libéralisme et altermondialisme
L’avènement du néo-libéralisme a été rendu possible par une bataille métapolitique. On se rappellera l’engouement pour Hayek, qu’on exhumait de l’oubli en même temps que les “think tanks” de Mme Thatcher dès la fin des années 70. On insistait principalement sur son pamphlet “The Road to Serfdom” et non pas tant sur les dimensions organiques (et parfois intéressantes) de sa théorie économique, axée sur la notion de “catallaxie” (laisser faire les choses naturellement sans interventions étatiques volontaristes). L’infiltration néo-libérale du discours dominant a surtout été le fait des “nouveaux philosophes”, dont nous venons d’expliciter le rôle, et de personnages ultra-médiatisés comme Jacques Attali, biographe de banquiers, et Alain Minc, propagateur principal de la nouvelle vulgate dans les gazettes conservatrices. Nul mieux que François Brune, collaborateur du “Monde Diplomatique”, n’a défini l’idéologie contemporaine, dans son ouvrage “De l’idéologie, aujourd’hui” (Ed. Parangon/L’Aventurine, Paris, 2003): “L’idéologie est omniprésente: dans les sophismes de l’image, le battage événémentiel des médias, les rhétoriques du politiquement correct, les clameurs de la marchandise. Machine à produire du consentement, elle démobilise le citoyen en le vouant à l’ardente obligation de consommer, de trouver son identité dans l’exhibition mimétique (ndlr: niet waar, Meneer Verstrepen?), sa liberté dans l’adhésion au marché, et son salut dans la ‘croissance’... C’est cela l’idéologie d’aujourd’hui: une vaste grille mentale, faussement consensuelle, qui prescrit à chacun de se taire dans son malheur conforme, et qui aveugle nos sociétés sur la catastrophe planétaire où ses modèles socio-économiques entraînent les autres peuples” (présentation de l’éditeur).
Le système, en lançant l’opération du néo-libéralisme dès la fin des années 70, devinait bien que cette idéologie finirait par rencontrer assez vite des résistances diverses. Deux objectifs allaient dès lors être les siens: 1) empêcher la fusion de ces résistances telles que l’avait préconisée le théoricien ex-communiste Roger Garaudy (soit empêcher les complots “rouges-bruns”, comme s’y sont employés le journal “Le Monde” de Plenel à Paris et certains cercles ou personnalités autour du PTB/PvdA en Belgique); 2) créer une résistance artificielle (l’altermondialisme), de manière à neutraliser toute résistance réelle. L’altermondialisme énonce un tas d’idées intéressantes et séduisantes. Mais il les énonce sans une assise politico-étatique et géographique précise, sans un ancrage tellurique, condition sine qua non pour lui conférer une épaisseur réelle. Tout empire, et tout challengeur d’empire, s’arc-boute sur un terrain: l’hegemon américain d’aujourd’hui ne fait pas exception. Il dispose d’un territoire aux dimensions continentales. Il pratique le protectionnisme et une bonne dose d’autarcie, tout en prêchant aux autres de ne pas adopter les mêmes attitudes et en les maintenant ainsi en état de faiblesse. Si l’hegemon développe un “réseau”, il le fait au départ d’une vaste base logistique, soit au départ de son propre territoire biocéanique, de l’Atlantique au Pacifique, et de son prolongement pacifico-arctique, l’Alaska. Pour créer l’illusion d’une résistance planétaire, les services de diversion ont forgé le concept de “réseau” (qui a séduit le “parigogot” de Benoist, l’homme qui cherche sans cesse le statut de vedette du jour, au détriment de toute rigueur de jugement).
Ce n’est pas le “réseau” qui est contestataire mais les vieilles strucutres étatiques et impériales
L’altermondialisme militant entend être le seul grand réseau contestataire de l’établissement mondial. Mais depuis les émeutes bien médiatisées de Gênes ou de Nice, on ne voit pas très bien quel ébranlement du système en place ce fameux “réseau” a pu produire. La thèse de Michael Hardt et Toni Negri sur l’“Empire”, dont les assises seront “un jour” définitivement sapées par le “réseau altermondialiste”, s’avère un leurre. Au temps de la Guerre Froide, les services américains avaient su faire émerger des “communistes de Washington” (pour reprendre l’expression de Jean Thiriart); il recycle désormais, en la personne de Toni Negri, d’anciens “terroristes” pour une opération de diversion d’envergure planétaire, qui absorbe et neutralise la contestation, en la médiatisant, en la transformant en un pur “spectacle” (Guy Debord), car nos contemporains, formatés comme les citoyens d’Océania, dans le “1984” d’Orwell, croient davantage aux images (télévisées) qu’aux faits (vécus), au spectacle qu’au réel. La résistance au système mondialiste américano-centré ne se retrouve pas, en réalité, dans un “réseau” planétaire de contestataires “babacoolisés” ou de nervis shootés à la cocaïne mais provient bien davantage de structures étatiques et impériales classiques, profondément ancrées dans le temps passé: Groupe de Shanghai avec une Chine aux traditions politiques millénaires, une Russie de Poutine qui retrouve sa mémoire, un indépendantisme ibéro-américain dans l’esprit du Mercosur et du président vénézuélien Chavez.
Combattre le festivisme
Enfin, après le “soft power” et le “néo-libéralisme”, le troisième aspect du système général d’ahurissement des masses et de déracinement, qu’il s’agit de combattre à outrance, est représenté par l’ambiance “festiviste”, celle que dénonçait avec force vigueur le philosophe français, récemment et prématurément décédé, Philippe Muray. Dans son tout dernier ouvrage, “Festivus festivus” (Fayard, 2006), Muray prononce un réquisitoire aussi virulent que tonifiant contre ce qu’il appelle le festivisme, mode de fonctionnement des sociétés occidentales avancées. Dans le long entretien, qu’est ce livre, avec la journaliste et philosophe vraiment non conformiste Elizabeth Lévy, Muray, dans son chant du cygne, fustige une société qui fonctionne uniquement sur le mode de la fiction médiatique, un mode qui vise la désinhibition totale, l’exhibition de tout ce qui auparavant était “privé”, “intime” et “secret” (dont évidemment les attributs et les pratiques sexuels). Le pouvoir, explique Muray, s’exercera avec une acuité maximale, quand les dernières enclaves du “secret” seront divulguées et exhibées, quand les dernières limites et les dernières distances (et les distances sociales font la civilisation, la promiscuité l’abolissant) auront été franchies et supprimées. La télévision avec ses émissions exhibantes (“Loft Story”, etc.) est l’instrument de ce pouvoir qui annonce la fête permanente et l’impudeur universelle, dans l’intention d’évacuer les îlots de “sériosité”, établie ou alternative, afin d’empêcher tout retour à un passé moins trivial ou toute préparation d’un futur cohérent. L’impudeur universelle brouille toutes les frontières et annonce un amalgame planétaire de promiscuité et d’indifférenciation, sous le signe de l’infantilisme “touche-pipi” et de l’ “adultophobie”.
Dans un ouvrage antérieur, intitulé “Désaccord parfait”, Muray qualifiait de “société disneylandisée” toute société “où les maîtres sont maîtres des attractions et les esclaves spectateurs ou acteurs de celles-ci”. Le “soft power” va donc imaginer et préfabriquer des “attractions”, pour tuer dans l’oeuf toute pensée libre, toute spontanéité créatrice ancrée dans le génie populaire, en substituant au créateur libre et spontané issu du peuple (celui de Rabelais et des carnavals contestataires) l’animateur officiel ou subsidié, et subsidié seulement après être passé sous les fourches caudines de l’idéologie imposée, après avoir appris son unique leçon qu’il répétera jusqu’à la consommation des siècles. Le “néo-libéralisme” va prospérer en marge de cette grande fête artificielle, forgée de toutes pièces, bien encadrée par de petits flics à gueule de bon apôtre, en dépit de son désordre apparent, qui étouffera d’emblée toute révolte vraie. Par l’action des anciens contestataires arrivés au pouvoir, le “mixtum compositum” de mai 68 se réduira ainsi progressivement à ses seules dimensions festives, libidineuses et ludiques, tirées, par les agents de l’OSS, du livre “Eros et civilisation” d’Herbert Marcuse voire des vulgates caricaturales issues du freudo-marxisme de Reich, dont ils fabriqueront un “prêt-à-penser” allant dans le sens de leurs desseins. Dans son meilleur ouvrage, désormais un classique, “L’Homme unidimensionnel”, Marcuse craignait l’avènement d’une humanité formatée, réduites à ses seuls besoins matériels; il avait raison; mais les règles de ce formatage, c’est lui, probablement à son corps défendant, qui les a fournies au système. On a formaté et on a trouvé l’édulcorant dans sa définition de l’ “éros”, que l’on a quelque peu sollicitée pour les besoins de la cause. Ce ne sont pas les rigidités du monde totalitaire du “1984” d’Orwell mais le “Brave New World” de Huxley, avec ses paradis artificiels, que l’on tente de nous infliger.
Mort du “zoon politikon” et mort des peuples
Les bourgmestres (ou “maires”) de Paris et de Berlin, Delanoë et Wowereit, ou l’échevin Simons de Bruxelles, tout le socialisme français actuel (surtout à la gauche de Ségolène Royale) ont pour objectif stratégique réel (et à peine occulté) d’occuper les “citoyens” à toutes sortes de festivités, de concerts, de happenings, de “gay prides”, de “zinneke parades”, de manifestations antiracistes ou autres, afin qu’ils ne s’occupent plus directement de politique, afin qu’ils oublient définitivement ce qu’ils sont, la trajectoire dont ils procèdent. L’objectif? Eradiquer l’essence de l’homme qui est, dit Aristote, un “zoon politikon”. Il s’agit de distraire à tout prix l’imaginaire humain de toute tradition ou réalité historique. En Occident, dans le complexe atlantiste franco-anglo-américain selon la définition qu’en donnait mon professeur Peymans fin des années 70, la domination des castes mercantiles ou du tiers-état bourgeois français, a percuté, abîmé et détruit les ressorts les plus intimes des peuples (Irlande exceptée), si bien que Moeller van den Bruck, le traducteur de Dostoïevski, pouvait affirmer que quelques décennies de “libéralisme” suffisaient pour détruire définitivement un peuple.
Le festivisme, mode par lequel s’exprime le despotisme contemporain, contribue à donner l’assaut final aux ressorts intimes des peuples: il en pénètre le noyau le plus profond et y sème la déliquescence. Philippe Muray, pour revenir à lui, réactualise de manière véritablement tonifiante la critique de la “société du spectacle”, énoncée dans les années 60 par Guy Debord et l’école situationniste, tout en jetant un éclairage neuf et très actuel sur le processus de dissolution à l’oeuvre dans la sphère occidentale.
Lega Nord et FPÖ
Pour articuler une résistance à l’échelle européenne, pour traduire dans les faits nos options philosophiques et nos aspirations historiques, deux partis identitaires peuvent nous servir de modèle: la Lega Nord d’Italie du Nord et la FPÖ autrichienne. Je ne vois pas grand chose d’autre. Pourquoi? Parce que ce sont les deux seuls mouvements identitaires de masse qui affichent ou ont affiché clairement des options “non-occidentistes”. La “Lega Nord” et son quotidien “La Padania” ont eu une attitude très courageuse en 1999, quand l’OTAN bombardait la Serbie. Le journal et le “Senatur” Umberto Bossi n’ont pas hésité à fustiger vertement les Américans et leurs complices bellicistes en Europe. Ensuite, à la base de cette ligue, il y a un manifeste, “Come cambiare?” (“Comment changer?”), dû à la plume du grand juriste Gianfranco Miglio. Ce manifeste dénonce les travers de la partitocratie italienne, qui est si semblable à la nôtre. Les leçons de Miglio peuvent donc être directement retenues par tout militant politique de chez nous. La clarté des arguments et des suggestions de Miglio, que j’ai eu l’honneur de rencontrer en 1995 dans sa magnifique bibliothèque privée à Côme, nous permettrait de développer rapidement l’esquisse d’un contre-pouvoir (cf.: “L’Italie toute chamboulée...”, Entretien avec Gianfranco Miglio, propos recueillis par Andreas K. Winterberger, in; “Vouloir”, n°109-113, octobre-décembre 1993; Alessandro Campi, “Au-delà de l’Etat, au-delà des partis: la théorie politique de Gianfranco Miglio”, in: “Vouloir”, n°109-113, oct.-déc. 1993; Luciano Pignatelli, “Les idées pratiques de Gianfranco Miglio: comment changer le système politique italien”, in: “Vouloir”, n°109-113, oct.-déc. 1993; “Quelques questions à Gianfranco Miglio”, propos recueillis par Francesco Bergomi, in: “Vouloir”, n°109-113, oct.-déc. 1993; Robert Steuckers, “La Ligue lombarde”, in: “Le Crapouillot”, nouvelle série, n°119, mai-juin 1994; “L’Etat moderne est dépassé!”, Entretien avec le Prof. Gianfranco Miglio, propos recueillis par Carlo Stagnaro, in: “Nouvelles de Synergies Européennes”, n°46, juin-juillet 2000; “Pour une Europe impériale et fédéraliste, appuyée sur ses peuples”, Entretien avec le Prof. Gianfranco Miglio, propos recueillis par Gianluca Savoini, in: “Nouvelles de Synergies Européennes”, n°48, octobre-décembre 2000).
Dans l’orbite de la FPÖ, l’hebdomadaire “zur Zeit”, dirigé par Andreas Mölzer à Vienne, recèle chaque semaine des pages d’actualité internationale sans concession aucune à l’américanisme ambiant. Jörg Haider est décédé ce matin dans un accident d’automobile mais, en dépit de sa rupture récente avec la FPÖ et de son option personnelle en faveur de l’adhésion turque, il demeurera pour moi l’auteur impassable du livre-manifeste “Die Freiheit, die ich meine” (= “La liberté comme je l’entends”). La partitocratie autrichienne présentait, avant les coups de butoir de la FPÖ, d’étonnantes analogies avec la nôtre. La critique générale du système politique autrichien, telle que Haider l’a formulée, est très technique comme celle de Miglio. Mais elle ne recourt à aucun langage abscons. Et suggère des pistes pour sortir de l’impasse politique. La clarté de ces manifestes a donné à la “Lega Nord” et à la FPÖ une formidable impulsion dans les débats publics et, partant, dans les batailles électorales (cf. Robert Steuckers, “Autriche: Haider, le Capitaine du pays”, in: “Le Crapouillot”, nouvelle série, n°119, mai-juin 1994; “Nous sommes en avance sur notre temps!”, Entretien avec Jörg Haider, propos recueillis par Andreas Mölzer, in: “Au fil de l’épée” recueil n°8, février 2000; “Rafraîchir la mémoire des coalisés anti-Haider!”, in: “Au fil de l’épée”, recueil n°8, février 2000; Mauro Bottarelli, “Haider contre Chirac: non à l’UE centraliste et parisienne – la bonne santé de l’économie autrichienne”, in: “Au fil de l’épée”, recueil n°12, août 2000 – article traduit du quotidien “La Padania”, 11 juillet 2000).
Les succès constants de ces partis, leur impact indéniable sur le débat politique et sur les réformes en cours prouvent que les deux manifestes, que j’évoque ici, recèlent bel et bien les bonnes recettes. Si elles valent pour l’Autriche et pour l’Italie, elles devraient valoir pour nous, vu que les systèmes politiques de ces deux pays et leurs dysfonctionnements sont similaires et comparables aux nôtres. Et, qui plus est, la vision géopolitique de ces deux formations est européiste et anti-atlantiste, éléments essentiels pour une critique solide et positive du système en place qu’aucun parti ou mouvement n’a repris chez nous, rendant du même coup caduque toute efficacité concrète.
Les hommes de gauche qui ont opéré les bon aggiornamenti...
Pour nous servir d’inspiration complémentaire, nous ajouterions le corpus établi par des personnalités de gauche, devenues non conformistes au fil du temps, comme la famille de Rudy Dutschke ou son compagnon Bernd Rabehl, qui s’expriment régulièrement dans l’hebdomadaire berlinois “Junge Freiheit”; ou comme Günther Rehak en Autriche, ancien secrétaire du Chancelier socialiste Bruno Kreiski; en Suisse romande, toujours dans l’arc alpin, le mouvement “Unité populaire” parvient à nous livrer chaque semaine sur l’internet des analyses ou des réflexions dignes d’intérêt pour tous ceux qui rêvent à l’avènement d’un solidarisme qui soit capable de dépasser les contradictions et les enlisements du socialisme établi. En Italie, le quotidien romain “Rinascita”, issu du nationalisme classique, se présente actuellement comme le journal de la “sinistra nazionale” et opte pour une perspective européiste et eurasiste, anti-impérialiste et anti-capitaliste. Nos sources d’inspiration ne doivent pas se limiter aux seuls mouvements qui se donnent, à tort ou à raison, les étiquettes de “national”, de “régionaliste” ou d’ “identitaire”. Des cénacles, anciennement ou nouvellement classés à gauche sur les échiquiers politiques en Europe, ont procédé avec intelligence aux bons aggiornamenti: ils ont refusé toutes les involutions en direction des pistes suggérées par la “nouvelle philosophie” et ses satellites et ont rejeté l’attitude de ceux qui, en dépit de leur vibrant militantisme d’il y a quelques décennies, demeurent, par paresse intellectuelle, des “compagnons de route” des partis sociaux-démocrates partout en Europe. La posture du “compagnon de route” est le plus sûr moyen de s’enliser, de faire du sur place, d’entrer dans la spirale infernale du déclin, un déclin engendré par le “mimétisme” qui ne produit plus aucune différence (ni “différAnce” pour faire un clin d’oeil à Derrida), mais reproduit sans cesse, sur un ton morne, le même et le même du même. C’est le plus sûr moyen de devenir les béni-oui-oui du système, ses chiens de Pavlov.
La création d’un espace stratégique euro-sibérien est inséparable d’un remaniement complet de nos institutions nationales, dans le sens de la “volksgezindheid” et du solidarisme, dans le sens de la critique anti-partitocratique de Miglio et Haider, afin d’immuniser totalement ces institutions contre les bacilles du soft power jacobin ou américain.
C’est tout ce que j’ai voulu vous dire cet après-midi.
Robert Steuckers,
Octobre 2008.
NOTES :
(1) William ENGDAHL, “Pétrole – une guerre d’un siècle – L’ordre mondial anglo-américain”, Ed. Jean-Cyrille Godefroy, Paris, 2007.
(2) La parution de cet article, dans une publication du “Parti Communautariste National-Européen” avait induit l’inénarrable comploteur parisien Alain de Benoist, via son zélé vicaire campinois, à exciter un brave citoyen allemand, membre de la “DESG” (= “Deutsch-Europäische Studiengemeinschaft”), une association basée à Hambourg qui s’apprêtait alors à fusionner avec “Synergies Européennes”, à tenter un ultime baroud (de déshonneur) pour torpiller cette fusion. L’homme, honnête, naïf et manipulé, a échoué dans ses manoeuvres. Il s’est dûment excusé quelques mois plus tard, à l’occasion d’un séminaire DESG/Synergies sur les relations germano-russes et euro-russes et sur la problématique de l’eurasisme, tenu à Lippoldsberg. Il avait enfin compris que l’instigateur de cette bouffonerie était un comploteur pathologique et que son vicaire n’était qu’un pauvre bas-de-plafond. Forcément: pour servir un tel maître...
(3) Cf. L. SIMMONS, “Van Duinkerke tot Königsberg – Geschiedenis van de Aldietsche Beweging”, Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen,1980. Voir également: Alan SPANJAERS, “Constant Hansen”, in: “Branding”, n°2/2008.
(4) Dexter PERKINS, “Storia della dottrina di Monroe”, Il Mulino, Bologna, 1960.
(5) Alain GOUTTMAN, “La Guerre de Crimée 1853-1856, la première guerre moderne”, Perrin, 1995; vor également : “The Collins Atlas of Military History”, Collins, London, 2004.
(6) Jacques HEERS, “Les Barbaresques - La course et la guerre en Méditerranée – XIV°-XVI° siècle”, Perrin, Paris, 2001-2008.
(7) Robert STEUCKERS, “Constantin Frantz”, in: “Encyclopédie des Oeuvres philosophiques”, PUF, 1992.
(8) Richard MOELLER, “Russland – Wesen und Werden”, Goldmann, Leipzig, 1941.
(9) L’ouvrage le plus complet pour aborder cette thématique si complexe est le suivant: Gerd KOENEN, “Der Russland-Komplex – Die Deutschen und der Osten 1900-1945”, C. H. Beck, Munich, 2005.
(10) Günther HASENKAMP, “Gedächtnis und Leben in der Prosa Valentin Rasputins”, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1990.
(11) Wolfgang STRAUSS, “Die Neo-Slawophilen – Russlands konservative Revolution”, in: “Criticon”, Munich, n°44, 1977. Cf. Robert STEUCKERS, “Wolfgang Strauss: les néo-slavophiles ou la révolution conservatrice dans la Russie d’aujourd’hui”, in “Pour une renaissance européenne”, Bruxelles, n°21, 1978.
(12) Alexander YANOV, “The Russian New Right – Right-Wing Ideologies in the Contemporary USSR”, Institute of International Studies, University of California, Berkley, 1978.
(13) Cf. Robert STEUCKERS, “Adieu au Général-Major Jochen Löser”, in: “Nouvelles de Synergies Européennes”, n°50, mars-avril 2001. Cf. également: Detlev KÜHN, “En souvenir d’un soldat politique de la Bundeswehr: le Général-Major Hans-Joachim Löser”, ibidem. Ces deux textes figurent sur: http://euro-synergies.hautetfort.com .
(14) Cf. nos deux études sur le nationalisme: Robert STEUCKERS, “Pour une typologie opératoire des nationalismes”, in: “Vouloir”, n°73/74/75, printemps 1991; Robert STEUCKERS, “Pour une nouvelle définition du nationalisme”, in: “Nouvelles de Synergies Européennes”, n°32, janvier-février 1998 (texte d’une conférence prononcée à Bruxelles le 16 avril 1997). On peut lire ces deux textes sur: http://euro-synergies.hautetfort.com.
14:21 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, europe, russie, histoire, géopolitique, politique internationale, nouvelle droite, synergies européennes, réflexions personnelles, politique, philosophie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 31 août 2009
Du pouvoir parisien et de sa dérive gauche
Du pouvoir parisien et de sa dérive gauche
À partir des années 1970, le modèle réussi du Sunday Times a incité de nombreux quotidiens européens à faire semblant de copier sa formule. Ils ont créé des suppléments hebdomadaires d'un bonheur inégal. Vendus par une formule de carte forcée, alourdissant le prix du titre et augmentant artificiellement le chiffre d'affaires des entreprises de presse, ils n'ont que bien rarement développé l'audience de leurs supports de références.
On les lit en effet de manière généralement aléatoire. Ils traînent dans les salles d'attente, au gré des salons de coiffure, au hasard des banquettes arrière. Parfois un titre aguichant dissuade de les jeter définitivement. Ainsi le dernier supplément de "La Repubblica" (1) était-il intitulé "Souvenir d'Italie". On ne pouvait se résoudre à ne pas le feuilleter.
Or, une fois tournées les pages consacrées aux "trésors gastronomiques" de la Péninsule, une petite truffe attirait l'attention. On tombait en effet en pages 40 à 44 sur un amusant article consacré à la France. L'auteur, Marco Cicala, y décrit, et cherche à expliquer au public transalpin, ce qu'il appelle la "dérive gauche" du pouvoir présidentiel parisien. Le jeu de mot, imprimé dans notre langue car intraduisible dans celle de Dante Alighieri, ainsi que les nombreuses formules "en français dans le texte", nous console de la disparition ordinaire et non moins désolante de l'intérêt de la Botte pour l'Hexagone. Le texte lui-même, ramène presque ainsi la politique de notre pays au rang de la comédie de boulevard, c'est-à-dire très au-dessous de cette comedia dell'arte du XVIe siècle dont dérivera le théâtre français.
L'explication donnée fait certes sourire : "cherchez la femme".
Mais précisément de quoi s'agit-il ? En médaillon, sous le titre "ont-ils été choisis par elle ?" on aperçoit quelques personnages :
- Frédéric Mitterrand "nommé ministre de la Culture, il a dit : Sarkozy m'a connu grâce à Carla".
- Philippe Val "Suspecte également la nomination du gauchiste Val à la tête de la radio d'État France Inter".
- Maurice Karmitz "ex-maoïste dirige le Conseil pour la Création artistique, toujours, dit-on à Paris, par la grâce de Carla".
- Cesare Battisti "à l'affaire de l'ex terroriste tient beaucoup Valeria, la sœur de Carla, qui cependant nie toute ingérence". [Rappelons ici que la protection accordée à ce personnage scandalise nos voisins et amis].
Voilà qui trouble, à première lecture. Mais peut-on vraiment en déduire, pour citer La Repubblica que "ce couple étrange, elle 42 ans, lui 54 ans, qui se sont mariés à l'Élysée le 2 février 2008", gouvernerait désormais dans un sens contraire à celui promis aux électeurs en 2007, simplement parce que Carla Bruni serait "épidermiquement de gauche" [ces guillemets correspondent en français aux citations du journal].
Ceci nous semble bien superficiel, et presque optimiste. L'avis sollicité de Laurent Joffrin directeur de Libération, qui ne passe pourtant pas pour une lumière, se révèle ici plus mesuré : "Carla Bruni ne conditionne pas les choix politiques de son mari, mais elle l'a transformé mentalement".
Malheureusement d'autres influences, moins gracieuses, orientent dans un sens plus socialiste la politique étatique subie par la France. Certes un Philippe Val réussira peut-être à faire la radio d'État France Inter encore plus basse, encore plus cégétiste et encore plus démago. On apprécie l'exploit à l'avance. M. Jacques Attali, auteur du programme de 300 réformes, ou M. Henri Guaino, inspirateur des discours économiques, n'ont pas attendu le remariage du chef de l'État pour exercer leur nuisance. L'ouverture à gauche, la réconciliation avec ce que représente M. Bernard Tapie, le recrutement de quelques transfuges impénitents du parti socialiste encore moins. Le pouvoir actuel représente une sociale démocratie moins délirante que celle de Mme Royal, et moins acoquinée avec les rogatons du communisme que Mme Aubry. Vaguement tenu par deux ou trois promesses, il a paru clairement, et raisonnablement, "moins pire" en 2007, à 53 % des électeurs et le semble encore. Mais il ne représente ni la droite, ni la liberté, ni l'identité de la France, et certainement pas la fin du fiscalisme.
La question : "faut-il regretter Cécilia ?" n'intéresse que les lecteurs de Gala. La personnalité de l'épouse du président, fût-elle réputée proche de la gauche caviar, ne devrait pas voiler la réalité aux compatriotes de Gramsci. Le pouvoir culturel en France appartient à un secteur de l'opinion coupé du peuple, et cela ne date pas de février 2008.
Arlequin n'a pas attendu Colombine pour maintenir à 54 % de la richesse nationale le niveau de la dépense publique.
Apostilles
- "Il Venerdi di Repubblica" numéro 1116 du 7 août 2009
JG Malliarakis
00:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, paris, france, politique française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 juillet 2009
Le Waldgänger et le militant
Le Waldgänger et le militant
par Claude Bourrinet - http://www.europemaxima.com/
« Fabrice eut beaucoup de peine à se délivrer de la cohue ; cette scène rappela son imagination sur la terre. Je n’ai que ce que je mérite, se dit-il, je me suis frotté à la canaille. »
Stendhal, La Chartreuse de Parme.
Qui s’avisera de lire la dernière fable de La Fontaine, son mot dernier avant la mort, connaîtra peut-être l’ultime message d’un sage épicurien en matière d’engagement : l’amateur de jardin ne place pas plus haut l’urgence sacrée de la contemplation, et tout ce qui en peut brouiller l’onde transparente est davantage qu’une faute philosophique : c’est un crime vis-à-vis de l’âme. La vertu de cet ultime apologue est de présenter, dans leur radical altruisme, les deux figures du militant qu’une civilisation ayant pour paradigmes l’apôtre et le citoyen a léguée à l’Europe. On ne fait pas plus concis. L’une, animée du zèle le plus politique, érige la justice en exercice de vertu. L’autre, poussée par une charité admirable, soigne avec abnégation son prochain. Les deux récoltent incompréhension, ingratitude et vindicte. L’hôte des bois, seul, dans son ermitage, sauve quelque chose du grand naufrage humain.
Néanmoins, il n’est pas certain que l’épilogue de ce grand livre du monde que sont les Fables fût si péremptoire dans la condamnation d’un travers dont on sentait, en cette fin de grand siècle, les prémisses. Mainte saynète offre en effet matière, sinon à l’espoir, du moins à un certain plaisir de vivre, voire à un bonheur certain. Si La Fontaine verse quelque peu dans le jansénisme avec les affres de l’âge, il reste pour l’éternité un épicurien sensible aux sollicitations positivement ordonnée d’un Monde qui n’est pas si désagréable que cela, nonobstant sa cruauté.
En ce temps-là, peu avaient oublié Montaigne, le maître de tous, celui qui inspirait ou repoussait, parfois les deux à la fois, sans qui il ne fût ni Charon, ni Pascal, ni La Fontaine, ni beaucoup d’autres. Le châtelain périgourdin avait eu l’occasion de côtoyer La Boétie, qui promettait, ne fût-ce la mort, de donner à la France une plume et un grand cerveau, sinon un grand cœur. Montaigne conçut ses Essais comme un écrin pour l’ouvrage de son ami, lequel est tout un programme, puisqu’il s’intitule De la servitude volontaire. Les Temps étaient pourtant à la rébellion (mais l’une n’empêche pas l’autre), Parpaillots, Ligueurs s’empoignaient, avec l’aide fraternelle des ennemis de la France, pour s’entrégorger pour la plus grande gloire de leur Dieu. Cet âge de fer vit naître, peut-être, le militant moderne. On se mit à concevoir des programmes politiques destinés à changer le régime monarchique, la religion se transmuta en idéologie, et les Églises devinrent des partis. L’État n’était plus le médiateur naturel du Dieu transcendant et du peuple chrétien : il était devenu un instrument autonome, susceptible de transformations, malléable, améliorable, dont on pouvait s’emparer, et qui possédait sa propre Raison. Ainsi, avec le militant, naquit la politique.
On connaît la position de Montaigne là-dessus. Le maire de Bordeaux et le grand commis qui s’entremit entre Henri III et Henri de Navarre, si son loyalisme le plaça dans les régiments royaux, où il fit avec un certain plaisir guerrier le coup de feu, se garda de s’offrir pleinement à la flamme du combat, où il eût à se brûler l’âme, le cœur, ou, quelque fût son nom, ce qui lui assurait de toutes les façons, devant le monde et devant lui-même, la pérennité de son être. Il s’en faut bien de se prêter pour ne pas se perdre. Tel était l’honnête homme, qui, moulé par un livre consubstantiel à sa recherche, invitait à exercer par le monde des hommes et face à la nécessité une indifférence active, qui n’est pas sans prévenir la nonchalance dévote de François de Sales. C’est bien là, chez Montaigne, qui n’évoqua jamais Jésus dans ses écrits, une sorte de synthèse improbable entre le stoïcisme et l’épicurisme. Aussi bien invoqua-t-il volontiers les figures emblématiques de Socrate, d’Alcibiade, de César, d’Alexandre, pour illustrer cette virilité négligente et attentive, cette implication dans les combats de la terre, et cette plasticité de l’âme et du corps, qui saisit le sel de la vie au moment du plus grand danger, comme si ce fût une promenade parmi les prairies élyséennes.
Nous sommes loin du culte chevaleresque et du moine-soldat. L’on n’y perçoit nullement la droite rectitude des héritiers de Zoroastre, des lutteurs manichéens et des croisés juchés sur leurs étriers afin de pourfendre le Mal et vider la cité des hommes des ennemis de la cité de Dieu.
Il faudrait donc repenser le problème et du militantisme et de l’engagement, en ayant conscience des conditionnement culturels et historiques qui en dessinent l’image. Bien évidemment, tout questionnement surgit en son point historial où la réponse est toujours contenue dans la manière d’interroger le destin. Les implicites sont bien plus redoutables que les apparences conceptuelles et rhétoriques les plus sensibles. La pensée, lorsqu’elle se fait servante de l’action, est freinée dans ses élans et ses capacités à creuser jusqu’aux racines. Elle exige un retrait.
L’interrogation première devra porter sur cette inhibition quasi universelle à mettre à la question les plus évidentes légitimités, incertaines dans la mesure de leur évidence. À n’en pas douter, l’engagement pour une cause est une nourriture pour l’existence, même passagère, dont il est bien difficile de se passer comme viatique. Il ne s’agit parfois que de trouver la chapelle sur le marché des causes. Les situationnistes, bien après Nietzsche, rejetaient cette forme de confort qui, même lorsqu’il impliquait la mort et la souffrance, le sacrifice et l’opprobre, semblait octroyer au croyant l’assurance d’un salut, au regard de Dieu, des hommes, ou de soi-même, en tout cas un rôle, dont la véritable et profonde raison réside dans l’irraison de pulsions inavouées ou d’un narcissisme, d’un amour-propre, pour user de la terminologie du Grand Siècle, qui confère à tout discours assertif, et même performatif lorsqu’il s’agit d’agir, cette dose plus ou moins volumineuse de soupçon, de défiance, qui ne demande qu’à envahir l’esprit et le cœur, et justifier toutes les désertions, les abandons et le ressentiment.
Mais il est vrai que le nomadisme militant et la haine des anciens emballements sont des traits caractéristiques de la conscience contemporaine, comme si la maladie sectatrice dénoncée chez les réformés par Bossuet se trouvait soudain envahir le champ politique, une fois les Grands Récits idéologiques chus dans la poussière de l’Histoire.
Il est permis de se demander si un tel type de conscience se manifestait dans l’Antiquité non chrétienne. Il ne semble pas qu’il y eût, avant l’universalisation de la Weltanschauung galiléenne, ce dépassement, cet outre-passement qui caractérise le lutteur convaincu de sa bonne foi et désireux de convertir autrui, avec cette obsession clinique de la trahison, des autres et de soi-même. On pourrait certes excepter de la communauté philosophique grecque, très bigarrée, les disciples d’Antisthène, ces cyniques, qui privilégiaient la physis au Nomos, et convoquaient la parrhèsia, la franchise qui invite à tout dire, pour lancer des invectives à l’égard des pouvoirs en place, ce qui leur valut maints déboires sous l’Empire, sous lequel leur mouvement avait pris une tournure populaire. Julien n’hésitait pas à mêler dans le même mépris cette Cynicorum turba, munie du tribôn et de la besace, et les « Galiléens incultes », auxquels ils ressemblaient beaucoup. Les autres philosophes se contentaient d’une saine abstention, ou, de façon plus risquée, de jouer les conseillers des Princes.
Pour le reste, les Anciens se battaient pour défendre les dieux du foyer, de la cité, de la communauté, ils n’avaient en vue que les intérêts de cette dernière, et si la pensée plus ample d’un ordonnancement impérial leur vint à l’esprit, à la suite des Perses et des Égyptiens, ce fut comme la donnée d’un état de fait, comme le fruit d’un arbre immense à l’ombre duquel devaient s’ébattre, dans leurs particularismes, les peuples variés constituant l’humanité. Nulle part, à nul moment, le Grec et le Romain n’apparaissent comme des sectateurs d’une religion impérieuse. À l’intérieur de la Cité s’affrontaient des factions, les potentes, les humiliores, populo grasso et populo minuto de toujours. Mais il s’agissait de combat politique, d’organisation de l’État, un État organique, lié par mille liens au tissu sociétal, et qui s’incarnait particulièrement dans des hommes, qui étaient des orateurs et des soldats. On recrutait des clientèles, on se faisait des armées privées. Ces solidarités verticales dureraient autant que l’ancien monde, jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle, où les puissants, dans une sorte de protection déclinée jusqu’au bas de l’échelle sociale, unissaient les membres de la société, pour parfois les mobiliser contre un État de plus en plus froid et autonome.
Il s’avère néanmoins qu’apparaissaient dans les temps antiques des revendications souvent rapportées par les marxistes dans leur désir d’asseoir leur usurpation sur les traces du passé. Par exemple, dans les pages consacrées à Tibérius et Caius Gracchus, Plutarque reproduit un discours censé avoir été prononcé par Tibérius : « Les bêtes, disait-il, qui paissent en Italie ont une tanière, et il y a pour chacune d’elle un gîte et un asile ; mais ceux qui combattent et meurent pour l’Italie n’ont que leur part d’air et de lumière, pas autre chose. Sans domicile, sans résidence fixe, ils errent partout avec leurs enfants et leurs femmes, etc. » Comment éviter l’émergence de l’espoir quand il faut trouver du pain ? Les fils de Cornélie étaient assez grands pour se vouer au parti populaire et en perdre la vie. Leur stoïcisme les élevait à la conception d’un cosmos garant du Nomos de la Cité, et le caractère subversif de leur combat n’était qu’une tentative de restitutio de l’Urbs, des Temps anciens où le Romain était paysan et libre. On sent dans cette lutte héroïque cet élan de justice qui sert de modèle pour l’éternité aux révoltés de tous temps. Cependant, les Gracques sont d’ici-bas, de la portion sublunaire de l’univers, commune aux choses périssables et imparfaites, et l’édifice qu’ils convoitent, qui participe de la bonne vie en quoi Aristote voit le télos de l’action politique, n’est pas une cathédrale pointée vers le ciel. Leur silhouette ne ressemble pas à celles des saints peints par Gréco, longilignes, tendus presque à rompre vers un point du Ciel ouvrant des vertiges angoissés. Les Gracques ont combattu pour remplir le devoir de leur gens, de leur lignée, celle qui leur enjoignait de défendre le peuple, d’en être le protecteur. Logiquement, César reprendra le flambeau, et assurera les fondements d’un État plus apte à unir les membres de l’Empire.
Depuis la Renaissance, il est d’usage d’invoquer l’exemple de la geste politique antique pour inspirer l’action. Mais la filiation est rompue, la parenté apparente de la politique contemporaine avec celle de l’antiquité est illusoire.
La frontière, on le sent bien, tient à peu de choses, mais séparent deux contrées entièrement différentes. Augustin savait parfaitement que Cité terrestre et cité de Dieu étaient intimement mêlées, et qu’il n’était pas si loisible de les identifier au sein d’une vie qui se nourrit de tout ce qu’elle trouve pour se justifier. Tant que la notion de Res publica subsista, et quand elle revint dans la conscience des hommes, les luttes politiques manifestèrent la propension des clans, des ordres, des classes, des partis, à se projeter dans l’avenir pour établir ce que d’aucuns considéraient comme l’ordre légitime des choses. Chacun au demeurant, même dans les siècles « obscurs » où, selon toutes les apparences, le christianisme appuyait son empreinte, ne remettait en cause l’ordre naturel qui s’appuyait sur l’inégalité, la hiérarchie, l’occupation justifiée de places prédestinées qu’il ne s’agissait seulement que de consolider ou d’élargir. Les potentialités subversives du christianisme, un christianisme au fond vulgaire, comme il y eut un marxisme qu’on appela tel, n’apparaissaient pas, parce qu’on scindait nettement le bas et le haut de la Création, et que les fins de la Justice divines, parfois impénétrables, étaient reportées à plus tard, si possible après la mort, ou à la fin des Temps.
Le militant se trouvait donc chez les orants, les moines. Les évêques, avant le Concile de Trente, ressemblent plus à des Princes qu’à des Bergers soucieux de l’éducation de leur troupeau. L’engagement du croyant, hormis lors de ces brusques flambées que furent les Croisades, qui n’étaient pas si fréquentes, au fond, mis à part l’Espagne de la Reconquista (période où se développe la figure du militant, telle qu’elle se réalisa plus tard dans la vocation de l’hidalgo Ignace de Loyola), était de bien tenir son rôle dans l’économie divine. Cette idée subsiste chez Calderon, dans sa pièce El Gràn teatro del mundo, par exemple, où pauvre, riche, seigneur etc. ont leur rôle dévolu de toute éternité.
Le gouffre ouvert à partir de la révolution nominaliste, qui affirme que les universaux sont des signes, et non des substances, donne au discours, même déraciné, toute sa faculté d’expression et d’universalisation. Si la réalité est singulière, les universaux ne sont pas moins existants, quoique séparés, et relèvent de l’ordre logique, ce que le conceptualisme va étayer, en posant une morale autonome, indépendante de l’ordre naturel. La voie est donc ouverte pour l’élaboration d’une liberté civique spécifiquement humaine, constructiviste, dont les attendus et les conséquences ne dépendent plus d’une transcendance ou d’une immanence cosmique, ou même théologique.
La tension néanmoins prégnante dans l’anthropologie humaniste et baroque, qui sourd parfois de minorités marquées par la structuration mentale lentement instaurée par des siècles de christianisme, tension qui se manifeste spectaculairement dans l’éruption de mouvements millénaristes, comme les mouvements paysans allemands, comme celui des anabaptistes, ou ceux des niveleurs anglais, et même chez les jansénistes qui, bien que fondamentalement dans l’incapacité de proposer un programme politique, comme l’avaient fait les Réformés, ont durablement marqué de leur empreinte militante le paysage politique de la France des XVIIe et XVIIIe siècle, et bien plus tard, n’a pas été contrarié par l’adoption, au sein des grands commis de l’État, des principes machiavéliens de la Raison d’État, selon lesquels la fin justifie les moyens.
L’ironie voudra que ce soit l’être le plus hostile à l’ancien monde, Lénine, le fondateur du parti bolchevik, qui synthétise ces traditions pour unir l’enrégimentement jésuitique et le prophétisme apocalyptique. La puissance d’un programme comme celui contenu dans Que faire ? ne peut s’apprécier que si l’on y distingue la jonction électrique entre le formidable effondrement des valeurs provoqué par l’avènement de l’ère moderne et l’exacerbation d’un vieux fonds mystique, particulièrement présent en Russie orthodoxe, un peu moins dans l’Europe occidentale agnostique.
On découvrit il y a quelques décennies, au moment où mouraient ce que l’on nomma les « Grands Récits » que l’entrée en militantisme possédait de nombreux points communs avec la conversion, l’entrée en religion. Mais on ne put le dire que parce qu’on en était sorti, et que dorénavant on pouvait s’en moquer, comme du pape et des curés de village. Le militantisme de masse devint aussi étrangement suranné que les voix nasillardes de la T.S.F. et les chapeaux mous. Les sociologues et les ethnologues s’en donnèrent à cœur joie. On perdit même l’habitude de coller des affiches sur les murs. Et la production de « Grands Récits » fut remplacée par les stories selling, les compagnons de route par des publicistes girouettes, et les électeurs par des consommateurs d’offres politiques. Dans le même temps, les rivalités générées par la Guerre froide, qui avaient donné l’illusion qu’un choix était possible, devenaient des options de gouvernance.
La vérité se présente-t-elle sous une clarté solaire, nous continuons comme avec nos jeux d’ombres. Le désert a gagné tous les aspects de la vie et de la pensée, et Internet, ironiquement, n’a fait que l’universaliser. Les happy few qui communiaient jadis dans une cercle restreint, parisien, se relisant sans cesse et se prenant de la gueule, ne connaissaient pas autant ce sentiment de vide, cette inutile clameur, que nous, qui sommes dotés de tous les moyens d’expression et de diffusion. Les noms deviennent abstraits, et les paroles, comme les feuilles dans le vent, retombent où elles peuvent. Les idées restent idéelles, peut-être idéales, et ne sont guère suivies d’effets. Le pire, pour un homme qui se respecte, est l’illusion, vertu ô combien plébéienne !
Finalement, la solitude est la vraie condition de l’homme moderne, et il faut une force surhumaine pour réussir à rester homme. Il est plus difficile de trouver un homme véritable maintenant, que du temps de Diogène. Toute communication étant devenue impossible, qu’il n’existe qu’un impératif pour celui qui veut sauver quelque chose du désastre : écrire un texte, le glisser dans une bouteille balancée à la mer immense de l’absurde, et disparaître.
Au demeurant, il faut une perspicacité hors du commun pour saisir du premier coup d’œil, qui vaut un instinct, la vérité d’un système, surtout quand on est plongé dans les conditions horribles qui étaient celles d’Alexandre Zinoviev, lorsqu’il avait dix-sept ans sous Staline. Du moment où la vue prend un peu de hauteur, qui n’est certes pas celle de Sirius, la question de savoir ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire se pose autrement que lorsque elle reçoit l’écume des événements, à la manière des journaux.
Dans le premier chapitre du Voyage au bout de la nuit, Céline nous plonge dans une conversation de café du commerce. Bardamu et Ganate, anticipant les anti-héros beckettiens, parlent de tout, et changent d’avis en un temps record. La critique célinienne va loin. Car ce qui est dénoncé, dans le Voyage…, ce n’est pas seulement la guerre, la colonisation, l’Amérique et la misère. Ce serait déjà beaucoup, mais dès les premières lignes, on saisit l’angle par lequel il faut aborder le monde contemporain, celui qui, faisant appel aux masses, est responsable de dizaines de millions de mort et de l’assassinat d’une civilisation comme on en a rarement vu dans l’Histoire. Ce n’est pas un hasard que Le Temps, le quotidien à succès de la belle époque, vienne à nourrir la conversation. Comme écrit Camus dans La Chute, un autre livre sans concession lui aussi, « Une phrase leur [les historiens futurs] suffira pour l’homme moderne : il forniquait et lisait des journaux. ». Une remarque de Ganate nous met au fait, comme pour nous offrir une clé : « … Grands changements ! qu’ils racontent. Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés !... » En plus de Schopenhauer, il y a de L’Écclésiaste et du Pascal chez Céline. Autant dire que c’est un moraliste de notre Temps de détresse, comme Cioran. Avec seulement de plaisir que le style.
Venons-en justement, au style. Car il faut bien l’avouer, la dose d’optimisme pour faire d’un homme un militant est à peu de chose près la même que pour en faire un imbécile. L’aristocrate, comme le guerrier, sait bien lui, que le cœur de ce phénomène somme toute étrange qu’est l’existence est de savoir mourir élégamment. Tout le reste est du commerce et de la réclame.
Comment prendre néanmoins les situations les plus désagréables ou les plus insupportables ? Les cas extrêmes ne semblent pas offrir beaucoup le choix. Ce même Zinoviev, dont l’autobiographie est un bréviaire pour tout dissident, sauva sa vie plusieurs fois par des gestes dont le génie venait de leur folie même. Ainsi, au sortir de la Loubianka, escorté par deux hommes du N.K.V.D., leur faussa-t-il compagnie de la manière la plus improbable, les sbires ayant oublié quelque chose et l’ayant laissé provisoirement sur place, dans la rue, ne pensant pas qu’il eût l’audace de partir. Ce qu’il fit, sans le sou, sans rien, pour suivre un destin picaresque. Et tragique.
Alexandre Zinoviev, paradoxalement, ne ménageait pas sa peine lorsqu’il s’engageait dans une activité. Il fut bon travailleur, bon soldat, héroïque même. Comme Jünger fut un bon guerrier. Ce qui distingue le rebelle véritable est sa pensée de derrière. Pascal en était un. Le non que l’on porte au fond de soi est peut-être plus efficace que toute agit-prop. Ne fût-on qu’un seul à dire non, la machine est déjà grippée. L’absence d’assentiment, la passivité, la désertion morale sont bien plus dangereux pour le totalitarisme, dur ou mou, que l’attaque frontale, qui ne fait souvent qu’alimenter la propagande en retour et conforter la police. À la longue, ce travail de sape, la multiplication des refus intimes, parfois prudemment partagés avec des happy few, travaille le sol qui soutient l’édifice. Car tout totalitarisme ne vise pas que les corps : il ne peut subsister si ses membres n’adhèrent pleinement à ses rêves, qui ne sauraient être que désirables.
La logique du monde étant régie, depuis des millénaires, par une destruction de plus en plus accélérée de la Tradition, le chaos est le point terminus de son évolution, ce qui peut offrir des perspectives sportives permettant aux âmes guerrières d’exceller.
Le monde contemporain, « post-moderne », est un univers hyper-sophistiqué, emmaillé d’un réseau électronique de surveillance, enfliqué et empuanti de délateurs, géométrisé, arithmétisé, balisé, lobotomisé, enfarci de lipides télévisés engluant les neurones encalminés, robotisé par un dressage pavlovien, qui produit sa bave en guise d’huile de vidange, une société où les flics ont désormais des silhouettes de scaphandres intersidéraux, spectres humanoïdes au regard vide, comme ces caméras qui nous épient cent fois en une heure ; nos gènes sont pesés, enregistrés, archivés, nos désirs sont gérés et marchandisés, nos rêves domestiqués, la trace des colliers irrite de sa sanglante et empestée blessure nos cous, nos poignées, nos sursauts, nos paroles sont empaquetées, lessivées, ensucrées, aseptisées, notre fatigue auscultée, hospitalisée, pharmacataloguée, notre mémoire est enrégimentée, encasernée, emmaillotée dans un drapeau qu’on nous a mis sur le dos, comme ça, quand on avait les yeux braqués sur le présent. Parce que l’homme post-moderne, il ne songe qu’à la baffre, aux délectables digestions d’après-orgies, à coups de bourrages tripaux et crâneux, avec de gros entonnoirs bien vissés qui lui traversent la carcasse jusqu’au croupion pour qu’il déverse son caca bien conforme, soupesé par les pinces régulées de scolopendres aux sourires frigides.
Mais par-delà les barreaux de la cage peinturlurée de couleurs vulgaires, se hument les sous-bois fauves et frais de la forêt splendide, aux sentiers rayés des flèches du soleil, aux buissons sombres des mystères ancestraux, aux butes arides tapissées de feuilles bruissantes, aux odeurs fortes et enivrantes de l’humus, qui est le parfum préféré des loups furtifs et libres. Ils n’ont de rêves que l’étreinte serrée des écorces et des taillis teignant leur pelage âcre des couleurs du combat. La horde suit son chef au fond de la nuit, et la lune, comme l’écho de leurs songes, fait étinceler les crocs acérés. Tapie à l’orée de sa cité sauvage, elle épie de ses yeux étincelants comme des étoiles les spectacles méprisables de la ville grasse et torve, écroulée sous sa masse abrutie.
Cependant ce recours physique aux forêt est bien rare, et ses plaisirs peu à même de se renouveler à mesure que le monde devient plus civilisé, plus féminisé, plus consensuel.
Au demeurant, ceux qui invoquent le peuple devraient réfléchir. Qu’aurait-on à lui proposer, sinon de juguler ses désirs et sa vanité ? Sa place est nécessairement inférieure aux prêtres et aux guerriers. Si révolution il doit y avoir, elle sera autant pour le peuple, dans la mesure où l’humilité est pour lui, avec la protection des puissants, un gage de bonheur, et contre le peuple, parce que le monde moderne est tout autant son produit, celui de l’intérêt, du matérialisme et du dénigrement du sacré.
Le recours aux forêts mentales offre plus de richesse, à mon sens. L’univers n’a pas si sombré dans l’Âge de Kali qu’il ne subsistât, à qui sait les saisir, d’antiques fragments de la Cité perdue. Ils sont à la mesure de chacun, et répondent à qui peut les percevoir. Des expériences dionysiaques et apolloniennes intenses sont à portée, à condition d’en extraire, comme un élixir, la quintessence.
Ainsi partira-t-on de ce postulat, que l’espoir est affaire de Thersite, que l’aristocrate, ou tout simplement celui qui ressent la nostalgie d’un ancien sens du monde, sait que le Temps n’existe pas, qu’il est vain d’ « améliorer les choses », de les « faire bouger », comme l’on dit, ce qui d’ailleurs a toute chance de les faire empirer ; qu’une fois perdu, le monde clos, hiérarchisé, naturellement enté dans l’ordre cosmique, n’a guère de chance de revenir au jour, à moins que la roue ne retourne à l’origine, ce qui ne peut se produire qu’après un cataclysme intégral. Au fond, le meilleur service qu’on puisse faire au monde est d’accélérer sa décomposition, afin de hâter la vitesse de la roue.
La vie est un naufrage. Je veux parler de celle qui échappe à la lumière d’Apollon, et qui est fort commune. Il est bien connu que la vraie est ailleurs, et que je est un autre. Il est évident que la recherche du bonheur est une stupidité, à laisser à la plèbe. Nous avons nos urgences. Et comme il faut bien subsister, la nécessité de côtoyer les imbéciles et les fainéants s’impose à nous. La frénésie que manifestent la plupart des hommes, non seulement à trouver une place plus ou moins rémunératrice, mais aussi à s’élever au sommet du panier de crabe où l’on est bien contraint de s’agiter, subsidiairement de s’appuyer sur la tête ou les parties génitales de ses congénères, rend l’espèce humaine suprêmement comique. Cependant, l’on n’est pas démuni, pour peu qu’on veuille sauver quelque chose de cette ridicule pantalonnade. Trois attitudes sont susceptibles d’êtres adoptées :
— l’attitude baroque : l’on est spectateur du Gràn teatro del mundo, des autres et de soi-même. La distance se présente comme une réaction de salubrité ;
— l’attitude que j’appellerais martiale : l’on possède un dharma, un devoir à remplir, fixé par l’Ordre cosmique, qui nous dépasse, et qu’on ne peut que deviner par les retombées d’un destin qu’on ne peut connaître que fort tard, trop tard peut-être. Nous ne sommes que de braves soldats postés sur la ligne de front, perdus ou sacrifiés, je l’ignore, fidèles à leur devoir.
Ces deux visions ne sont pas incompatibles, comme le suggère Calderon.
— Reste la poésie, qui est une grâce, ou une malédiction. L’Artifex est aussi, et surtout, Vates. Il accède à une existence supérieure par l’imagination, qui est la vision. Il traduit, annonce, clame, enchante. Il s’enchante lui-même car il saisit la finalité d’un combat où hommes, bêtes, dieux sont mêlés. Son rôle rejoint celui du prêtre, qui est de lier. Littéralement, il est porté par enthousiasme, par une force supérieure, l’éros, qui lui donne la paix.
Claude Bourrinet
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, révolution conservatrice, nouvelle droite, théorie politique, politologie, sciences politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 juin 2009
Scène de librairie ordinaire

SCENE DE LIBRAIRIE ORDINAIRE
Limonov et Richthofen
Le Secret de l’Espadon, Zipang, Par les Chemins noirs
Joseph Conrad, L’Escadron guillotine, Zanzibar 14
Vitres teintées, air conditionné (chaud-froid, chaud-froid), signalétique labyrinthique. La moquette a une odeur de… moquette. Sur ce territoire exigu, dont le contrôle semble encore en partie échapper à la Grande Compagnie Commerciale, patrouillent en continu de farouches vigiles de souche polynésienne, tatoués jusqu’à l’oreillette – on murmure qu’ils sont les seuls à pouvoir impressionner les jeunes pillards du samedi après-midi, autre produit multiculturel de masse issu de la Nouvelle Réalité Française, mais la direction refuse de communiquer sur le sujet. « – La HALDE veille... » Des gros bras venus du bout du monde connu défendre les trésors de notre civilisation numérique des barbares en maraude le long des portails magnétiques, limes moderne : nom de Bourdieu, comme dirait quelque publiciste situé à la gauche du Fig Mag, c’est la décadence de Rome !
Au Japon, renseigner le client est un devoir sacré. Ici, l’ignorer est un choix de vie des vendeurs. Ils feront tout leur possible pour l’éviter, quitte à accélérer le pas ou à feindre une surdité passagère. Dans ces conditions, il vaut mieux savoir ce qu’on cherche et où le trouver. Ou alors, se laisser aller et déambuler entre les tables, en quête de son coup de coeur de fin de semaine. Alors miracle, parmi la multitude des publications ni faites ni à faire qui encombrent les étalages, des livres émergent, dont l’originalité et la courte durée de vie sont en général les dénominateurs communs. Le roman Zanzibar 14 du suisse Jean-Jacques Langendorf, l’histoire du duel singulier que se livrent, sur fond de rivalité coloniale en Afrique de l’Est, un espion du Kaiser et l’officier de marine britannique chargé de le mettre hors d’état de nuire (InFolio), avoisinera Mes Prisons de l’écrivain-kalachnikov Edward Limonov, quand le fondateur du Parti national-bolchevik russe transforme son emprisonnement sous le règne de Vlad Poutine en exercice d’autocélébration (Actes Sud) ; la réédition en poche chez Phébus de L’Escadron guillotine de Guillermo Ariaga (c’est l’année du Mexique au Salon du Livre de Paris), ou comment l’avocat désargenté Vescardo échoua à vendre la machine du docteur Guillotin à Pancho Villa mais devint un héros de la révolution malgré lui, petit chef-d’œuvre d’humour picaresque, tiendra la dragée haute à La légende du Baron rouge, la biographie conséquente (près de 500 pages tout de même) de Manfred von Richthofen par le chroniqueur musical Stéphane Koechlin (Fayard). Du free jazz aux virevoltes aériennes… La raison de cette profusion folle chaque semaine en librairie ? La crise de l’édition : des parutions de plus en plus nombreuses, des tirages de plus en plus réduits, d’où des livres de plus en plus coûteux et un recours de plus en plus fréquent au compte d’auteur afin de compenser les pertes, y compris dans les grandes maisons.
« By jove ! » Le Secret de l’Espadon, la première aventure du capitaine Blake et de son ami le professeur Mortimer, reparaît en trois volumes, identiques aux originaux ! Pour qui connaît un peu, Le Secret de l’Espadon, en tête de gondole au rayon bandes dessinées, est tout sauf destiné au jeune public. Lorsque les « Jaunes », comme autrefois on parlait des Asiates, s’élancent à la conquête du globe depuis les monts creux du Tibet (le feuilleton paraît dans le Journal de Tintin à partir de 1946), il faut trois albums à nos deux héros so british et l’invention d’une arme géniale pour sauver le monde libre du joug tyrannique de Lhassa. La Couronne, le Commonwealth appuyés par leurs alliés de l’ONU sortent victorieux de la Troisième Guerre mondiale, la civilisation anglo-saxonne triomphe, mais dès le déclenchement de la conflagration le continent européen a été pulvérisé, ses nations rayées de la carte sous les coups de crayon clair du dessinateur, Edgar P. Jacobs. Imaginé, conçu et publié dans le contexte de la guerre froide naissante, Le Secret de l’Espadon entérine auprès de plusieurs générations de lecteurs le retrait de la vieille Europe de l’histoire et la redéfinition de l’Occident autour du futur Pacte Atlantique. De la BD à la réalité… Les Jaunes n’ont jamais déferlé des hauts plateaux de l’Himalaya, relayés dans l’ordre des périls par le rouge des armées soviétiques ; quant à l’Union Jack, il s’est vu reléguer au second rang des drapeaux, loin derrière le Stars and Stripes américain. Deux mondes, deux superpuissances, les Soviets au lieu des Tibétains, les GI’s à la place des Tommies ; deux approches aux antipodes l’une de l’autre de la civilisation, et au milieu les pays européens, témoins désabusés, réduits pour cinquante ans à compter les points dans la partie de go planétaire que vont se livrer sur leur dos les nouveaux maîtres du jeu.
On m’en avait parlé, la version papier du film d’animation Valse avec Bachir est désormais disponible chez Casterman. Cent cinquante-cinq pages de pure beauté visuelle. Je me demande à quel numéro la série des Zipang en est aujourd’hui. 24e tome ! A combien ai-je arrêté de suivre les aventures de l’équipage du destroyer Mirai ? Sur le phénomène Zipang, mon Guide du mangavore ne tarit pas d’éloges : « C’est cela Zipang, de Kawaguchi Kaiji : un navire ultramoderne, le DDG-182 Mirai, et des marins qui, très vite, deviennent familiers, amicaux. Comment ne pas se passionner pour l’incroyable odyssée de ce destroyer japonais en route vers l’Equateur, qui s’évanouit dans la nature, aspiré par un vortex, et réapparaît en 1942, à la veille de la bataille de Midway. Vous serez alors happé par l’intrigue, spectateur des clans qui s’affrontent à bord du Mirai et qui voudront faire de vous un des leurs. Entrez à votre tour dans l’histoire et choisissez votre camp : celui, interventionniste, du capitaine de corvette Kusaka, ou celui du capitaine en second Kadomatsu, plus attentiste et indécis sur l’action à entreprendre. D’autant que les flottes de guerre ennemies se rapprochent. »
Retour aux petits formats. Avant Cœur des ténèbres, il y eut Un avant-poste du progrès, du même Joseph Conrad, que réédite Rivages poche. Le Congo belge de 1896, des colons blancs déracinés, des indigènes, tantôt apathiques, tantôt hostiles, la jungle comme une prison végétale pour tous. Cela pourrait se passer en Martinique en 2009. Je prends.
L. S.
00:18 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lectures, réflexions personnelles, livres, limonov, richthofen, conrad |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 juin 2009
Grenzen ziehen?

Ellen KOSITZA- http://www.sezession.de/
Wenn’s so lang hell ist draußen, gibt’s wenig, was mich ins Büro lockt. Schön, daß man noch zwei Stunden im Garten arbeiten kann, wenn die menschlichen Pflänzchen alle im Bett liegen! In den letzten Tagen schrieb ich an einem längeren Knut-Hamsun-Porträt für die Sezession. Hamsun, mein Lieblingsschriftsteller, würde im August 150; nun liegen wieder zwei, drei Wochen intensiver Hamsun-Lektüre hinter mir, Romane, Biographien, Briefe.
Es gibt Literatur, die – so anregend sie ist – einem ganz vertrackte Knoten in der Hirnsphäre verursacht. Bei Hamsun (der für sein Segen der Erde den Nobelpreis erhielt) ist es ganz anders, man wird so – erdig halt. Wie Hamsun es haßte, als „Schriftsteller“ tituliert zu werden! Wie er die poetologischen Diskurse verabscheute, die laufend an ihn herangetragen wurden! Er sei Bauer, nichts sonst, und im übrigen solle man leben & Kinder kriegen und nicht glauben, daß Bücher „auch Leben“ seien.
Mitte Juni ist nun auch gärtnerische Hoch-Zeit. Daß wir hier in Schnellroda wenn nicht schlechte, so doch romantische, ja utopische Bauern sind, darauf brachte mich das Bild des Tages Utopie (von Mathias Prechtl) unseres technischen Hausmeisters Harki. Daß sich Wolf und Schaf geschwisterlich aneinanderschmiegten – welch Irrglaube! Wir hier sind davon kaum zu heilen, so scheint’s.
Beispiel Acker: Ich kenne den deutschen Mustergarten und wollte das nie. Alles brav in Reih und Glied, Salz aufs Unkraut, Dünger ans Gemüse. Bei mir nicht! Keine Chemie, nur diverse Kräuterbrühen. Alles bleibt stehen, was schön ist und bei Nachbars tüchtig ausgerupft oder sonstwie getilgt wird. Ich erkenne die hübschen Unkräuter im frühesten Stadium und lasse sie stehen, wo sie wollen, die wilden Kamillen, die Taubnesseln, die Ringelblumen (hundertdreiundvierzig, wurde mir heute vorgezählt) und vor allem den roten und den lila Mohn. Über den Zaun kam heute die Frage, ob wir vielleicht eine Opium–Plantage planten? Kubitschek stand rauchend ein paar Meter weiter.
Ja, mir täts leid, all die hübschen Pflänzchen zu eliminieren! Die Folge: Die Gurken wachsen (vielmehr: kümmern dahin) im Schatten von gigantischen Knoblauchrauken, die Tomaten werden vom wunderhübsch-mythischen Labkraut bedrängt (nur ein Unmensch kann das roden!) , und am Ende werden uns die mitleidigen Nachbarn wieder einen Teil ihrer Ernte rüberreichen, weil sie ahnen, daß das bei uns „nüscht wird“. (Was so gar nicht stimmt. Die Leute kapieren nicht, daß Mangold und Rauke nicht nur als Gänsefraß, sondern für herrlichste Gerichte taugen.)
Schlimmer allerdings zahlt sich unser Gutmenschentum in der Tierhaltung aus. Wir meiden das erzwungene Einsperren, das Anleinen etc. Wenn wir Hasen hatten, durften die im ganzen Garten toben. Das ging monatelang gut, heute haben wir keine mehr. Unsere hausgezüchteten Hühner sind ähnlich freiheitsliebend. Bei Nachbars dackeln die von allein vor der Dämmerung in den Stall, bei uns nie. Kubitschek pflückt sie Abend für Abend von den Bäumen und bringt sie zu Bett, außer, wenn sie auf dünnen Ästen weit oben sitzen. So freiheitsliebend ist unsere Brut! Am Ende habens die wagemutigsten immer mit dem Tod bezahlt (weil auch Fuchswelpen und Marderjunge leben wollen) , dann trug das Rittergut Trauer.
Das jüngste Gelege wurde nun mit Draht eingezäunt, und die Nachbarn lachten wieder: „Beton oder Stacheldraht“ lautete ihre Parole. Nicht mit uns, wo kämen wir hin! Heute schlug der eigene – jüngst zugelaufene Hund – die Hälfte der kleinen Enten. Wir wollten ihn nicht in einen Zwinger zwingen. Und nun: ein Schlachtfeld. Wir Gutmenschen! Was wäre die Lehre? Klare Grenzen ziehen, hygienisch wirtschaften? Man lernt halt nie aus.
00:20 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, knut hamsun; |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 juin 2009
De nood aan een bevrijdingsfront voor de man
00:25 Publié dans Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : masculinisme, virilité, libération, opinion, réflexions personnelles, anti-féminisme, féminisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 mai 2009
Money Talks

http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Sunic-Money.html#TS
Money Talks
Tom Sunic
Never has money been so important in human relations. Never has it so much affected the destiny of so many Americans and Europeans. Today money has become a civil religion that makes it the centerpiece of discourse in all cultures and subcultures. At European and American cafes, on the Champs Élysées, or on Sunset Boulevard, at concert halls, and even in parliaments, one hears and smells its verbal derivatives such as “moulah,” “dough,” “fric,” “Kohle,” “pognon.” It is a language understood by all. In all segments of their lives Western citizens invariably talk about money and what money can buy. The great respite may come with the current financial crisis, which is finally undoing the liberal system with all its conventional wisdoms and lies. The ongoing economic depression may be the sign that the reign of money and the dictatorship of well-being are coming to an end.
Sounds familiar? No, it does not. In ancient European traditions money and commerce were looked down upon and at times these two activities were in principle forbidden to Europeans. Merchants were often foreigners and considered second class citizens.
The famous English poet and novelist D. H. Lawrence — a "revolutionary nationalist" — talks about “money madness” in his collection of poems Pansies. His poem “Kill money” summarizes best this facet of 20th-century mores: Kill money/put money out of existence/It is a perverted instinct/A hidden thought /which rots the brain, the blood, the bones, the stones, the soul.
Similar views were held by the long forgotten American Southern agrarians in the 30’s, who viciously attacked American money madness and the belief in progress. They had dark premonitions about the future of America. As noted by John Crowe Ransom, “Along with the gospel of progress goes the gospel of service. Americans are still dreaming the materialistic dreams of their youth.” And further he writes: “The concept of Progress is the concept of man’s increasing command, and eventually a perfect command over the forces of nature: a concept which enhances too readily our conceit and brutalizes our life.”
Thousands of book titles and thousands of poems from antiquity all the way to early modernity bear witness to a tradition of deep revulsion Europeans had for money and merchants. Charles Dickens’ description of the character Fagin the Jew in his novel Oliver Twist may be soon cut out from the mandatory school curriculum. Fagin’s physical repulsiveness, his strange name, and most of all his Jewish identity do not square with modern ukases on ethnic and diversity training in American schools. The crook Fagin illustrates boundless human greed when he sings to himself and his young captive boys: “In this life, one thing counts / In the bank, large amounts / I'm afraid these don't grow on trees, / You've got to pick-a-pocket or two / You've got to pick-a-pocket or two, boys, / You've got to pick-a-pocket or two.”
Already Ezra Pound, a connoisseur of the English language and a visionary on the methods of usury, and his contemporary, Norwegian Nobel prize winner Knut Hamsun, have disappeared from library shelves. Their fault? They critically examined the crisis of financial capitalism, or what we call more euphemistically today “global recession” and the main movers and shakers behind it.
In medieval times, money and the merchant class were social outcasts solely needed to run the economy of a country. Yet today they have morphed into role models of the West represented by a slick and successful banker dressed in an Armani suit and sporting a broad smile on his face. What a change from traditional Europe in which an intelligent man was destined for priesthood, sainthood, or a military career!
It is with the rising tide of modernity that the value system began to change. Even nowadays the word ‘merchant’ in the French and the German languages (marchand, Händler) has a slightly pejorative meaning, associated with a foreigner, prototypically a Jew. The early Catholic Church had an ambiguous attitude toward money — and toward Jews. Well known are St. Luke’s parables (16:19–31) that it “is easier for a camel to go thru the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.”
But the Church chose a less pious way to power. In 1179, the Third Lateran Council forbade Jews from living in Christian communities and exiled them to ghettos — with full rights to practice usury and tax collecting. To a large extent the Church, while providing the best shelter for Jews against frequent bouts of popular anti-Jewish anger, also greatly amassed wealth — courtesy of Jewish tax collectors.
The father of the Enlightenment, the 18th-century French philosopher Voltaire, is often quoted as a first spokesman of tolerance and human rights in Western civilization. But it is often forgotten that Voltaire was also an unabashed anti-Semite. Voltaire’s critical remarks about Jews and their love for money were recently expunged from his books, or simply not translated. But some still thrive such as “always superstitious and greedy for the good of others, always barbarous, crawling when in misfortune and insolent in prosperity, that is what the Jews were in the eyes of the Greeks and Romans..” (Essais sur les mœurs)
The ancient European ruling class certainly had its share of corruption and greed. But in principle, until the Enlightenment, the social roles of money and merchants were subjugated to the role of the prince and power politics. Until then, the entire value system had been based on spiritual transcendence and not on economic growth — at least in its appearance. In ancient Greece, King Midas who was a kind man, could not resist the temptation of turning everything into gold with his magic fingers, until he ruined his family, turned water into undrinkable metal, and his face assumed the shape of a donkey. King Croesus went berserk after amassing so much wealth that he could not devote his time and his thoughts to the impending war with the Persians.
In the ancient European tradition, revulsion against money pervades the sagas and the old popular legends, teaching everybody that piety prospers over prosperity. Material wealth brings disaster.
Today, by contrast, official advocacy of frugality and modesty is perceived as a sign of the early stage of lunacy. If a well-educated and well-cultivated man comes along and starts preaching modesty or rejects honoraria for his work, he is considered a failure, a person who does not respect his own worth. How on earth can some well-read and well-bread person offer his services for free? How on earth can a well-educated man refuse using his mental resources to generate the almighty dollar? The answer is not difficult to discover. In capitalism everything has its price, but nothing has value.
The modern liberal capitalist system is a deeply inhuman system, based on fraudulent teaching that everybody is equal in economic competition. In reality though, it rewards only those whose skills and talents happen to be marketable. Those rare Whites who decide to retain some vestiges of old European traditions are squarely pronounced incompetent. Liberal capitalism both in America and in Europe has turned all humans into perishable commodities.
Nobody summarized this better than the Italian philosopher Julius Evola, another revolutionary nationalist who wrote: “Facing the classical dilemma 'your money or your life,' the bourgeois will answer: 'Take my life but leave me my money.'”
Greed, passionate greed eclipses all elements of human decency. Until relatively recently avarice was laughed at and its chief protagonists were considered immoral people, so well represented in Molière’s comedy L’Avare. Today the greedier the better: The money maker is the ultimate role model.
Both East and West participate in this ethic of greed. The richest people in post-communist Eastern Europe are former communist hacks who converted themselves in a twinkle of an eye from disciples of Marx into acolytes of Milton Friedman and Friedrich Hayek. Finance capitalism provides the perception of limitless possibility of how to get rich out of the blue. This is a typical Bernie Madoff syndrome, namely that affluence can be created by sheer speculation. The entire banking system in Eastern Europe has been sold to foreigners over the last 10 years.
Modern capitalism and a penchant for finance owe much to Judaism. Werner Sombart, a German disciple of Max Weber, who can in no way be called an anti-Semite wrote in The Jews and Modern Capitalism that “money was their sole companion when they were thrust naked into the street, and their sole protector when the hand of the oppressor was heavy upon them. So they learned to love it, seeing that by its aid alone they could subdue the mighty ones of the earth. Money became the means whereby they — and through them all mankind — might wield power without themselves being strong.”
Money changes social mores too. Young White couples put off having children until they achieve their economic dreams, while Mexicans and Blacks begin having children as impoverished teenagers, and Muslims place a high value on fertility. This is one of the main causes of our malaise, as White societies with declining fertility are inundated by highly fertile non-White populations with value systems that prize fertility over the accumulation of the accouterments of economic success.
And in this economic recession these Whites are not interested in a pay raise but rather in how to keep their job — security at all cost, even if it means working for lower wages. Neither are young job market entrants interested in saving money. Instead they live on credit in their petty little niche with their petty little pleasures and without incurring any risks.
What a difference from early American pioneers described by Jack London, who braved the vagaries of weather and who totally ignored the meaning of “hedge funds”! The attractions of money and the necessity of making money mean that everybody in our postmodern world becomes prey to the system.
It is a fundamental mistake among many so called right wingers and racialists to assume that capitalism is the only answer to communism. Both systems are in fact similar because they preach the same religion of progress and the unfolding of earthly paradise — albeit in different gears. But this time liberal capitalism has nobody to hide behind in order to conceal its vulgar depravity. The likely hypothesis is that the crumbling capitalist system will fall apart as a result of its own victory. One dies always from those who give him birth.
Tom Sunic (http://www.tomsunic.info/; http://doctorsunic.netfirms.com/) is an author, former political science professor in the USA, translator and former Croat diplomat. He is the author of Homo americanus: Child of the Postmodern Age ( 2007
00:22 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, usure, argent, monnaie, économie, sociologie, histoire, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Claduio Risé: la postmodernité est une révolution conservatrice!

Archives de "Synergies Européennes" - 1997
Claudio Risé:
La postmodernité est une révolution conservatrice!
Quel corpus idéologique succédera à la droite? Affinons notre question: comme jamais la droite ne gagne les élections, sauf en Angleterre, comme elle connaît la défaite depuis plus d'un demi-siècle en Italie, sera-t-elle éliminée à tout jamais des prochains chapitres des livres d'histoire? Cette question, nombreuses sont les revues les plus autorisées de l'établissement culturel et politique du monde occidental: depuis Foreign Affairs aux Etats-Unis, très écouté au “département d'Etat”, en passant par Theory, Culture and Society en Grande-Bretagne, l'une des revues les plus attentives aux phénomènes dits “postmodernes”, jusqu'au Monde Diplomatique de Paris, qui se pose comme l'observateur classique de la gauche en matières de politique internationale.
Le Monde Diplomatique se préoccupe surtout de “la droite à la conquête des âmes”, dont la gauche semble avoir oublié de s'occuper, parce qu'elle se concentre obsessionnellement sur sa propre survie après l'écroulement du marxisme. Cette droite qui inquiète le Monde Diplomatique est une droite dont la vitalité ne se mesure pas tant (ou pas seulement) en termes de suffrages, mais surtout en termes d'adhésions individuelles ou d'élites intellectuelles ou, plus particulièrement, de jeunes. De ce point de vue, la victoire récente des listes de droite lors des dernières élections universitaires italiennes —même si l'on décrète dans les rangs mêmes des droites qu'il ne s'agit que d'un phénomène “qualunquiste”, “quelconque”, purement réactif, dépourvu de signification— je crois, personnellement, qu'il s'agit d'un signal de plus, annonciateur d'une situation en mutation rapide.
Mais ce qui inquiète un bon nombre de politologues de gauche, ce sont les curieuses affinités qui relient la réflexion sur la postmodernité dans son ensemble au mouvement qui s'était développé dans l'Allemagne de la République de Weimar et que l'on appelle la “révolution conservatrice”, dont les principaux exposants furent Ernst Jünger, Martin Heidegger et le juriste Carl Schmitt.
Quels sont les indices qui nous permettent de dire que la “révolution conservatrice” est de retour? Goran Dahl, professeur de sociologie à l'Université de Lund en Suède, vient de consacrer un long essai sur cette question dans la revue Theory, Culture and Society. L'un des principaux indices permettant de poser l'analogie “révolution conservatrice”/“postmodernité” est la valorisation accordée à la technologie, perçue comme l'instrument parfait pour se libérer du “vieil ordre”, ainsi que des classes dirigeantes incapables et corrompues qui l'expriment. Du temps de la “révolution conservatrice”, Ernst Jünger avait fait du “Travailleur” le héros des nouvelles technologies destinées à changer le monde. Cette option “technique” avait grandement irrité les proto-nazis (on a trouvé la phrase suivante dans l'une de leurs publications mineures: «Jünger se rapproche de la zone des balles dans la nuque»), tout comme les sociaux-démocrates, désorientés par cette figure d'un “Travailleur” si peu marxiste, plus passionné par la guerre que par l'économie.
Aujourd'hui, à l'âge postmoderne, c'est quelque chose de très semblable qui se passe: la technologie et l'informatique constituent la grande ligne de partage entre ceux qui parient sur les “temps nouveaux” et sont prêts à courir des risques et à se lancer dans l'aventure, d'une part, et ceux qui, à droite mais surtout à gauche, dressent haut la bannière de la “vieille” modernité contre la postmodernité hypertechnologique. Ces partisans conservateurs et frileux de la “vieille modernité” accusent par exemple Internet de tous les maux imaginables: la guerre, l'effondrement de la religion ou la prolifération des religiosités alternatives et irrationnelles, la pédophilie, etc. Mais Internet est surtout utilisé ouvertement comme instrument pour rassembler des informations sur les mouvements affirmant les identités traditionnelles (culturelles, religieuses, nationales) et, de ce fait, proches des principes qu'avait affirmés jadis la “révolution conservatrice”.
Autre similitude entre postmodernité et “révolution conservatrice”, qui a surpris beaucoup de monde: les deux mouvements d'idées estiment que sont positives et fécondes les “différences” entre les peuples et les cultures, nées sur des territoires précis. Cette position conduit à une rupture voire à un choc frontal tant avec la gauche —qui prône l'universalisme et, en paroles du moins, l'égalité absolue— qu'avec la droite (du temps de la “révolution conservatrice”, c'était Hitler) qui est toujours plus ou moins ouvertement raciste et pour laquelle le différent est toujours inférieur. Sur le terrain des “différences”, le réveil de la révolution conservatrice acquiert une vitalité explosive face à l'égalitarisme hypocrite de la gauche car justement cet égalitarisme a été contesté en premier lieu par les peuples dominés par les empires coloniaux construits sur des fondements issus de l'idéologie progressiste! Sur cette thématique, la version postmoderne de la révolution conservatrice est bien vivante, non seulement parce qu'elle s'articule sur les notions dégagées par les principaux philosophes du siècle —de Derrida à Foucault et à Deleuze— mais surtout parce que ses thèses sont celles de tout le discours culturel et politique de l'ère post-coloniale, discours qui est sans doute la part la plus substantielle de la postmodernité.
Par l'effet de la globalisation, marque majeure de notre contemporéanité, cet héritage idéologique postcolonial trouve évidemment des alliés importants. Comme, par exemple, Kishore Mahbubani, secrétaire du ministère des affaires étrangères de Singapour, qui se plaignait, dans les colonnes de la revue Foreign Affairs, que les Occidentaux avaient du mal à comprendre que l'Asie pouvait accepter la technologie avancée sans pour autant renoncer à ses propres traditions et à sa propre culture.
L'Occident, selon cet homme politique de Singapour, n'a pas vraiment accepté que “d'autres cultures ou d'autres formes d'organisation sociale pouvaient avoir une égale validité”, justement parce que “la croyance en la valeur universelle de ses propres idées peut amener à l'incapacité de reconnaître le principe de la diversité”. La domination à l'ère coloniale de l'idéologie des Lumières et de ses dérivés idéologiques constitue d'ailleurs une thématique à la fois politique et morale que l'on ne peut plus esquiver. Thématique à laquelle un philosophe attentif et sensible comme Salvatore Veca, pour ne donner qu'un exemple, a consacré des réflexions très précises et pertinentes dans son dernier essai, Dell'incertezza (paru chez Feltrinelli). Pour Veca, la (re)-valorisation des différences induit que le lieu, le site, le topos d'une culture, puis la culture proprement dite ainsi que les traditions enracinées prennent le pas, dans l'ère postmoderne comme dans le corpus doctrinal de la “révolution conservatrice”, la place qu'occupait le temps (plus ascétique) dans la modernité, et cela sous l'oripeau de l'idée de progrès, présente depuis le XVIIIième des Lumières jusqu'à nos jours.
Avec la (re)-valorisation du topos, on affirme également ipso facto la centralité de la géopolitique (comme l'a noté l'Allemand Joachim Weber), qui affirme les caractéristiques “organiques” (c'est-à-dire culturelles au sens anthropologique) des nations qui ne sont finalement que fort mal représentées par les ordres juridiques que sont les Etats classiques, issus des révolutions bourgeoises et aujourd'hui nettement en crise. Cette radicalité “révolutionnaire-conservatrice” se lie non seulement avec les exposants philosophiques de la postmodernité mais aussi avec les autres protagonistes de la pensée scientifique contemporaine tels Paul Feyerabend, dont l'idée centrale est que le savoir n'est jamais universel, mais toujours une “valeur locale, destinée à satisfaire des besoins locaux”, propres de nations, de peuples et de cultures particulières (ou de “tribus”, dirait Michel Maffesoli, autre brillant exposant de cette option particulariste suscitant tant de turbulences).
«Le conservatisme, pour être plus révolutionnaire que n'importe quelle forme d'“illuminisme” positiviste, n'a besoin de rien de plus que d'esprit, et de rien de moins qu'une révolution conservatrice», écrivait Thomas Mann en 1921. Voilà pourquoi, à l'ère postmoderne, qui est tout à la fois conservatrice et futuriste, on assiste au retour de la “révolution conservatrice”, nous assure Goran Dahl. Du reste, on peut observer que cette “révolution conservatrice” n'a jamais totalement disparu. Tant Jünger que Heidegger ou Schmitt ont survécu gaillardement à l'effondrement allemand de 1945 et n'ont jamais abandonné leurs idées. Immédiatement après la fin des hostilités, ils ont trouvé des disciples attentifs et des continuateurs féconds. Certes, la “modernité” est restée en selle, du moins officiellement, et continue à nier les différences, à manier sa notion de “progrès”, à imposer son mépris pour tout ce qui est “local”, pour les potentialités de la “terre”. La survivance du corpus des Jünger, Schmitt et Heidegger peut sembler marginale. Mais aujourd'hui, postmodernité et postcolonialisme ont revalorisé les traditions, les différences et les territoires et il me semble beaucoup plus difficile de faire machine arrière, alors que les plus brillants esprits du siècle ont bel et bien participé au mouvement. Mais il est vrai aussi que les tenants actuels du différencialisme sont fort différents de cette “nichée de dragons” qu'avait aimée Stephen Spender dans le Berlin qui basculait dans le nazisme et qu'il a décrite avec un esthétisme complaisant dans Un monde dans le monde. Les tenants contemporains ressemblent au contraire davantage à ces étudiants qui viennent, en Italie, de voter pour les listes de droite lors des élections universitaires. Car, comme nous l'a dit Sergio Ricossa, dans les colonnes d'Il Giornale, le 27 avril 1997, “ils veulent connaître le monde tel qu'il est”. Ils sont moins romantiques, moins grandiloquents, que leurs prédécesseurs. C'est mieux, car notre siècle en a trop vus, des dragons...
Claudio RISÉ.
(article paru dans Il Giornale, 6 mai 1997).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, postmodernité, modernité, sociologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 mai 2009
Citaat van Lee Kuan Yew, premier van Singapore

Citaat van Lee Kuan Yew, premier van Singapore
“Westerse idealen benadrukken de rechten en privileges van het individu boven die van de groep en in het bijzonder boven die van de staat.
Westerse samenlevingen waarderen individuele vervulling – wat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring noemt “the pursuit of happiness” – en regelen hun zaken dienovereenkomstig. Oosterse samenlevingen geloven dat individuen zich vervullen doorheen de grotere identiteit van de groep.
In het Chinees zegt men: “de kleine zelf opofferen om de grote zelf te bereiken.” Deze nadruk op naar anderen gerichte waarden – op communautaire waarden en plichten boven rechten – is één van de onderscheidende kenmerken van de nieuwe industrielanden, en in de ogen van vele sociologen de sleutelfactor in hun succes. Ik beweer niet dat Westerlingen niet in staat zijn tot onbaatzuchtige dienstverlening aan anderen, of dat er geen egoïsten zijn in het Oosten. Maar er is een reëel verschil tussen Oost en West. Elke samenleving heeft natuurlijk zowel communautaire als individualistische drijfveren. Elke samenleving, tussen recht en verantwoordelijkheden en tussen concurrentie en samenwerking. Dat moeten wij ook. In dit opzicht zijn wij een Oosterse samenleving, en dat moeten we blijven. Als we naar het andere uiterste overhellen, en zonder veel kritiek de Westerse opvattingen aanvaarden over de absolute suprematie van individuele rechten en vrijheden – opvattingen die zelfs in het Westen ter discussie staan – dan wordt dit onze ondergang.”
Lee Kuan Yew, premier van Singapore, 1989
00:34 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie, singapour, affaires asiatiques, sud-est asiatique, philosophie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook








